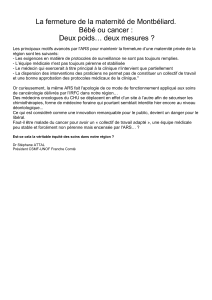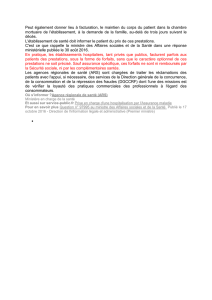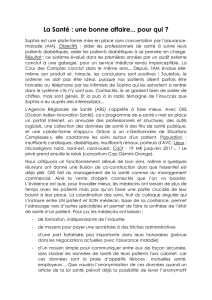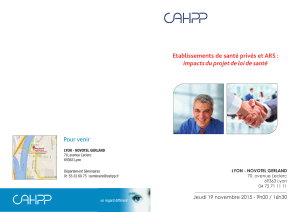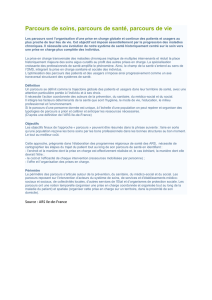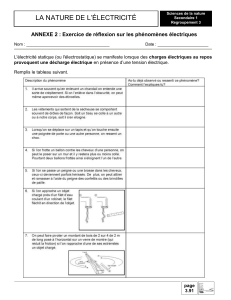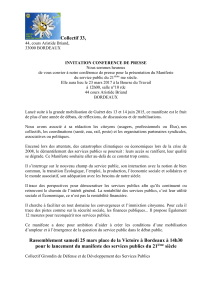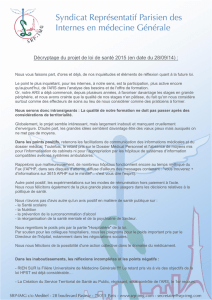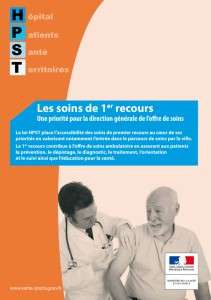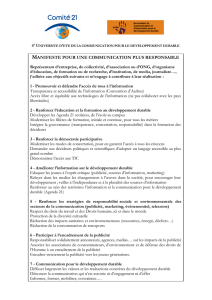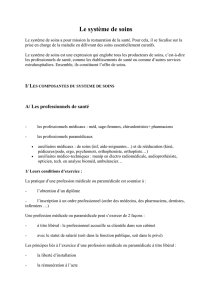ars industrialis

1
ARS INDUSTRIALIS
AL
05/10/2010
PROJET
APPEL A PARTICIPATION AU GROUPE DE TRAVAIL
ECONOMIE DE LA CONTRIBUTION
Ars Industrialis organise un nouveau groupe de travail « Economie de
la contribution », thématique au centre de nos préoccupations ; celle-ci a
fait l’objet de plusieurs débats au théâtre de la Colline et a été largement
abordée dans nos publications, dans nos interventions publiques et dans
notre Manifeste 2010.- cf. www.arsindustrialis.org -
La création de ce groupe de travail a pour objectifs, comme expliqué
plus en détail ci-dessous, d’approfondir cette question avec d’une part des
membres de l’association - ceux-ci pourront, entre autres, nous faire bénéficier
de leurs expériences dans des pratiques « contributives » -, et d’autre part avec
des personnalités externes auxquels nous ferons ponctuellement appel pour
confronter leurs points de vue avec les résultats de nos travaux.
Une première réunion se tiendra le SAMEDI 6 NOVEMBRE de 14h. à
18h. à la Maison des Associations du XVIIème arrondissement, 25 rue Lantiez,
75017, métro Guy Môquet, ligne 13, en présence notamment de Bernard
Stiegler, Pierre Dumesnil, Franck Cormerais, Arnauld de L’Epine.
Tous les membres de l'association intéressés pour apporter leur
contribution sont chaleureusement invités à se manifester en envoyant un
message à contact@arsindustrialis.org avec l'expression « Economie de la
contribution » dans l'objet du message, en précisant s’ils ont l’intention de
se rendre à cette première réunion.
x
QUELQUES PRECISIONS SUR CE GROUPE DE TRAVAIL
Ars Industrialis n’a cessé, à travers ses publications, ses débats au théâtre de la Colline, ses
divers séminaires, sa participation à divers colloques, ses interventions dans des émissions de
radio et de télévision, de forger et de faire connaître des propositions théoriques et pratiques
sur les conditions permettant de faire évoluer le mode présent d’organisation industriel de
producteur-consommateur vers une économie de la contribution, susceptible de mettre fin à
une prolétarisation généralisée de moins en moins soutenable, que ce soit psychiquement,
politiquement ou économiquement.
Dans notre nouveau Manifeste, joint en annexe, et rendu public à la fin du mois d’août, nous
soulignons que la crise en cours n’est pas simplement financière : il s’agit de la fin d’une
organisation économique et industrielle qui a marqué le XXè siècle, que nous caractérisons
comme consumériste, et qui a atteint ses limites.

2
Bien que cette situation soit loin d’être pleinement reconnue, trois ans après l’éclatement de la
crise présente, de plus en plus nombreux sont les instances publiques et les économistes
remettant en cause les doxa néolibérales qui nous ont mené à cette faillite : c’est par exemple
le cas du rapport de l’ONU dit Rapport Stiglitz
1
, lequel reconnaît que nous n’avons pas
seulement à faire à une crise financière, mais à une crise du système économique et de ses
pratiques, ainsi que du Manifeste des économistes atterrés de septembre 2010
2
.
Dans notre manifeste de 2005, nous posions que le système consumériste atteindrait
rapidement ses limites d’abord parce qu’il ruinait l’énergie libidinale, c’est à dire le désir, en
le captant de façon destructive. Nous posions que le capitalisme est comme toute économie un
stade de ce que Freud avait appelé l’économie libidinale, mais qu’à la différence des stades
précédents, celui-ci conduit à l’épuisement de l’énergie libidinale elle-même. Cette thèse est
désormais largement attestée, partagée et éprouvée par tout un chacun, qui constate le devenir
pulsionnel et addictif de la consommation souvent en soi-même.
Or, la révolution numérique a fait émerger un nouveau type d’économie industrielle qui
reconstitue une économie libidinale, c’est à dire un dispositif d’investissements dans des
objets de travail et de socialisation : l’économie contributive est en cela précisément une
économie libidinale, et elle se caractérise par un nouveau type de comportements individuels
et collectifs, celui qui caractérise la figure d’un contributeur affilié à un réseau (qui n’est pas
nécessairement électronique mais toujours social).
Afin d’accentuer ses efforts pour contribuer à l’analyse et au développement de cette nouvelle
forme d’économie, ce groupe de travail aura pour principaux objectifs :
1° d’analyser et de préciser ce qu’implique l’économie de la contribution, en
particulier en tant que :
- nouvel horizon en matière de développement économique et social ainsi que
territorial, remettant en cause en particulier l’hégémonie des finalités de valorisation
du capital et des formes de domination exercées par les tendances de plus en plus
marquées à la fragmentation du travail salarial et de l’existence individuelle ;
- régénération de nos désirs, c’est à dire de nos investissements
3
, suscitant une autre
forme de perception
4
en remettant en cause le primat de l’homo oeconomicus
5
et la
« servitude volontaire »
6
et réhabilitant le bien commun et les processus délibératifs et
démocratiques ;
- reconstitution des formes de savoirs – savoir faire, savoir vivre, savoir théoriser – qui
ont été détruites par le processus de prolétarisation et de désapprentissage auquel a
conduit une socialisation des technologies exclusivement mise au service de
l’augmentation des plus value au détriment de la qualité du travail et des résultats du
travail
7
8
;
1
cf. Le rapport Stiglitz, Pour une vraie réforme du système monétaire et financier international, éd. LLL Les
liens qui libèrent, 2010, p.32
2
http://www.assoeconomiepolitique.org/?article140.
3
cf. Yves Citton, L’avenir de nos humanités, Economie de la connaissance ou cultures de l’interprétation, La
Découverte, 2010, p.47
4
cf. Deleuze, cours du 24 Janvier 1984 disponible sur le site « la voix de Gilles Deleuze » , http://www.univ-
paris8.fr/deleuze
5
Frédéric Lordon, La crise de trop, Fayard, 2009, pp.115-117
6
Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude, La Fabrique, 2010 p.30
7
cf. Richard Sennet, Ce que sait la main, la culture de l’artisanat, Albin Michel, 2009
8
cf. Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 1989

3
- émergence de nouvelles capabilités individuelles et collectives qui sont les conditions
d’une écologie relationnelle
9
tenant compte du temps long
10
et constituant des
externalités positives ;
- modes d’action allant au-delà de pratiques telles que celles du logiciel libre, de
l’économie du don, de l’économie publique, de l’économie sociale de marché, et
faisant émerger les milieux et réseaux de transindividuation
11
(ou milieux associés)
que rendent possibles les technologies relationnelles ;
- nouvelle Puissance Publique agissant en priorité pour des politiques d’investissements
pertinents dans des infrastructures communes et de recherche à long terme, remettant
en cause des modes de captations et d’enclosures, qui caractérisent l’économie
présente, et faisant des politiques culturelles et des politiques sociales des opérations
d’investissement dans les capacités individuelles et collectives ;
- orientations en matière de refondation des conventions comptables et d’indices
sociaux
- novations par rapport aux pratiques dites associatives, coopératives, solidaires, à
partir d’une analyse des pratiques et des statuts de ces formes de coopération
12
.
2° de dialoguer avec des expérimentateurs de terrain – membres d’Ars Industrialis ou
non ;
3° de réaliser des entretiens filmés (puis diffusés sur le site d’Ars Industrialis et indexés
avec le logiciel Lignes de temps) avec des personnalités susceptibles d’apporter leurs
contributions ;
4° d’analyser certains Manifestes « politiques » - cf. Manifeste des Economistes atterrés,
Manifeste de Julliard, Propositions de partis politiques – et d’élaborer des propositions à
publier
5° d’organiser un colloque avant la fin de l’année 2011.
9
cf. site Ars Industrialis, Manifeste 2010
10
cf. Maurizio Lazzarato, Expérimentations politiques, Ed. Amsterdam, 2009 , p.168 : « nous avons besoin de
temps comme matière première fondamentale ».
11
cf. Vocabulaire sur le site Ars Industrialis
12
cf. Laurent Gadin, Les entreprises sociales, Revue du Mauss, 15 Mars 2010,
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article664
1
/
3
100%