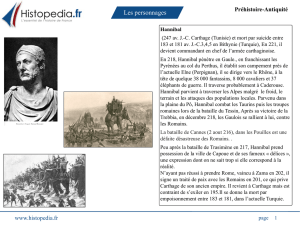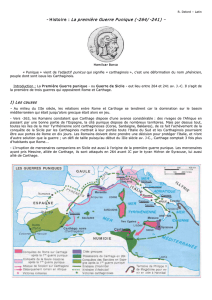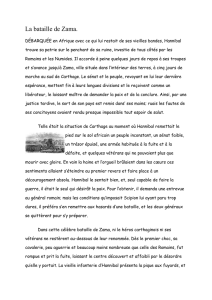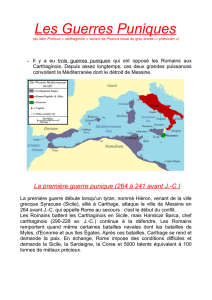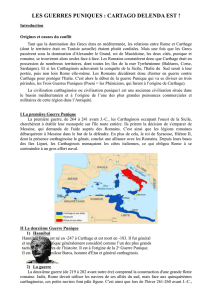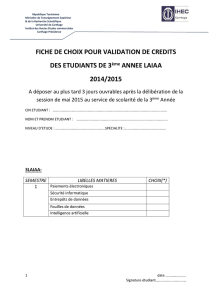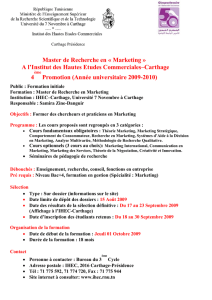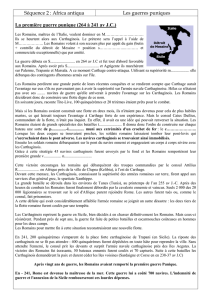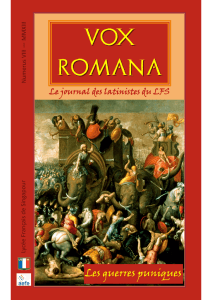Luttes de carthaginois contre les romains et les indigènes

Luttes de carthaginois contre les romains et les indigènes.
ICI commence un drame magnifique: les deux républiques les plus puissantes
dont l’histoire ait conservé le souvenir vont lutter ensemble, non plus pour la
possession de la Sicile, mais pour celle de la Méditerranée, qui doit donner au
vainqueur l’empire du monde ! Carthage, la république commerçante, a de grandes
flottes et des matelots sans nombre; Rome, la république agricole, n’a pas un seul
vaisseau, et cependant elle l’emportera par l’énergie de sa volonté et l’infatigable
opiniâtreté de ses efforts.
On sait sous quel prétexte ces deux états en vinrent aux mains. Les
habitants d’une ville de la Sicile s’étaient divisés en deux partis; les uns
appelèrent les Romains à leur secours, les autres les Carthaginois. Déjà, à cette
époque, l’Italie presque entière obéissait à la république: Sabins, Volsques,
Samnites, étaient ses tributaires ; et Pyrrhus venait de fuir honteusement
devant ses aigles triomphantes. Cependant Rome hésitait encore. Le sénat refusa
d’abord le secours demandé; mais le peuple consulté t’accorda, et la guerre fut
décidée. Quelques misérables vaisseaux empruntés à leurs alliés transportèrent
les légions romaines en Sicile. Tel fut le commencement de la première guerre
punique.
Moins célèbre que la seconde, parce que les noms d’Hannibal et de Scipion
n’y figurent pas, cette guerre fut plus longue et tout aussi cruelle. Les Romains
s’y formèrent à cette patience héroïque qui les rendit invincibles. Luttant contre
un peuple de navigateurs et de marchands, qui couvrait la mer de ses flottes, ils
sentirent la nécessité de créer une marine pour repousser les ravages que leurs
ennemis exerçaient sur les côtes d’Italie. Sans ingénieurs et sans ouvriers pour
la construction des vaisseaux, leur génie et leur persévérance suppléèrent à tout.
Une galère prise sur l’ennemi, dans un port de Sicile, leur servit de modèle. On

travailla la nuit, on travailla le jour pour hâter les constructions; les citoyens de
toutes les classes et de toutes les conditions s’imposèrent les plus durs
sacrifices pour atteindre ce résultat, et en peu de mois, une flotte de cent vingt
galères fut mise à la mer. Cependant les premiers combats de ces marins
improvisés ne furent pas heureux. Souvent leurs habiles adversaires, plus
souvent les tempêtes contre lesquelles ils n’avaient pas encore appris à lutter,
détruisirent ces vaisseaux construits à la hâte et avec tant de peine. Mais
l’énergie romaine s’accrut de ces défaites mêmes, et les Carthaginois, battus sur
terre en Sicile et en Sardaigne, le furent aussi sur mer, leur empire et leur
élément. Les Romains poursuivirent bientôt leurs ennemis jusqu’en Afrique.
De toutes les expéditions de la première guerre punique, celle de Regulus
est la plus célèbre. Les vertus morales et guerrières de cet illustre Romain, ses
premiers succès, facilités par l’aversion des populations africaines contre leur
superbe dominatrice, ses fautes, sa défaite, sa captivité, sa mort héroïque
surtout, ont immortalisé cette période de l’histoire de sa patrie: le lecteur
n’ignore pas que deux prisonniers carthaginois, livrés à la veuve de Regulus,
périrent à Rouie dans d’affreux supplices. Ces vengeances barbares, ces
représailles non moins cruelles, donnèrent à la guerre un caractère d'atrocité
qu’elle n’avait pas encore revêtu. Ce ne fut plus une lutte ordinaire entre deux
peuples, mais un véritable duel entre deux adversaires décidés à vaincre ou à
mourir; enfin le courage des Romains l’emporta, et Carthage fut réduite à
demander la paix. Céder une première fois, c’était se mettre dans la nécessité de
céder une seconde, une troisième, jusqu’à sa ruine totale; c’est en effet ce qui
arriva. D’après les termes du traité qui mit fin à la première guerre punique,
Carthage évacua la Sicile, rendit sans rançon tous les prisonniers, et paya les
frais de la guerre. Elle accordait tout et ne recevait rien son humiliation était
complète, l’orgueil des Romains satisfait et leur supériorité reconnue.

Ce honteux traité venait à peine d’être signé, lorsqu’une guerre intestine
s’alluma autour des murs de Carthage et menaça de la dévorer. Comme cet
événement met en saillie une partie des institutions politiques de la république
phénicienne, nous allons lui consacrer quelques développements. Les armées de
Carthage se composaient partie d’auxiliaires, partie de Mercenaires. Au lieu de
dépeupler ses villes pour avoir des soldats, elle en achetait au dehors; les
hommes n’étaient pour cette opulente république qu’une marchandise. Elle
prenait, dans chaque pays, les troupes les plus renommées : la Numidie lui
fournissait une cavalerie brave, impétueuse, infatigable; les îles Baléares lui
donnaient les plus adroits frondeurs du monde; l’Espagne, une infanterie
invincible; la Gaule, des guerriers à toute épreuve; la Grèce, des ingénieurs et
des stratégistes consommés. Sans affaiblir sa population par des levées
d’hommes, ni interrompre son commerce, Carthage mettait donc en campagne de
nombreuses armées, composées des meilleurs soldats de l’Europe et de l’Afrique.
Cette organisation, avantageuse en apparence, fut pour elle une cause incessante
de troubles, et hâta même sa ruine. Aucun lien moral n’unissait entre eux ces
Mercenaires : victorieux et bien payés, ils servaient avec zèle; mais au moindre
revers ils se révoltaient, abandonnaient leurs drapeaux, souvent même passaient
à l’ennemi. Un des plus beaux titres de gloire du grand Hannibal est d’être resté
pendant seize ans en Italie avec une armée composée de vingt peuples divers,
sans qu’aucune révolte ait eu lieu, sans qu’aucune rivalité sérieuse ait dissous cet
assemblage d’éléments hétérogènes.
Après la malheureuse expédition de Sicile, les Mercenaires, aigris par leurs
défaites et surtout par le retard qu’éprouvait le paiement de leur solde. s’étaient
révoltés, avaient massacré leurs chefs, et les avaient remplacés par des
officiers subalternes; d’un autre côté, les villes maritimes, les populations
agricoles de l’intérieur, accablées d’impôts, voulurent profiter de cette

insurrection pour secouer un joug qu’elles portaient avec impatience, et les
tribus même les plus lointaines, celles qui faisaient paître leurs troupeaux sur les
deux versants de l’Atlas, excitées par l’espoir du pillage, accoururent en foule
dans les rangs des insurgés. Les meurtres et l’incendie précédaient cette
multitude féroce, et Carthage se vit bientôt entourée d’un cercle de fer et de
feu.
Réduite à l’enceinte de ses murailles, sans troupes, sans vaisseaux, la
métropole africaine semblait près de sa ruine; jamais sa position n’avait été plus
critique. Mais l’excès du danger ranima le courage des Carthaginois. Deux
généraux célèbres leur restaient encore Hannon et Hamilcar. Formés tous deux à
l’école de l’adversité dans cette longue lutte qui avait embrasé l’Europe et
l’Afrique, ils employèrent, pour sauver leur patrie, tour à tour la franchise et la
ruse, les armes et la politique; chefs de deux partis opposés, ils se
réconcilièrent, sacrifiant généreusement à l’intérêt de tous leurs intérêts
particuliers. Leur bonne intelligence assura le succès et mit fin à la guerre.
Désorganisés, puis vaincus dans deux grandes batailles, les Mercenaires furent
dispersés et détruits; les villes révoltées se soumirent ou furent emportées
d’assaut; l’Afrique entière rentra sous le joug, et Carthage respirai Mais
d’effroyables cruautés avaient été commises de part et d’autre, des milliers
d’hommes avaient péri dans les supplices.
Éteinte en Afrique après une lutte qui dura trois ans (240-237 avant J.-C.),
la guerre des Mercenaires se ralluma en Sardaigne, où elle fut plus funeste
encore aux Carthaginois; car elle les mit aux prises avec les Romains. Partout
Rome s’élevait devant Carthage pour l’empêcher de réparer ses pertes: en
Afrique, elle avait fourni des armes et des vivres aux révoltés; en Sardaigne, elle
intervint entre les habitants et les Mercenaires, et s’empara de l’île. Poussée à
bout, Carthage fit des préparatifs pour la reprendre; mais Rome menaça de

rompre le traité. N’osant renouveler la guerre contre une puissance qui l’avait
vaincue et forcée à accepter de dures conditions aux jours de sa plus haute
prospérité, Carthage acheta la continuation de la paix en renonçant à ses
prétentions sur la Sardaigne et en payant aux Romains douze cents talents
d’argent.
Cette paix désastreuse ne pouvait durer. Le commerce, c’est-à-dire
l’existence même des Carthaginois, était attaqué dans sa base par la perte de
leurs colonies; l’empire de la Méditerranée ne leur appartenait plus; les flottes
ennemies s’en étaient complètement emparées; les places fortes de la Sicile et
de la Sardaigne avaient reçu garnison romaine, et les côtes de l’Italie étaient
dans un état de défense formidable. Toute voie par mer leur était donc fermée.
Sur terre, l’Espagne seule leur était ouverte: ils y envoyèrent une armée dont ils
donnèrent le commandement à Hamilcar.
C’était changer toute la politique qui avait fait la grandeur de Carthage, que
de chercher dans les conquêtes continentales un dédommagement aux désastres
maritimes; cette révolution, du reste, fut accomplie avec une rare habileté. Déjà
célèbre par les guerres soutenues en Sicile contre les Romains, par celle
d’Afrique contre les Mercenaires et les peuplades de la Numidie, Hamilcar était
à la fois un habile capitaine et un grand politique. Son armée fit des progrès
rapides. Les peuples vaincus par la force des armes furent gagnés par la
clémence et la justice du vainqueur, et la domination carthaginoise s’établit dans
la meilleure partie de la Péninsule, sur des bases fermes et solides. Une
discipline sévère, une bonne et sage administration attirèrent au général
carthaginois l’estime et la confiance des Ibériens.
Hamilcar ayant été tué dans une bataille, son gendre Hasdrubal lui succéda,
et imita son exemple aussi bien dans la guerre que dans la politique. Ce général
 6
6
 7
7
1
/
7
100%