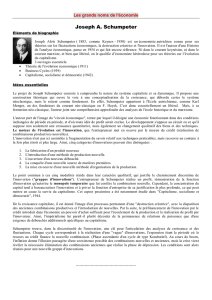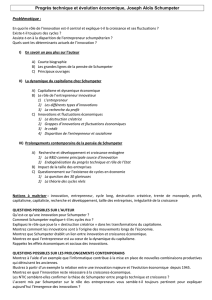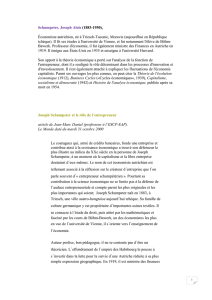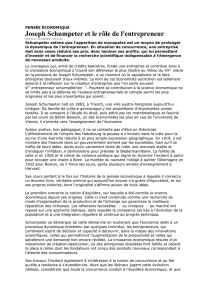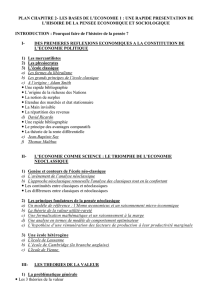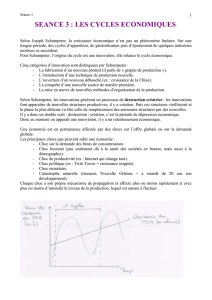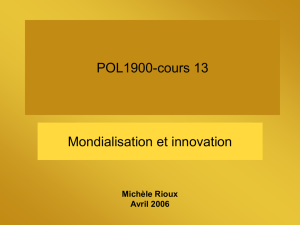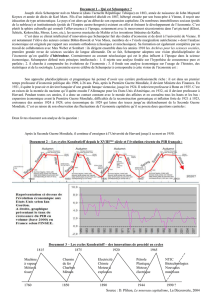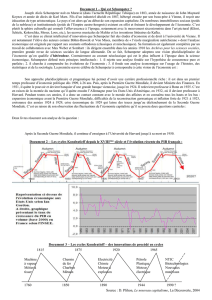Joseph Aloïs Schumpeter

Joseph Aloïs Schumpeter
Né en 1883 (naissance de Keynes, mort de Marx), mort en 1950 avant d’avoir connu les
Trente Glorieuses, il vit dans un contexte de remise en cause du capitalisme et de l’analyse de
son évolution. Classé comme un économiste hétérodoxe, il rompt avec la vision statique de
l’économie et les vues des économistes de son temps (y compris Keynes), bien qu’il soit issu
de l’école de Vienne (ou école de Menger, les néoclassiques autrichiens).
Petite biographie : (pompée sur Maruska !)
Fils d’un industriel allemand (Go Hanae !), économiste et sociologue autrichien, il est
pendant un an ministre des finances (d’un gouvernement social-démocrate) après avoir
travaillé dans une firme en Egypte. Il enseigne dans son pays, mais avec la montée du
nazisme, il s’exile aux Etats-Unis, et accepte une chaire de professeur à Columbia University.
Ses principaux ouvrages sont :
-Théorie de l’évolution économique (1911) dans lequel il insiste sur l’importance cruciale des
innovations et le rôle déterminant de l’entrepreneur
-Les cycles des affaires (1939), dans lequel il distingue trois grands types de cycles et les
explique par l’émergence et l’absorption des vagues d’innovations, mais qui n’aura que peu
d’audience car il paraît trois ans après la Théorie Générale de Keynes
-Capitalisme, socialisme et démocratie (1942) où il montre que l’évolution du capitalisme
sape les fondements sociaux et culturels de la société capitaliste, conduisant ainsi à
l’avènement du socialisme
-Histoire de l’analyse économique (posthume en 1954)
1. Une vision dynamique du capitalisme
« Le capitalisme, répétons-le, constitue de par sa nature un type ou une méthode de
transformation économique ; et non seulement il n’est jamais stationnaire, mais il ne pourrait
jamais le devenir », énonce-t-il dans C, S et D.
Le projet schumpétérien, similaire à celui des classiques et à celui de Marx, est de comprendre
cette évolution : il part pour cela d’un circuit stationnaire et montre l’impossibilité de toute
évolution en l’absence de ferments favorables, non représentés dans ce circuit : pas d’âges,
donc pas d’entrepreneurs ; pas de motivations, car pas de profits ni de surplus ; pas de crises.
L’innovation est à la source de toute évolution. Elle rompt avec l’imitation qui caractérise
l’état stationnaire et y contribue. En effet, l’innovation introduit l’incertitude, la nouveauté, le
déséquilibre, c’est un phénomène particulier qui ne se rencontre pas parmi les phénomènes du
circuit ou de la tendance à l’équilibre mais qui agit sur eux comme une puissance extérieure,
bien qu’elle soit endogène. Elle modifie la production et les structures de production, elle a
donc un contenu qualitatif. Elle est particulièrement forte dans le commerce et l’industrie. On
distingue 5 cas d’innovation :
Nouveau produit
Nouvelle méthode de production
Nouveaux débouchés
Nouvelle organisation du travail
Nouvelles matières premières
L’innovation n’est pas une invention, elle n’est pas liée directement au système scientifique
ou technique : elle est l’adaptation de ce système à de nouvelles conditions de production.
Mais la substitution n’est pas forcément totale, le processus innovateur subit des fluctuations,
des situations alternantes de développement et de crise alors que de nouvelles entreprises
bouleversent le cadre de production dans laquelle les anciennes évoluent. Il se produit alors un

déséquilibre entre les sphères de la consommation et de la production, les entreprises peuvent
produire sans que la consommation soit adaptée Les entreprises innovatrices absorbent
beaucoup de capitaux et ne peuvent rembourser que plus tard, il y a donc un déséquilibre entre
besoin d’épargne et capacité de financement.
Pour Schumpeter, la récession est une nécessité du capitalisme, elle permet la résorption et la
liquidation de l’économie car certains profitent de cette récession. La crise est le passage d’un
équilibre à un autre, la dépression se prolonge tant que le nouvel équilibre n’est pas réalisé,
nouvel équilibre qui se caractérise par un produit social plus élevé et de composition
différente, de nouvelles fonctions de production, un taux d’intérêt minimal, des profits nuls et
des prêts nuls (hé bé ! c’est moyen réjouissant tout ça !). La justification du rôle de la crise est
à la base de la théorie des cycles, dans lesquels Schumpeter distingue 4 phases : récession,
liquidation, dépression, renouveau. Les cycles s’emboîtent :
- cycles Kitchin (40 mois) ou cycles sectoriels
- cycles Juglar (8 à 10 ans) ou cycles conjoncturels
- cycles Kondratiev (50 à 75 ans)
La théorie de Schumpi explique les cycles de Kondratiev qui peuvent varier entre 40, 50, et
60 ans (selon S, la durée du cycle dépend de l’ampleur des innovations).
La phase A, celle de prospérité est provoquée par les innovations de quelques entrepreneurs
innovants. La continuation de cette phase est due à l’imitation qui provient des autres
entrepreneurs. C’est pour cela qu’il parle de « grappes d’innovations ». Cette période se
caractérise également par une hausse des prix liée à l’augmentation du nombre de crédits
finançant l’innovation, et à la hausse des prix que les entrepreneurs innovants peuvent se
permettre. La phase B est celle où l’innovation s’essouffle, et ne suffit plus à porter la
croissance. La demande des consommateurs en nouveaux produits est comblée. Les
entreprises les moins performantes s’effondrent, ce qui permet de « nettoyer le terrain » pour
faciliter la prochaine phase de prospérité. La crise est donc un mal nécessaire à la santé du
capitalisme.
2. Le rôle de l’entrepreneur
L’entrepreneur joue un rôle particulier dans la croissance ; à l’époque de Schumpeter,
l’entrepreneur désigne déjà un mythe (forte concentration industrielle dès la fin du XIX°) : il
devient pour lui un idéal de type wébérien.
Schumpeter prend ainsi le contre-pied de la théorie néoclassique : il refuse la vision
walrassienne de l’économie et le modèle de concurrence pure et parfait. Dans celui-ci,
l’entrepreneur est annihilé par l’atomicité du marché (même les firmes ne sont qu’un point, et
même pas… Alors ! notons tout de même qu’un point, c’est rond !), c’est une entité abstraite.
La recherche du profit grâce aux rentes n’est possible que parce que, ben justement, la
concurrence n’est PAS pure et parfaite !
Cependant, n’est pas entrepreneur qui veut : pour Schumpeter, la stratégie de l’innovation
réclame de l’énergie, de l’ambition, de la passion, du sang-froid, de la décision, l’aptitude à
reconnaître dans une situation donnée les facteurs qui déterminent le succès. La situation de
concurrence est donc très rarement établie : il n’y a pas égalité des individus face au
capitalisme, les réussites personnelles pouvant conduire à des situations de bénéfice très
important. Quelles sont les motivations de cet homme parfait ? Le profit qu’il pourra retirer de
ses innovations, et aussi une certaine rationalité qui le stimule pour sans cesse réaffirmer son
image d’entrepreneur dynamique. Ce sont les décisions stratégiques prises au bon moment qui
expliquent la naissance de dynasties industrielles (les Rockefeller, les Carnegie, les
Vanderbilt, yay !) « Il y a d’abord en lui le rêve et la volonté de fonder un royaume privé, le
plus souvent quoique pas toujours, une dynastie aussi » : l’entrepreneur est un innovateur

chargé de mettre en place de nouvelles combinaisons dans tous les domaines, étranger aux
valeurs supra individuelles (voyez le surhomme nietzschéen).
L’imitation suit l’innovation : certains droits découlent en effet de l’innovation.
L’entrepreneur peut bénéficier d’un brevet de fabrication protégé par exemple, et plus
généralement, il bénéficie d’une situation de monopole. Il peut ainsi, par exemple, augmenter
les prix de vente selon son bon vouloir (contredit offre et demande).Les autres entrepreneurs
cherchent eux aussi, à jouir de ces avantages. Un rapport de forces s’installe donc.
Mais à l’état stationnaire, toutes les forces sont utilisées : le crédit est donc la seule solution
pour entreprendre, c’est une création de pouvoir d’achat en vue de sa concession à
l’entrepreneur ou un détournement des moyens de production vers de nouveaux choix. D’où
l’importance du rôle des banques : Schumpeter reconnaît en effet deux agents dans la
dynamique du capitalisme : l’entrepreneur et le banquier, qui plus qu’un simple intermédiaire
dans les échanges est une partie prenante à la fonction innovatrice de l’entrepreneur. Le crédit
bouleverse l’équilibre ex-ante de l’investissement et de l’épargne.
Le profit, ni profit de monopole, ni salaire, ni rente, est la mesure de l’efficacité de la nouvelle
combinaison productive ; sa durée est finie en raison de l’imitation. L’intérêt découle de la
situation économique, notamment de la demande monétaire effectuée par l’industrie.
3. Une vision pessimiste de l’évolution du capitalisme
Pour Schumpeter, l’entrepreneur n’est pas forcément cantonné au capitalisme. Il montre que
l’entrepreneur peut exister dans les formes d’organisation socialiste (contexte : difficultés du
capitalisme dans les années 30). « Le capitalisme peut-il survivre ? Non, je ne crois pas qu’il
le puisse ». En effet, il s’entend à s’autodétruire.
Il a pourtant certains atouts :
- Sa capacité à sélectionner la bourgeoisie (les individus et les familles les plus
compétentes) est une garantie de la perpétuation du système
- Le processus de destruction créatrice explique le renouvellement incessant du système,
l’analyse du capitalisme ne peut être qu’une analyse de long terme.
- Schumpi justifie la concurrence imparfaite, moyen de production à long terme
- La firme géante est le moteur le plus puissant du progrès technique (moteur lui-même de
l’innovation ! amen !)
Mais les facteurs externes (l’Etat, l’or –la monnaie-, la démographie) ne jouent qu’un rôle peu
important, Schumpi se montre donc critique de l’analyse en termes de pouvoir par tête. Les
conquêtes géographiques sont une chance à saisir mais pas plus.
Les faiblesses du capitalisme doivent entraîner sa disparition :
- Épuisement du modèle entrepreneurial : l’innovation tend à devenir une routine dans les
sociétés modernes, où l’individu est écrasé par la bureaucratie et les lourdeurs de gestion de
l’appareil productif : vision désenchantée de l’action économique.
- La gestion prend le pas sur la fonction créatrice, Schumpi craint la mort de la classe
bourgeoise remplacée par des gestionnaires
- La concentration favorise la bureaucratie et empêche le développement de la fonction
créatrice, la liberté contractuelle disparaît
- La productivité recule, les dirigeants tendant à adopter la mentalité de l’employé
- L’atmosphère culturelle prédispose à une désagrégation du capitalisme, le groupe
intellectuel encadre les mécontentements quand il ne les crée pas.
=>« Le socialisme peut-il fonctionner ? À coup sûr il le peut ». Il définit le socialisme comme
« un système institutionnel dans lequel une autorité centrale contrôle les moyens de
production et la production elle-même, ou encore un système dans lequel les affaires
économiques ressortissent en principe du secteur public et non du secteur privé ». Il accepte la
mise en place d’un plan rationnel et d’un système de prix relatifs efficients.

Schumpeter croit en l’affirmation d’une « démocratie d’un nouveau type » dans laquelle le
renouvellement des entrepreneurs se rapproche de la théorie de Pareto sur la circulation des
élites (hey mais c’est mon TPE, si vous avez des questions dessus n’hésitez pas !)
Conclusion : l’actualité de Schumpeter
Son analyse est une vaste fresque pluridisciplinaire (intégrant l’histoire, la psychologie, la
sociologie, des aspects politiques et culturels) qui a les défauts de ses qualités.
François Perroux dans Marx, Schumpeter, Keynes (1994) considère que le concept de
dynamique (dans « vision dynamique de l’économie ») est plutôt fuyant (moi je me demande
pourquoi il n’a pas dit « mou » !), l’analyse de Schumpeter manque de support théorique et
n’est confortée que par des faits historiques, presque des exemples. De plus, Schumpeter
réserve l’innovation aux entrepreneurs privés alors que Perroux intègre le secteur public.
La théorie des cycles est controversée du fait de la difficulté de repérer les grappes
d’innovation empiriquement, d’où une critique de la rupture des cycles d’innovation (pour
Asselain, pas de rupture du progrès technique).
Mais depuis 25 ans, renouveau de l’analyse en termes de cycle : l’analyse cyclique est à la
base de l’école de la régulation (Boyer, Aglietta, Lipietz…), qui a considéré que la thèse néo-
schumpétérienne pouvait expliquer l’échec des politiques, tant conservatrices que de relance.
Schumpeter aura été « l’apôtre d’une macroéconomie de l’offre » (Robert Boyer) : la crise
s’expliquerait par un remodelage de l’ensemble des structures productives.
1
/
4
100%