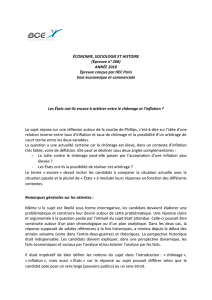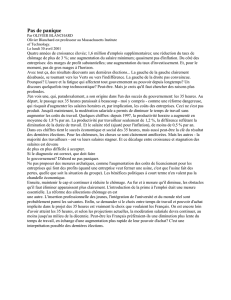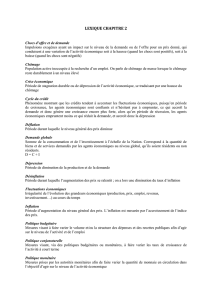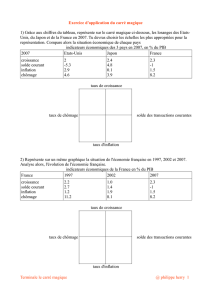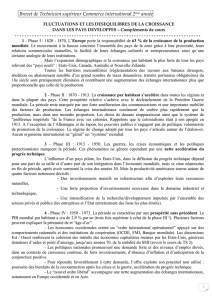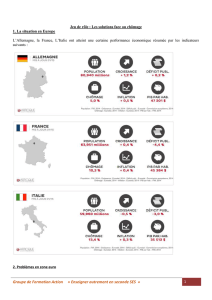Chapitre 1 : L`entreprise contrainte à une concurrence sans fin I. L

1
Chapitre 1 : L’entreprise contrainte à une concurrence sans fin
I. L’entreprise et son fonctionnement
1. Le concept d’entreprise
A. Définition
On peut donner trois définitions possibles du concept d’entreprise :
- L’entreprise est une entité de production liée à la recherche du profit quel que soit
le système économique. Le profit est la motivation principale de l’entreprise et
l’expression monétaire de l’efficacité. La différence entre les économies
collectivistes et les économies libérales est que le profit n’est pas réparti de la
même façon.
- L’entreprise est une entité de décision qui a des objectifs à réaliser. Cette définition
nous fait passer l’entreprise en tant qu’entité juridique comme l’entrepreneur en
tant que responsable d’entreprendre.
- L’entreprise est une entité de production qui combine les différents facteurs de la
production achetés ou loués à l’extérieur et qui vend sur le marché les biens et les
services résultant en vu de réaliser le plus grand profit possible.
B. Différentes approches
On peut distinguer trois approches différentes de l’entreprise :
- L’approche comportementale ou behavioriste : La firme apparaît comme un
organisme de coalition dont les composantes sont les actionnaires, les cadres
dirigeants, les syndicats et les clients. Les décisions de l’ensemble ne peuvent être
qu’une résultante.
- L’approche managériale : La firme apparaît comme une cellule de décideurs ne se
confondant pas avec les détenteurs du capital, c'est-à-dire avec les propriétaires.
Une entreprise émet des actions réparties entres plusieurs actionnaires qui ne
dirigent pas, ce sont en fait les managers qui dirigent l’entreprise sans pour autant
être propriétaire.
- L’approche systématique : Elle relève d’une approche globale c'est-à-dire qui
analyse un système dans son ensemble. Un système est un ensemble au sein duquel
chaque élément influence les autres en même temps qu’il est influencé par eux. La
dynamique d’un système dépend de deux couples dialectiques :
o Se maintenir et évoluer : Si l’on prend un bébé qui vient de naître et un
vieillard prêt à décéder, on constate qu’il s’agit toujours d’un être humain
cependant très différent l’un de l’autre. La constatation à faire est que
l’homme évolue mais reste toujours un être humain. Si nous faisons
l’analogie avec l’entreprise, elle évolue sans cesse mais doit toujours rester
une entreprise.
o Se laisser agresser et évoluer : Notre corps est agressé chaque moment de
notre vie et s’il n’a plus la capacité d’être agressé, vient alors la maladie.
Pour l’entreprise, c’est la même chose, elle doit se laisser agresser pour
survivre car sinon elle meurt.

2
2. La classification des entreprises
A. Selon le domaine d’activité
On note trois types d’entreprise selon le domaine d’activité (agricole, industriel,
service). De plus on distingue les PME (petites et moyennes entreprises) et les entreprises
individuelles.
- Une entreprise individuelle est entreprise de moins de 10 personnes.
- Une petite entreprise est une entreprise de 50 personnes environs et une moyenne
entreprise est une entreprise de 200 à 300 entreprises environ.
Les entreprises agricoles sont des entreprises dont l’activité est liée à la terre. Ce sont
exclusivement des entreprises familiales d’où le terme d’exploitation agricole. Il est à noter
que leur part diminue de plus en plus dans la population active.
L’effectif des entreprises de service (transport, finance et distribution) augmente alors
que l’effectif de la culture diminue.
On a de plus en plus d’entreprises individuelles.
Mais pour créer son entreprise, certains critères et qualités sont requis :
- Le sens de l’observation,
- L’esprit critique en même temps que créatif,
- Une capacité d’initiative,
- Une grande autonomie,
- Une capacité de communication, de persuasion et de persévérance.
B. Classification des entreprises selon statut juridique
On peut distinguer deux types d’entreprises selon leur statut juridique :
- Les entreprises individuelles : Le propriétaire et le travailleur sont la même
personne. Les domaines d’activité où l’on trouve le plus d’entreprises individuelles
sont l’artisanat, les petits commerces, la sous-traitance ou encore les professions
libérales (médecin, avocat…)
o Avantage : Liberté d’action.
o Inconvénient : Surface financière trop étroite.
- Les entreprise sociétaires : On peut distinguer cinq types d’entreprise
o Les sociétés de personne : Le capital accumulé pour former la société
résulte de l’apport de personnes qui se connaissent, c’est à dire que ce sont
les capacités qui comptent et non les capitaux.
o Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Elles sont nées du droit
allemand et ont été crée en 1925. Ce type de statut est commun à 60% des
sociétés françaises. Dans la SARL, on attache beaucoup plus d’importance
aux capitaux apportés cependant on reste dans une société de personne
dans la mesure où il doit avoir une approbation des autres associés.
o Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) : Elles ont
été instauré en 1985. Elles possèdent comme avantage d’avoir un seul
apporteur de capitaux qui en cas d’ennuies verra seulement son capital
apporté perdu.
o Les sociétés de capitaux : Il y a plusieurs types de sociétés de capitaux, la
société anonyme (SA) est la société la plus répandue. Il s’agit d’une société
correspondante aux entreprises les plus grandes de France (multinationales)
et représentent 5% des entreprises françaises. On ne s’occupe pas du tout

3
des actionnaires, ce qui importe ce sont les capitaux. En cas de fermeture,
les actionnaires perdent leurs actions.
o Les sociétés d’économie mixte : L’Etat ou les collectivités locales
détiennent la majorité du capital. Pour des raisons de sécurité, ils doivent
avoir au minimum 51% des voix. Exemples de sociétés d’économie mixte :
autoroute Paris Lyon ou encore la SNCF jusqu’en 1984.
- Les entreprises coopératives : Elles ne résultent pas du choix des entrepreneurs
mais d’une association de personnes qui sans être des entrepreneurs veulent agir
ensemble pour produire ensemble, pour distribuer ensemble, pour contrôler
ensemble ou encore pour équiper ensemble. Exemples d’entreprises coopératives :
les exploitants agricoles qui achètent des biens d’équipement ensemble ce qui
donne lieu à une coopérative d’équipement. On trouve aussi des coopératives chez
les exploitants viticoles qui mettent en place des labels. Les entreprises
coopératives sont très nombreuses dans l’est de la France et en Allemagne.
3. Le cas des entreprises publiques
A. Nationalisation et dénationalisation
- L’approche du concept des nationalisations : Il y a nationalisation lorsqu’il y a
appropriation par l’Etat d’une entreprise qui était une entreprise privée. Mais il y a
par symétrie, nationalisation lorsqu’il y a création d’une entreprise par l’Etat.
Exemple : Renault qui a été nationalisé puis privatisé. Le ramassage des ordures ou
encore le théâtre appartiennent à la région, il s’agit donc de nationalisation. Les
justifications de la nationalisation :
o Politiques : Renault par exemple aurait collaboré avec l’ennemi d’où par
punition a été nationaliser.
o Sociales : Service publique qui ne peut être offert par une entreprise
juridiquement privée comme la SNCF, EDF ou encore GDF qui
remplissent des services d’intérêt public d’où leur nationalisation dès 1945.
o Stratégiques : En 1975, crise du pétrole ce qui entraîna la création, par
Renault, d’automobiles qui consommaient moins. La nationalisation
devient de ce cas un vecteur de transmission de progrès technologique.
o Doctrinales : Il y a différents courants :
Marxistes : Le capitalisme tombe dans l’étatisation faute de recourir
aux nationalisations qui impliquent plus qu’un changement de
propriété ou de contrôle mais qui implique un changement de
système. Pour Marx ou Engels, la nationalisation implique dans un
premier temps celle des banques, puis celles des transports, puis
dans un deuxième temps celle de l’industrie et de l’agriculture.
Keynésiens : Keynes a été traumatisé par la différence entre
l’enseignement qu’il a reçu et la réalité. Il a affirmé que l’économie
pouvait être en équilibre en sous-emploi. Keynes est
interventionniste car il veut sauver le libéralisme.
L’interventionnisme peut aller jusqu’à la nationalisation des
entreprises par l’Etat.
- Les problèmes posés par les nationalisations et par suite par les dénationalisations :
Dès 1985, dénationalisation car il est difficile de changer de système. Il vaut mieux
mettre les entreprises aux mains des secteurs privés car en de problèmes ce ne sera
pas la faute de l’Etat.

4
B. Service public et concurrence
Si l’union européenne ne sacrifie pas le service public sur l’autel de la concurrence,
c'est-à-dire sur l’autel du grand marché, elle remet néanmoins en cause lorsque l’entreprise
chargée de sa gestion se soustrait à une concurrence qui ne ferait pas pour autant obstacle à sa
mission d’intérêt économique général.
Sans le remettre en cause, l’article 90-2 du traité de Maastricht soumet le service public à la
concurrence sauf si cette concurrence va à l’encontre de l’intérêt général.
Il y a en fait une divergence d’approche entre le droit français et le droit communautaire.
Alors que le droit français ne distingue pas le service public du monopole d’Etat, le droit
communautaire lui le distingue.
En tant qu’économistes, nous devons en effet distinguer le statut de l’entreprise du service
public rendu par cette entreprise.
Il faut distinguer l’entreprise publique de ceux qui le gèrent, il faut distinguer le monopole
absolu du monopole du monopole naturel.
Selon l’approche des théories des structures industrielles, le prix n’est plus fonction de tel ou
tel type de marché mais tel ou tel type de marché appelé configuration naturelle qui dégage un
prix jugé être à l’avantage des usagers s’impose.
Pour qu’il y ait configuration naturelle, il faut qu’il y ait confrontation de deux hypothèses :
- le marché doit être contestable : c'est-à-dire qu’il ne doit avoir aucun obstacle
financiers ou juridiques majeurs où si lieu est, on est capable de les récupérer.
- Le marché doit être soutenable : il faut que ceux qui s’y trouvent ne fassent pas de
pertes de gains excessifs ce qui justifierait que d’autres entrepreneurs viennent les
concurrencer.
Nous allons montrer qu’en cas de monopole naturel, le prix est inférieur au prix de
concurrence. L’entreprise produit 100, elle bénéficie d’économies d’échelles donc son coût
est de 5 et elle vend autour de 6 ce qui va décourager d’autres entreprises à entrer sur le
marché car sinon il y aurait une concurrence d’où un coût plus élevé, aux alentours de 10, ce
qui entraînerait l’absence d’économies d’échelles d’où un prix plus élevé.
4. L’évolution de l’organisation du travail et de l’attribution du pouvoir
A. Du Taylorisme au Fordisme et à l’informatisation
- Taylor : Il est à la base de l’organisation scientifique du travail qui repose sur la
division du travail qui est double, il y a une division verticale empruntée d’Aristote
(ce qui pensent et ceux qui agissent) et horizontale, la partielisation des tâches.
- Ford : Il a ajouté à l’organisation du travail par Taylor les flux continus. Il été en
Keynésien car il payait bien ses ouvriers pour qu’ils achètent des automobiles.
- Informatisation : Gestion des tâches à effectuer grâce à l’informatique.
B. Un pouvoir plus dispersé mais aussi plus étendu
L’entreprise moderne marque depuis longtemps la tendance au gigantisme qui justifie
l’appel à des capitaux de plus en plus importants et par la même il justifie l’appel à des
actionnaires de plus ne plus nombreux mais la multiplication du nombre des actionnaires et
leur dispersion conduit à se poser la question qui dirige l’entreprise réellement, qui contrôle
qui ? Au coté de ce pouvoir le plus dispersé, le pouvoir est de plus en plus étendu c'est-à-dire
que le pouvoir déborde de plus en plu l’activité de l’entreprise. Le pouvoir de l’entreprise sort

5
de plus en plus de l’entreprise pour contrôler des groupes de pression comme les médias. Au
coté de la volonté de maîtriser des groupes de pression il y a la volonté de maîtriser le pouvoir
politique. Il déborde aussi sur la finance et sur le marché par le biais de la publicité.
II. Les stratégies de l’entreprise moderne
1. Stratégie commerciale
La stratégie est la capacité à la rapidité d’adaptation.
A. Connaissance du produit, de la branche, du secteur
- Un produit est un bien économique satisfaisant certains besoins spécifiques. On dit
d’un bien qu’il est économique parce que la production de celui-ci a un certain
coût. Ce bien peut être visible ou invisible (services).
- La branche est l’ensemble des entreprises qui fabriquent le même bien ou le même
type de bien ou de produit. Ce qui définie la branche est l’homogénéité du produit.
- Le secteur est l’ensembles des entreprises qui sont soumises à un même pouvoir
financier. On peut aussi dire qu’il y a unicité du commandement.
B. La connaissance de la filière et du créneau
- La filière se définit comme le regroupement d’activités complémentaires du point
de vue technique et du point de vue commercial. En effet un même bien subit
nécessairement plusieurs transformations au cours de sa production. On parle alors
dans ce cas de chaîne de production.
o La filière des loisirs ou du tourisme serait de toutes les filières
économiques la plus large car elle intègre l’activité du bâtiment, des
transports, du commerce ainsi que celle de la finance.
o La filière pétrole est aussi très large car elle intègre l’exploitation, la
production, le transport, le raffinage et la distribution.
- Le créneau signifie la place à prendre sur le marché
2. Stratégie de localisation
Création, extension ou déplacement.
A. Analyse des critères
- L’existence de débouchés actuels ou potentiels : Il peut s’agir de débouchés pour
les produits finis ou alors pour les produits intermédiaires. Le lieu d’installation de
l’entreprise est un tremplin pour accéder aux débouchés voisins. Certains sites sont
importants pour l’image de marque (couture à Milan, foie gras dans le Périgord…)
- L’environnement :
o Présence de voies de circulation, de routes, de canaux, de chemins de fer ou
encore la viabilisation du terrain,
o Proximité de laboratoires de recherche,
o Présence de logements attrayant pour la main d’oeuvre,
o Présence de locaux industriels disponibles ou encore d’autres entreprises
(zones industrielles),
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
1
/
63
100%