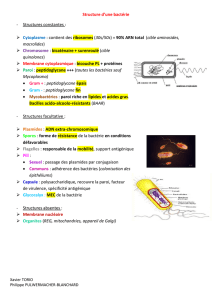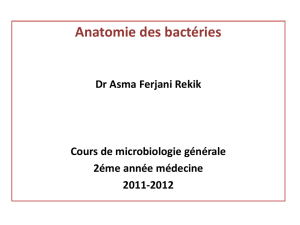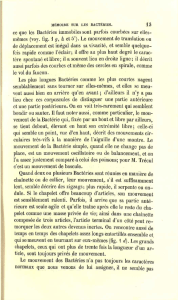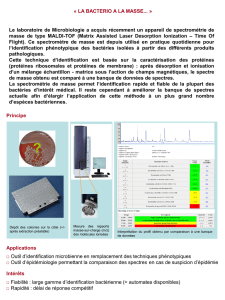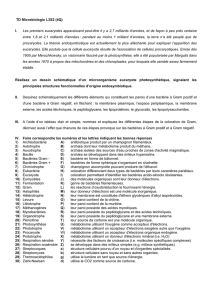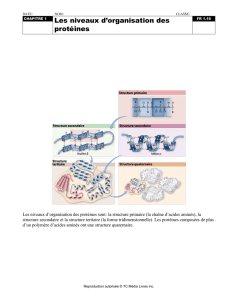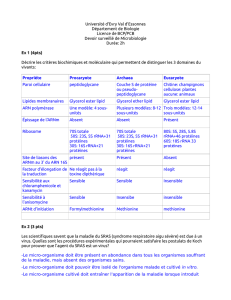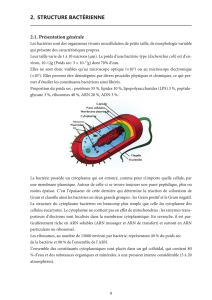Types trophiques et structure cellulaire

CH.3 : LES TYPES TROPHIQUES BACTERIENS
I/ BACTERIES PHOTOTROPHES
- Effectuent la photosynthèse (≠ plantes) = Bactéries photosynthétiques
- Production d’ATP à partir de la phosphorylation de ADP+Pi de la chaîne respiratoire grâce à
la lumière = PHOTOPHOSPHORYLATION
1) Les Cyanobactéries Gr-
Ils sont aquatiques, 3 groupes : cf pl.10
- Unicellulaires (pas de cellules spécialisées) 3-4 µm
- Filamenteux (alignements de cellules végétatives, pas de cellules spécialisées)
- Filamenteux (cellules végétatives + hétérocystes)
Fonctionnent comme un chloroplaste, ont 2 photosystèmes : PSI et PSII
Constitués de chlorophylles (a,b,c,d,e) et des pigments accessoires (caroténoïdes)
Les thylakoïdes sont indépendants les uns des autres (pas de grana)
Récupération maximale de la lumière par le PHYCOBILISOME
Photo-oxydation de l’eau : production d’O2, transfert d’électrons (cf transfert d’électrons
pl.10)
Assimilation du CO2 grâce à la protéine Rubisco pour fabriquer des glucides qui vont entrer
dans le Cycle de Calvin = AUTOTROPHE
2) Bactéries pourpres et vertes (pl.10)
Possèdent beaucoup de pigments caroténoïdes différents (jaunes, orangés, rouges, verts)
N’ont qu’un seul photosystème : P 950 (entre 850 et 1050 nm)
Ce ne sont plus les chlorophylles qui sont en œuvre mais les
BACTERIOCHLOROPHYLLES qui ont un hétérocycle tétrapyrollique :
avec une queue GERAMYL ou une queue FARNESYL
Si la lumière est trop forte, ces pigments vont
transformer l’énergie lumineuse en chaleur

Photosynthèse anaérobique : pas de production d’O2 (pas de photo-oxydation de l’eau)
Mais photo-oxydation selon 2 types de bactéries :
- les souffrés, donneurs d’électrons : SH2 → S + 2H+ + 2e-
- les non-souffrés, donneurs d’électrons sont les composés organiques
Ces bactéries sont autotrophes, assimilation d’O2 (Rubisco) fabrication de glucides, cycle de
Calvin…
Le transfert des électrons se fait en 2 étapes :
- Photophosphorylation cyclique : sert à produire de l’ATP (pas de pouvoir réducteur)
- Transfert non cyclique : production de NADH, génération de pouvoir réducteur, le
donneur est donc soit le composé souffré, soit l’acide organique.
3) Halobacterium Halobium (pl.11)
Photosynthèse « archaïque » (rudimentaire), utilise l’énergie lumineuse → ATP mais pas de
production d’O2
Le photosystème est une protéine : la RHODOPSINE, mais il n’y a pas de transfert
d’électrons
Le pigment photorécepteur est logé dans la membrane la plasmique : la
BACTERIORHODOPSINE (protéine)
Sous l’action de la lumière, création d’un gradient de protons qui, par l’ATP synthase va
fournir de l’ATP, il s’agit bien là d’une photo-oxydation
La bactérie n’a pas besoin de glucose et il n’y a pas de dégradation de substrats énergétiques
D’où viennent les protons ?
Ils viennent d’une protéine : la RETINAL (chaîne de 15 C avec une fonction aldéhyde à la
fin) accrochée à la bactériorhodopsine en position 216 sur un résidu lysyl.
La liaison du rétinal-résidu lysyl de la protéine se fait entre un azote et un carbone : l’azote est
ici quaternaire (NH+), ce qui est instable : c’est le site actif qui va réagir sous l’action de la
lumière.
Pas de rubisco : c’est une bactérie hétérotrophe vis-à-vis du C
L’azote redevient alors tertiaire

Mais il va falloir du C, non pas pour faire l’ATP puisque ce sont les protons qui s’en chargent,
mais par exemple pour faire la transamination
Ce sont des bactéries halophiles extrêmes
II/ BACTERIES CHIMIOTROPHES
Elles ont la capacité de fabriquer de l’énergie à partir de réactions chimiques, mais elles
peuvent être autotrophes vis-à-vis du carbone.
1) Chimiolithotrophes aérobies (oxydation de substrats inorganiques)
a) bactéries nitrifiantes (ou nitrogènes : fabriquent de l’azote) (pl.11)
- oxydent NH4+ NO2- (nitrite) ex : Nitrosomonas
- oxydent NO2- NO3- (nitrate) ex : Nitrobacter
On peut prendre comme exemple ces deux types d’oxydations : la première permet de
produire le substrat de la seconde à partir d’ammoniaque (venant de feuilles mortes).
Les végétaux vont utiliser les nitrites et nitrates ainsi formés.
b) Bactéries sulfo oxydantes (sulfobactéries)
- oxydent H2S S ex : Beggiatoa
- oxydent S SO42- ex : Thiotrix
c) Ferrobactéries
- oxydent Fe2+ Fe3+ ex : Thiobacillus
d) Hydrogénobactéries
- oxydent H2 H2O ex : Alcaligènes
Dans le cas de A. eutrophus, CO2 est utilisé comme source de carbone et on a donc présence
de rubisco et autotrophie vis-à-vis du carbone même s’il n’y a pas de photosynthèse. Elle est
aussi autotrophe vis-à-vis de l’azote car elle possède la nitrogénase (N2 NH4+). C’est une
bactérie très avantagée se développant à partir d’éléments disponibles dans l’atmosphère.
e) Carboxydobactéries
- oxydent CO CO2 ex : Derxia
2) Chimiolithotrophes anaérobies (réductions)
a) bactéries denitrifiantes
NO3- NO2- ex : Pseudomonas denitrifians
NO2- N2 ex : Thiobacillus denitrifians
La dénitrification est partielle (NO2-, N2O-) ou totale ( N2).
b) bactéries sulfatoréductrices
SO42- SH2 ex : Desulfovibrio
c) bactéries méthanogènes
CO2 CH4 ex : Methanobacterium
Celle-là n’a pas de rubisco par exemple.

3) Chimioorganotrophes aérobies (oxydation)
a) bactéries méthylotrophes
CH4 CH3OH HCOH HCOOH CO2
(méthane) (méthanol) (formaldéhyde) (acide formique) CO2
L’acide formique permet la synthèse de glucides. Ex : Methylonomas, Hyphomicrobium.
Le méthane est ici source de carbone et d’énergie. Il y a hétérotrophie vis-à-vis du carbone
(autotrophie = utilise le CO2 directement), même si on pourrait dire « autotrophe vis-à-vis du
carbone en utilisant le méthane comme substrat ».
b) bactéries oxydant des composés aromatiques (pl. 12)
Benzène, toluène, naphtalène… Le β cétoadipate est obtenu par dégradation de ces différents
cycles possibles, il est à l’origine de la formation de succinate et d’acétyl Coa (rentrant dans le
cycle de Krebs). Ex : Pseudonomas.
c) bactéries omnivores
Elles utilisent des glucides, des acides gras, des alcools, des acides aminés… ex : E. Coli.
4) Chimioorganotrophes anaérobies ou aérotolérants (fermenteurs)
Anaérobies strictes ou facultatives ou aérotolérantes.
- fermentation alcoolique : ce sont généralement des levures qui la font, mais des bactéries
sont aussi capables de l’effectuer, à partir de glucose on produit de l’éthanol et du CO2
(beaucoup moins favorable énergétiquement que la respiration produisant 6 CO2).
- fermentation lactique (lactobacilles) : très exploitée, production à partir de lactose de l’acide
lactique, de CO2 et d’une série d’intermédiaires (ex : acétaldéhyde). Elles sont aérotolérantes
et n’ont pas de cytochromes.
- fermentation propionique (propiobacterium) : c’est la cellulose qui est dégradée en CO2, on
observe parfois des feuilles où il ne reste que les nervures (qui sont lignifiées) indiquant la
présence de ces bactéries.
- fermentation butyrique-acétone-butanoïque : mixte, elle produit un mélange de composés.
On se sert de ces bactéries pour fabriquer de l’acétone/butanol (on s’en est servi lors
d’embargos sur le pétrole , il suffit d’avoir de la mélasse de betterave).
III/ CYCLE DE L’AZOTE
N2 atmosphérique = 80% (pl. 12)
NO2- est présent dans le sol (engrais = source exogène, ou alors produit par des bactéries), il
peut être dénitrifié uniquement par des bactéries en N2. Seules les bactéries peuvent fixer ce
N2 et on a établi le BNF (biological nitrique fixation) qui correspon à la quantité de N2 fixé
par an : 1,75. 106 tonnes ! Ceci se fait grâce à des bactéries diazotrophes (ayant la
nitrogénase).
- diazotrophes libres (seules) : autotrophes vis-à-vis de l’azote, elles ne réalisent que 10% du
BNF.
- diazotrophes symbiotiques : 90% du BNF. Elles sont bénéfiques pour les plantes, et
s’associent surtout aux légumineuses dans des nodosités : soja (Bradyrhyzobium), lusène
(Sinorhizobium), sesbania (azorhizobium), pois (rhizobium). Elles permettent d’utiliser moins
d’engrais pour ne pas polluer (nappes phréatiques, cours d’eau). Il y a une spécificité d’hôte.
Chez les plantes, on a la réduction NO3- NO2- NH4+
Seules les bactéries peuvent effectuer la nitrification en sens inverse.

De même une enzyme, la glutamine synthétase, permet d’effectuer la réaction
NH4+ acide aminé glutamine
Seules les bactéries sont capables d’extraire le NH4+ des acides aminés : ammonification.
IV/ LES STRUCTURES DE LA CELLULE BACTERIENNE
1) Principales formes (pl. 3)
Volume moyen µm3
Virus (rage)
0,0015
Mycoplasmes
0,01 à 0,1
Bactéries photosynthétiques
5-50
levures
20-50
Algues unicellulaires
5000-15000
Formes :
- sphérique : cocci
- cylindrique : bacilles
coccobacilles, diplobacilles, streptobacilles…
- spiralée (hélicoïde) : spirilles
leptospire (5 à 10 µm de long), tétraspires (15 µm de long), spirochètes (>30 µm de long)
Attention, les noms de ces formes ne sont pas des noms de genres, même si les noms de
genres ou d’espèces peuvent parfois en dériver !
2) Composition chimique moyenne des bactéries
Les bactéries sont relativement moins riches en eau que les autres organismes (seulement 70%
alors que certaines plantes dépassent 90%). Dans le poids sec (sans eau) on a 50% de carbone,
8% d’hydrogène, 20% d’oxygène et 14% d’azote.
Pl.3 : composition macromoléculaire, les protéines représentent 55% du poids sec !
Les ARNr forment des ribosomes qui sont groupés en polysomes (plusieurs ribosomes, entre
5 et 18, traduisant un même ARN)
Si on met un acide aminé marqué dans le milieu, des protéines radioactives sont produites en
moins d’une minute par E.Coli : il faut un temps de l’ordre de la milliseconde pour l’entrée
dans la cellule, et de la seconde pour la prise en charge par un ARNt et l’incorporation dans
une chaîne polypeptidique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%