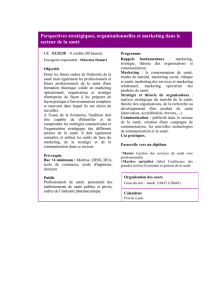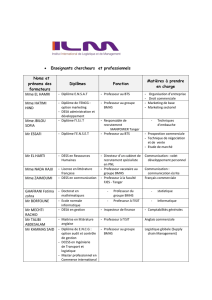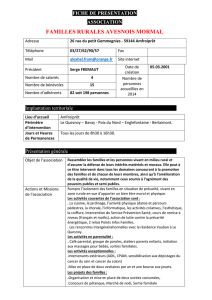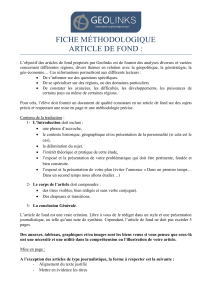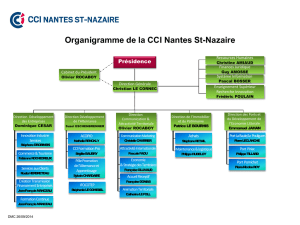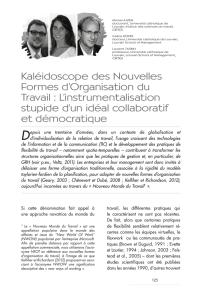fichier Word 97

Résumé : « la gestion contre l’entreprise » GUILLEMET Jean-François
Année universitaire 1998-1999 DESS Contrôle de Gestion
1
SYNTHESE
LA GESTION CONTRE
L’ENTREPRISE
De Francis GINSBOURGER Ed La Découverte - 1998
Octobre 1998

Résumé : « la gestion contre l’entreprise » GUILLEMET Jean-François
Année universitaire 1998-1999 DESS Contrôle de Gestion
2
SOMMAIRE
SOMMAIRE 2
INTRODUCTION 3
I- LE TRAVAIL DENATURE 3
A- PROVENANCE DU DENIGREMENT DU TRAVAIL 3
B- QUELQUES INITIATIVES POUR FAIRE EVOLUER LES MENTALITES 4
1- LES NFOT 4
2- LA FORMATION QUALIFIANTE 4
3- L’EXPLOSION DE L’ORGANISATION TAYLORIENNE 5
II- CONSEQUENCE SUR L’EMPLOI 6
A- LE TRIOMPHE DE LA PRECARITE 6
B- LES MAUVAISES LUTTES 7
1- LES LOIS AUROUX 7
2- FORMATION EXCLUANTE 8
III-VERS UNE MISE EN VALEUR DU TRAVAIL 10
A- MODIFIER LES MENTALITES « TAYLORIENNES » 10
B- VERS DE NOUVEAUX OUTILS DE GESTION 10
C- ET LES 35 H ? 11
CONCLUSION 12

Résumé : « la gestion contre l’entreprise » GUILLEMET Jean-François
Année universitaire 1998-1999 DESS Contrôle de Gestion
3
INTRODUCTION
La gestion et l’organisation font la plupart du temps bon ménage au sein de l’entreprise. La
première indique au second les grandes orientations à prendre en fonction d’indicateurs
comptables et économiques. Le problème est que le travail, à vocation sociale et humaine,
passe lui aussi à la moulinette des chiffres. Les 2 orientations diamétralement opposées font
que la dimension, la vision du travail purement économique dévalorise celui ci et oblige les
dirigeants à, sans cesse, comprimer ce poste comme un vulgaire poste de charge.
Francis GINSBOURGER (économiste et initiateur de programmes de recherche au Ministère
de la Recherche et de la Technologie) nous présente dans cet ouvrage comment cette pensée
minimaliste a émergé, crue et s’est imposée comme le mode de pensée productif par défaut.
Faire du travail une variable productive comme les autres est une notion largement partagée et
induite. Nous étudierons donc d’où provient cette dénaturation de la fonction « travail » ; nous
en verrons également la conséquence principale ainsi que les mesures à prendre dans l’avenir
pour changer cette perception négative.
Cet ouvrage a été réalisé pour faire évoluer les mentalités d’une vision productive du travail
vers une vision bipolaire alliant impératifs économiques des firmes et désir de reconnaissance
des salariés. Car ceux-ci ne doivent plus être considérés comme une charge mais comme une
ressource pour l’entreprise.
I- LE TRAVAIL DENATURE
A- Provenance du dénigrement du travail
Toutes les décisions prises au sein de l’organisation sont sous influence des outils de gestion.
Ceux-ci, par leur « ancienneté » et leur statut de référence, permettent de se forger rapidement
une opinion. Il y a donc une standardisation des comportements autour de ces outils. Personne
ne songe à les modifier, les améliorer (même s’ils sont inadaptés à la réalité) par manque de
temps. De plus, les dirigeants et les cadres sont eux mêmes jugés sur leurs résultats immédiats
et visibles. Résultats qui sont mis en valeur par ces mêmes outils de gestion. Modifier ces
processus amènerait à reconsidérer les mécanismes de réflexion au sein de l’organisation.
Se complaire dans l’immobilisme arrange, en fait, tout le monde car chacun y trouve son
compte. Les dirigeants peuvent conserver leur pouvoir grâce à des mécanismes depuis
longtemps maîtrisés et « cisaillés » à leur goût. Et les exécutants s’accommodent de ces
contraintes puisqu’ils ont appris, au fil du temps, à y aménager des espaces de liberté. En
période normale, pas question de remettre en cause l’ordre établi. Les outils de gestion
conditionnent, donc, de façon inconsciente, les comportements, les opinions et les décisions
au sein de l’organisation.
Et c’est en raison de ces mécanismes et de leur rigidité que le travail, quelque soit son niveau
dans l’entreprise (du cadre à l’ouvrier) est toujours présenté comme un coût, notamment dans
sa comptabilité générale. Le travail est présenté à travers ce qu’il coûte et non ce qu’il
rapporte.
Mais les jugements ne sont pas, tout de même, identiques selon le niveau. L’ouvrier n’est
qu’un coût, le cadre, lui, est un coût mais, du fait qu’il siège dans les instances de décisions,
sa dimension est totalement différente. Les ouvriers, par la faiblesse de leur bagage, leur
manque de formation, souffrent d’une lacune d’attributs pour revendiquer une valeur positive
suffisante à une meilleure considération (le travail est quantité et non qualité).

Résumé : « la gestion contre l’entreprise » GUILLEMET Jean-François
Année universitaire 1998-1999 DESS Contrôle de Gestion
4
Ce manque de valorisation fait que les ouvriers du « bas de l’échelle » sont peu et/ou mal
représentés. Comme pour beaucoup de choses, ils sont en fait pris en charge trop tardivement,
et souvent les seuls organes de représentation se manifestent au moment des programmes de
licenciement.
Cette perception négative des salariés par les entreprises les enferme dans une sorte de
« ghetto » où on leur confie peu ou prou de responsabilités et que l’on a renoncé à intégrer.
Cette catégorie d’emplois n’a qu’une considération volumique et n’a d’intérêt que par sa
productivité.
Il ne faut donc pas compter sur les outils de gestion pour améliorer la perception du travail.
Mais de bonnes volontés ont tenté de faire évoluer les choses. L’auteur présente quelques
unes des initiatives. Initiatives qui visent à redorer le blason des travailleurs mais qui se sont
heurtés à des freins organisationnels.
B- Quelques initiatives pour faire évoluer les mentalités
1- Les NFOT
La première de ces initiatives citées par l’auteur provient de l’ANACT (Agence Nationale
pour l’Amélioration des Conditions de Travail) qui s’est fixée pour but d’analyser les traits
qui caractérisent les expériences de réorganisation du travail. L’intérêt pour les dirigeants est
de proposer des expériences visant à améliorer les conditions de travail afin d’éviter des
conflits onéreux pour l’organisation. Ces propositions sont, en fait, réalisées au travers des
NFOT (Nouvelles Formes d’Organisation du Travail).
Le but des NFOT développées est d’optimiser la fonction du travail, afin d’améliorer la
qualité des produits et services rendue indispensable par la concurrence des marchés. Les
entreprises qui expérimentent le plus les NFOT sont les entreprises dont l’activité est
fortement dépendante de l’homme : activités d’assemblage, relation clientèle…
Selon l’ANACT, les entreprises ayant de mauvaises conditions de travail sont sujets à des
« coûts cachés » : absentéisme, turn over, coûts de non qualité. D’où l’intérêt de ces
expériences.
Malheureusement, les avantages des NFOT ont du mal à se faire sentir en raison de la rigidité
des outils de gestion mal adaptés à mettre en avant les points positifs et bienfaisants. Au
contraire, ces mêmes outils font apparaître des coûts tangibles et indispensables, dus à
l’instauration des NFOT. En effet, les systèmes de gestion connus sont basés sur les coûts
mais ne peuvent prendre en compte de critères qualitatifs. Donc, les outils font apparaître les
coûts « non cachés » indispensables à l’instauration des NFOT (réorganisation des ateliers…)
et ne prennent pas en considération la minimisation à terme des coûts cachés. Le bilan
« comptable » apparaît donc comme négatif pour les NFOT alors que l’amélioration des
conditions est évidente.
2- La formation qualifiante
La deuxième initiative citée par l’auteur repose sur le projet de Bertrand Schwartz, chercheur
à l’ANACT, visant à rapprocher l’enseignement de l’expérience, la théorie de la pratique, et
d’offrir des actions de formation même au plus « démunis » afin de réduire les écarts et de
redonner une légitimité aux travailleurs.
Celui-ci prône en fait la formation en alternance, puisque c’est, pour lui, le meilleur moyen
d’allier la théorie à la pratique. En plus de cela, il faut que la formation soit qualifiante et non
qualifiée, car celle ci, à l’inverse de la première, est figée et répétitive. Le formé peut faire
évoluer une formation qualifiante grâce à des compétences propres.
Il existe en fait, 3 clés de réussite des formations :

Résumé : « la gestion contre l’entreprise » GUILLEMET Jean-François
Année universitaire 1998-1999 DESS Contrôle de Gestion
5
- que la formation parte de ce que savent faire les personnes (pas de
programmes préfabriqués),
- que l’organisation du travail ne soit pas rigide et permette
l’initiative ,
- il faut que le formé se base sur la théorie acquise en salle de classe.
La qualification est également un double enjeu pour l’entreprise :
- enjeu de justice sociale et donc d’équilibre sociétal,
- enjeu d’efficacité productive.
Le but pour l’entreprise, est donc, par la formation de baisser les coûts de non qualité et
d’impliquer chaque Homme dans l’atteinte d’objectifs. Cela va évidemment à l’encontre du
modèle taylorien. Avec la diversité des produits, la qualité recherchée, les travailleurs à la
chaîne doivent être en mesure d’intervenir et ne doivent plus être « passifs ». On demande
donc plus d’autonomie, de responsabilités ; et c’est la formation qui permet d’atteindre cet
objectif et de remplir son rôle « d’élévateur social ». Grâce à ce type de formation, le salarié
prend une autre dimension dans l’entreprise et occupe une place plus valorisante par sa
capacité à intégrer et à participer à l’expansion de la société.
Le problème de ces opérations de formation est, qu’une nouvelle fois, les bonnes volontés et
les multiples expériences de qualification du travail se sont heurtées à la rigidité et à
l’immobilisme des organisations. Car développer ce genre d’opération (cercle de qualité,
formation, entretien de groupe..) nécessite une totale implication de l’organisation et une
remise en cause de ce qui a été établi depuis des années. Au bout du compte, bon nombre
d’expériences de formation et de participation des salarié, n’ont pas apporté de changements
notables et intéressants, par manque de réelle volonté de chacun. Elles n’ont surtout pas
permis d’augmenter l’efficacité des services et sont la plupart du temps restées lettres mortes.
3- L’explosion de l’organisation taylorienne
La troisième et dernière initiative présentée par l’auteur provient des réflexions de Jean
Gandois. Sa dénonciation est la suivante : au sein de l’organisation règnent des outils de
gestion inadéquats et que celle-ci est encore trop largement inspirée du modèle taylorien. En
effet, selon l’ancien patron du CNPF, le modèle taylorien est à l’heure actuelle le seul à
encore maintenir le travailleur dans une sorte de « cage intellectuelle et sociale ». Pour lui, la
solution, pour que le travailleur soit mieux perçu et donc plus efficace, est de faire exploser ce
modèle, inadapté à nos économies et tombé en désuétude avec l’explosion des services.
Les modifications dans les organisations de type taylorien sont indispensables et doivent être
prises en main par les salariés eux mêmes. Il faut en effet, absolument qu’ils participent à ce
qui les concerne sinon une mise de côté serait synonyme d’échec et de conflit social.
Mais encore une fois, chaque initiative est difficile à mettre en place pour plusieurs raisons :
- beaucoup se contentent d’appliquer ce qu’ils ont appris lors de leur formation
initiale et ne veulent pas se risquer à telle ou telle initiative. Ils restent ainsi
figés dans leur poste, dans leur fonction. Il faut donc privilégier une formation
de base, complétée par la pratique « sur le tas » et ne pas être aveuglé par les
diplômes.
- La rigidité des postes de direction, de contrôle et des outils de gestion fait que
les personnes « haut placées » dans l’organisation n’aiment pas s’entendre dire
des vérités et se voir contredire (sur des méthodes de calcul par exemple),
- Enfin, le pouvoir du savoir exclu les non techniciens ne parlant pas le même
langage « châtié » (ainsi l’ingénieur négligera ou sous estimera les réflexions
de l’OS sous prétexte de non expertise).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%