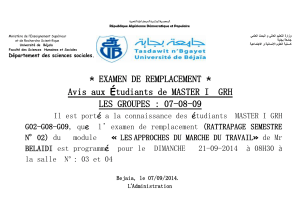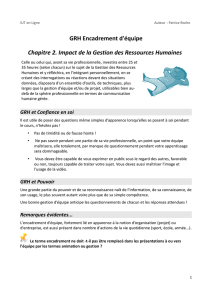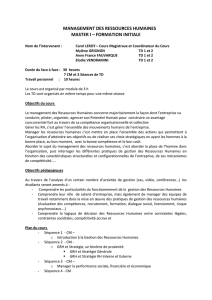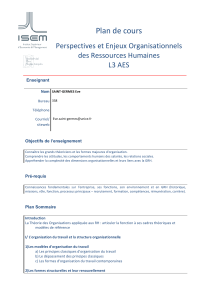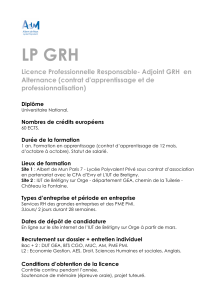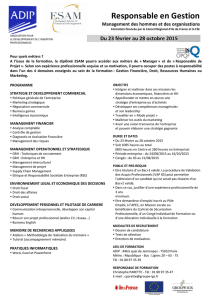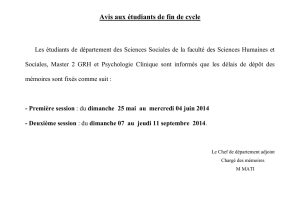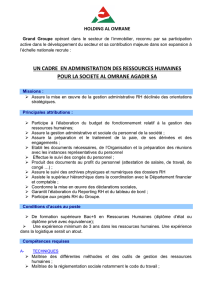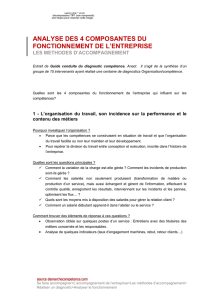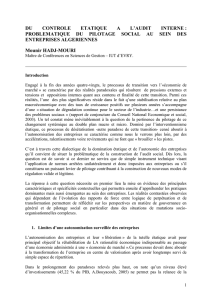Chapitre 1

1
« Je connais le monde, le monde m’appartient »
Balzac
Introduction générale
La guerre du savoir a commencé, écrivait Baumard (1999 :61). Les organisations
se différencient désormais par leur capacité à créer de nouvelles connaissances et
à mobiliser l’intelligence et l’imagination de leurs ressources humaines (Parent et
al., 2007). Leur avantage concurrentiel est tributaire de leur aptitude à se
construire des savoirs et des savoir-faire distinctifs, à renouveler leurs idées et
pratiques au regard d’un environnement continuellement en mouvement. Dans
un marché marqué par la compétition où le changement est devenu la règle et la
stabilité l’exception, la connaissance est considérée aujourd’hui, pour l’ensemble
des théoriciens et des praticiens du management, comme la ressource refuge ; un
levier de développement essentiel. Pour Jacob et Pariat (2000 : 7), elle est « le
carburant de la nouvelle économie » et pour nombreux experts, c’est le seul
véritable avantage compétitif qu’une organisation peut s’approprier face à ses
concurrents.
La connaissance est ainsi devenue non seulement une capacité pour entamer les
difficultés et résoudre les problèmes rencontrés mais aussi un substrat crucial
pour l’efficience et le développement de l’entreprise. Objet, à la fois, productif et
de production, la connaissance se déploie et en même temps se renforce et
s’enrichit. Dans un procès dynamique, elle autorise la production et se reproduit.
L’exploitation du savoir devient ainsi source de création de richesse et
d’expansion. De nouvelles approches de connaissance voient le jour, de
nouvelles manières de faire apparaissent. Aujourd’hui, l’économie du savoir est
une activité économique à part entière. Dans cette nouvelle économie, la
connaissance y est prépondérante et parmi les facteurs de production : capital et
travail, elle est la ressource la plus prometteuse ; la plus féconde. Dans les
entreprises à haute valeur immatérielle, en effet, « la part du capital intangible
dépasse celle du capital tangible dans le stock réel de capital » écrivait Foray
(2000 : 3).
L’avènement de l’économie de la connaissance et son importance grandissante
dans la création de la valeur ont suscité, tout au long des deux dernières
décennies, l’intérêt de nombreux analystes et fait l’objet de plusieurs recherches
et investigations. Les premières conceptualisations de cette nouvelle économie
ont été toutes marquées par les questions afférentes à la production et
l’acquisition du savoir. Elles ont été entreprises essentiellement par les grandes

2
institutions de recherche et d’éducation. Depuis, la recherche sur l’économie de
la connaissance se trouve progressivement élargie pour intégrer d’autres
dimensions en rapport plus ou moins direct ou indirect avec son développement
et les conditions de son renforcement. Ainsi, plusieurs recherches prennent
aujourd’hui pour analyse diverses questions telles que les processus
d’apprentissage, la formalisation et la conservation des savoirs, les méthodes de
leur transfert, la détection des meilleures expertises et pratiques, la protection et
le développement des compétences, etc. Plusieurs, parmi ces recherches,
voulaient voir les rapports d’interférence entre le contexte organisationnel et
l’ensemble des savoirs produits et partagés. Comment au sein d’une organisation
donnée, les acteurs, à travers leurs interactions quotidiennes, s’échangent-ils
leurs expériences et mettent-ils en partage leurs expertises ? Une telle orientation
a donné lieu à une abondante littérature portant sur l’apprentissage
organisationnel, l’organisation apprenante et plus récemment la gestion des
connaissances.
L’avènement et le développement de l’économie du savoir ont poussé les
organisations à focaliser leurs intérêts sur leurs activités immatérielles et à
structurer leurs fonctions pour servir et tirer profit de leurs richesses
immatérielles. L’entreprise doit ainsi chercher à développer et protéger ses
connaissances ; à favoriser les mises en réseau pour créer une dynamique
d’innovation, bref, la gestion des connaissances est devenue pour plusieurs
entreprises, une pratique managériale déterminante. Ainsi, toutes «les pratiques
visant la création, l’acquisition, le partage et l’application des savoirs afin
d’autoriser l’apprentissage et la performance des organisations » (Scarbrough,
1999 : 18) sont devenues des maîtres mots pour les entreprises et des principes de
conduite incontournables pour les gestionnaires. Appliquer les connaissances au
travail, accéder aux nouvelles connaissances, les mettre à la disposition de tous
les utilisateurs, les actualiser et les améliorer constamment…, telles sont les
principales actions nécessaires pour entamer et réussir une gestion des
connaissances1.
Outre son importance dans l’équation de la compétitivité, la gestion des
connaissances serait aussi en mesure de remédier aux dysfonctionnements en
matière de gestion du capital intellectuel. Une gestion efficiente des savoirs
présume que les organisations, pour ne pas se retrouver contraintes à les
réinventer continuellement, doivent pouvoir les sauvegarder et les mettre, à
chaque fois qu’il est nécessaire, à la disposition de l’ensemble des utilisateurs.
Sans une gestion adéquate, l’entreprise sera dans l’obligation de recourir à des
expertises externes ou à retracer le parcours historique de leur fonctionnement.
1 Les termes de gestion des connaissances, gestion des savoirs, management des connaissances et
knowledge management renvoient à la même signification. Nous les utilisons de manière
indifférenciée.

3
La déperdition des expertises par oubli ou simplement en raison de
comportements claniques et territoriaux chez certains experts, serait source de
dépense et de gaspillage (Jacob et Pariat, 2000).
L’adoption de la gestion des connaissances par les organisations s’est faite selon
des perspectives très diverses. Dans certains cas, la gestion des connaissances est
mobilisée pour identifier les ressources porteuses d’expertise dans l’organisation.
Plusieurs organisations de grande taille éprouvent en effet du mal à les identifier
et les préciser. Elles s’en trouvent ainsi privées d’un capital d’intelligence qui
échappe à leur contrôle et qui peut être copié ou encore spolié par les concurrents
(O’Dell et Grayson, 1998 ; Ballay, 2003). Face à de tels risques, la gestion des
connaissances intervient pour cartographier les savoirs et les sources d’expertises
internes, en les formalisant, les stockant en vue d’assurer leur protection.
Dans d’autres entreprises, le management des connaissances vise à développer
simultanément les capacités de partage et de création des connaissances. En
intervenant sur les deux plans, en même temps, les organisations espèrent
motiver leurs collaborateurs à partager horizontalement leurs connaissances et
expertises. En deuxième lieu, elles cherchent à développer les capacités
d’innovation de l’entreprise en structurant les processus de création des savoirs.
A ce niveau, l’entreprise tente de réunir les conditions techniques et humaines
nécessaires pour permettre l’extériorisation des connaissances tacites des
membres de l’entreprise et leur mise en commun afin de déclencher une
dynamique d’innovation collective (Geisler, 2007).
Enfin, certaines entreprises considèrent que les pratiques de gestion des
connaissances sont l’une des solutions possibles aux problèmes de perte de
compétences et d’expertises. Confrontées à des phénomènes de turnover
fréquents sous l’effet conjugué des pratiques de downsizing et de la mobilité
croissante des travailleurs intellectuels, plusieurs organisations se voient
incapables de retenir les porteurs d’expertises parfois cruciales et choisissent
d’orienter leurs pratiques de gestion des connaissances vers la pérennisation du
capital intellectuel acquis (Aramburu et Saenz, 2007).
La connaissance et les tentatives d’un enracinement techniciste
La pertinence de la question du knowledge management pour les théoriciens et
pour les managers sur le terrain est aujourd’hui évidente. Depuis la publication
en 1991 de l’article fondateur du japonais Ikujiro Nonaka sur l’entreprise
créatrice de savoir, la recherche sur le management des connaissances s’est
constamment enrichie par de nombreux travaux conceptuels et diverses
investigations sur le terrain. Le management des connaissances est devenu un

4
objet de recherche central et une problématique constamment sollicitée dans les
sciences de gestion.
Cependant, en dépit de l’intérêt constant pour cette thématique, la lecture de
l’ensemble de la production théorique révèle une orientation plutôt techniciste de
la recherche. La littérature sur le knowledge management foisonne d’ouvrages et
de discours dont l’empreinte est, à notre avis, essentiellement instrumentale.
Dans la plupart de ces écrits, l’intérêt a été souvent focalisé sur l’importance des
systèmes d’information et des technologies de communication sur la production
et le développement des connaissances, sur leurs répercussions « salutaires » sur
la conduite et le contrôle des organisations. Dopées par une industrie du conseil
en pleine euphorie, les organisations se laissent rapidement séduire par
l’introduction et la mise en place d’outils techniques et de démarches formalisées
pour gérer leurs connaissances. Les systèmes informatiques, les répertoires
électroniques, les pages jaunes, les dispositifs de retour d’expériences, les
référentiels normatifs et bien d’autres procédures et instruments ont vu le jour
avec pour seule fin la codification et le stockage des informations et des
expertises de l’organisation.
L’approche techniciste, formée par l’ensemble des outils, instruments,
procédures formelles et systèmes informatiques, considère que c’est la
formalisation qui autorise l’utilisation et le développement des connaissances.
Cette approche est représentée par trois écoles : l’école des systèmes, l’école de la
cartographie et l’école de l’ingénierie de la connaissance. L’ensemble des adeptes
de ces écoles considère que les TIC sont essentielles à l’acquisition de nouvelles
expertises et à l’enrichissement des expertises individuelles et collectives. Ainsi,
la connaissance n’est plus l’apanage des humains et de leur mise en organisation,
elle est principalement l’œuvre des systèmes. « Le paradigme de l’ordinateur »,
selon l’expression de Varela (1989 : 12), devient aujourd’hui une réalité de plus
en plus probante. Par le biais de l’intelligence artificielle et des systèmes experts,
la « machine » est désormais capable de simuler des raisonnements complexes et
pertinents, d’accroître les connaissances et d’aider à la prise de décision, soutient
Pirat (1987).
Problématique et question de recherche
En dépit de l’importance cruciale de l’informatique et son développement
extraordinaire dans le domaine du knowledge management, plusieurs voix
s’élèvent aujourd’hui, dans un mouvement de balancier de plus en plus fort,
pour rappeler les multiples écueils d’une telle approche et les nombreux échecs
qu’ont connu les démarches technicistes de la gestion des savoirs (Grimand,
2006 ; Christensen, 2007). De plus en plus de décideurs sont déçus par les faibles
retours sur investissements que les techniques et systèmes de gestion des

5
connaissances ont finalement généré (Mc Dermott, 1999). Par delà les pétitions de
principe et l’évocation consommée de success stories, les retours d’expérience
restent souvent décevants : intranets ou portails de connaissances sous-exploités,
forums de discussion désespérément vides, réticence des experts à partager leur
savoir-faire et prégnance des logiques de territoire, désintérêt pour les
connaissances acquises et mises en commun, etc. (Grimand, 2006). Dans ce
mouvement de questionnement critique, plusieurs auteurs se demandent si cet
excès de « technicisation » de la gestion des connaissances n’a pas en définitive
porté préjudice à la connaissance ? Si le formatage des savoirs et le partage
canonisé des savoir-faire ne sont à l’origine d’une véritable désaffection à l’égard
d’une telle gestion ?
L’enracinement du management des connaissances dans un registre techniciste
est porteur d’écueils pour son développement et d’inefficience dans ses résultats
et finalités. Selon la logique techniciste, l’outil serait investi d’une force
autonome ; il n’a besoin ni d’être contextualisé, ni d’être approprié par les
opérateurs. Il traduit ainsi sa propre volonté. Ses injonctions sont atemporelles et
son mode de faire décontextualisé. L’acteur est simplement utilisateur. Il est
autre et entretient avec l’instrument un rapport d’extériorité. Etranger à son
travail, ses comportements sont le produit d’une prescription extérieure. C’est un
acteur désincarné, sans désirs, buts ou stratégies. L’ordre techniciste uniformise
les différences et conforme les agir. Il inhibe toute alternative de faire autrement,
de modifier la trajectoire de l’action.
La logique instrumentale évacue dans les procès de gestion des savoirs toutes les
questions relatives au vécu social, à la coopération, au pouvoir, aux interactions,
bref à la gestion des ressources humaines, à la structuration des facteurs et au
contexte de l’action. Pourtant, la connaissance est une production sociale. Son
déploiement et ses mouvements s’inscrivent totalement dans les rapports inter
sociaux. Evacuer les ressources humaines et le contexte de leur action porterait
préjudicie à la connaissance et son devenir.
Parce que la connaissance est le produit renouvelé d’acteurs sociaux situés, le
management de la connaissance, loin de se contenter des approches et
instruments technicistes, doit principalement tenir compte des acteurs et de leur
mise au travail. De la manière de les commander, organiser, conduire et
contrôler. Dans ce cadre, notre question de recherche sera posée comme suit.
La gestion des ressources humaines est-elle un levier essentiel dans la gestion
des connaissances ?
Autrement formulée, nous chercherons à voir dans ce travail si la manière de
manager les RH a de l’effet sur les processus de création, de partage et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
1
/
295
100%