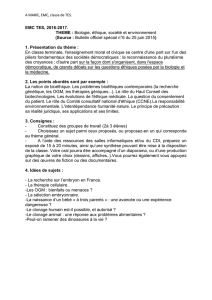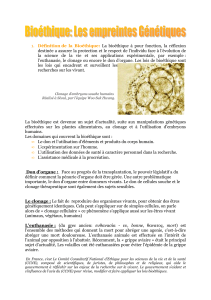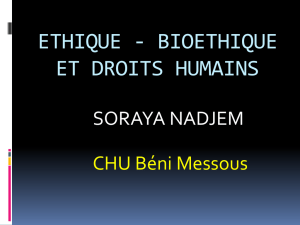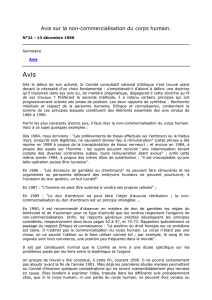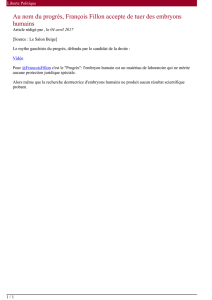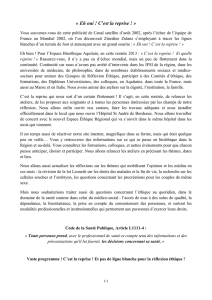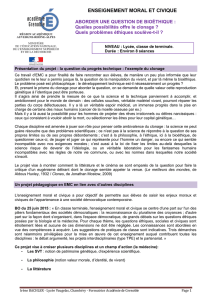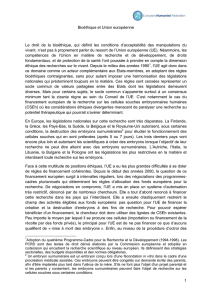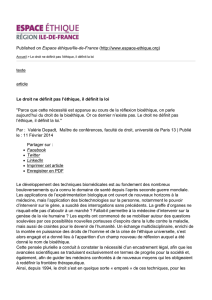Bioéthique 2008 - Science, éthique et société

Bioéthique 1 16/04/17
Science, éthique et société
Michel Juste
01/11/2008
La bioéthique
Objectifs :
Comprendre le concept d’éthique.
Faire le lien avec les notions philosophiques de base
Savoir ce qu’est une démarche éthique
Apprendre quelques notions scientifiques sur la PMA et en lien avec la bioéthique
1- Définitions et fondements de l’éthique
Ethique, morale et déontologie.
Philosopher c’est penser sa vie et vivre sa pensée : André Comte-Sponville.
Personne ne peut philosopher à votre place, mais l’éthique est encore différente : ce
n’est pas une science – la philosophie non plus – mais plutôt un choix, un jugement
que chacun peut faire. La philosophie est une aide pour celui qui veut avoir une
démarche éthique, mais il ne trouvera nulle part la solution au problème posé.
Alors comment avoir une réflexion éthique ? Est-elle réservée à une élite ou sinon
exige-t-elle la maîtrise de notions complexes ?
Il n’existe pas de définition précise du mot éthique et l’on y met beaucoup de
choses : il faut néanmoins distinguer l’éthique de la morale et de la déontologie.
1) La morale correspond à une discipline donnée par la société, sur des fondements
socioculturels (« Que dois-je faire ? »). Elle correspond aux valeurs de devoir,
d’universalité et de vertu. On peut aussi la concevoir comme une nécessité de
bienveillance et de bienfaisance vis à vis d’autrui.
2) La déontologie correspond à une discipline donnée par une profession, pour ses
rapports avec ses clients et ses collaborateurs.
3) L’éthique correspond à une discipline donnée par soi-même. Elle correspond à
une réflexion critique sur les comportements : l’éthique est d’abord un acte, une
manière de faire face immédiatement à une solution. Il s’agit bien sûr d’une
réflexion personnelle que l’on s’impose, mais qui doit déboucher sur une action.
Certains auteurs l’ont traduit comme une morale personnelle de l’action
(« Comment vivre ? ») ou comme ce que l’on estime être bon pour soi.
On pourrait aussi dire que l’éthique est un comportement propre à l’homme et qui le
tire vers le haut.

Bioéthique 2 16/04/17
L ‘éthique médicale est devenue la bioéthique : elle s’occupe plus
particulièrement des réflexions concernant les sciences de la vie.
Actuellement, la science nous apporte un savoir considérable qui risque de devenir
incontrôlé si on n’y prend garde.
Or certaines techniques médicales actuelles ont été qualifiées de « culture de mort »
par le Vatican en 1995.
L’éthique, et la bioéthique plus spécifiquement, se base donc sur des valeurs de
vérité.
L’éthique est le fait de tout le monde et personne ne peut s’accaparer une réflexion,
ou s’estimer plus compétent qu’un autre.
L’éthique signifie donc réflexion, cohérence et action.
En milieu médical, on retiendra le serment d’Hippocrate, le serment de Galien, le
Code de Nuremberg en décembre 1947 et la déclaration d’Helsinki. Le code de
Nuremberg, texte fondateur pour le XXème siècle, établit notamment le principe du
consentement libre, exprès et éclairé ; il affirme l’autonomie des malades et son
respect par les médecins.
Cette éthique repose sur 3 grands principes :
Le respect de la dignité de la personne de l’être humain.
Le respect de la connaissance et des réelles compétences
Le refus du lucre, c’est-à-dire de l’appât du gain.
Il existe encore d’autres valeurs fondamentales : l’universalité, l’autonomie, la justice
de répartition, la non-malveillance.
L’universalité signifie que les droits et les devoirs doivent s’appliquer à tous sans
restriction, l’autonomie signifie que chaque humain doit pouvoir décider de lui-même
de son avenir et de sa façon de vivre, la justice de répartition signifie que les biens
doivent être partagés entre tous de façon équilibrée et juste sans favoritisme, la non-
malveillance signifie que les actions humaines doivent être réalisées en tenant
compte des risques et toujours de façon à minimiser les incidents et problèmes,
même involontaires.
Rapports état individu
La notion d’éthique peut présenter des variations entre les pays, variations dues
essentiellement à des conceptions différentes des rapports état individu.
Aux Etats-Unis, l’individu est la valeur première et il existe 2 principes clés :
L’état s’abstient de s’immiscer dans la vie des individus.
Le principe d’égalité permet la protection de la liberté de l’individu.
La liberté passe avant l’égalité (au contraire du cas de la France par exemple).
Les lois européennes procèdent essentiellement de la reconnaissance de la dignité
de la personne humaine, qui va au-delà de l’individu.

Bioéthique 3 16/04/17
Cette dignité peut induire des restrictions aux libertés individuelles, dissociables des
exigences collectives (limitation des ventes d’organes…).
Le rapprochement Europe et Amérique n’est pas encore complet, ce qui peut
expliquer des divergences. L’enjeu est représenté par les droits de l’homme.
Conséquentialisme et non conséquentialisme
Le conséquentialisme base les actions en fonction d’un résultat (conséquence) qu’il
soit favorable pour la personne ou pour le plus grand nombre.
Le non-conséquentialisme, sous la forme de la morale kantienne, repose ses
principes sur les notions de dignité de la personne et sur le principe d’universalité.
Prométhée, Faust, Frankenstein et les autres…
Je reprendrais volontiers le mythe de Frankenstein qui explique parfaitement
l’inquiétude de l’humanité face à la connaissance. La science actuelle, et la
technologie tout particulièrement, nécessite une éthique qui empêche le pouvoir de
l’homme de devenir une malédiction pour lui-même.
L’homme a peur aujourd’hui d’un « Hiroshima cellulaire ». En effet, la biologie
moderne, et la génétique, est supposée s’attaquer à l’homme et le transformer.
Y aurait-il des « connaissances interdites » ou des « crimes du savoir » ? L’éthique
ne peut se résumer à des règles ou à une fidélité envers des textes, il s’agit de
s’interroger à la fois sur la nature du mal et sur la perspective du bien, sans tomber
dans le manichéisme.
Une autre façon de mieux identifier la bioéthique et de mieux la comprendre est de
rechercher ses racines (Pierre-André Taguieff) :
- La chrétienté et l’église catholique : Dieu a créé les hommes à son image, la
vie humaine st donc sacrée. Il existe donc des interdits aux 2 extrêmes de la
vie (conception, mort). Le livre de la Vie (le génome) est lui aussi sacré et
donc intouchable.
- La position écologique issue de la « deep ecology ». Tout est lié, tout est
sacré. Ce n’est pas la vie humaine qui est sacrée mais la vie en tant que telle.
- L’humanisme, position située entre les 2 précédentes. L’homme est un dieu
pour l’homme, qui doit améliorer ses facultés et son bien être en maîtrisant la
nature d’un point de vue technoscientifique.
Dérives possibles :
- La passion scientifique : le désir d’ être performant, de réussir, d’établir sa
notoriété.
- L’intérêt de la recherche pour le reste de l’humanité : dérive utilitariste qui
pousse à rechercher un objectif jugé noble mais sans tenir compte des
valeurs de base.
- La sous-estimation du niveau du sujet comparé au bénéfice des autres :
pratique de la recherche au détriment de certains individus ou groupes
d’individus, qui ne sont pas considérés à un niveau égal à celui des
bénéficiaires potentiels.

Bioéthique 4 16/04/17
- La performance financière : élément économique qui motive les sociétés, en
utilisant souvent des effets d’annonce pour améliorer leur image et leur
rentabilité.
Limites et frontières.
Philosophie : l’éthique alimente la philosophie et les progrès de la biologie
inspirent de nouvelles réflexions.
Théologie : il y a des tensions possibles, notamment sur les techniques touchant
à la reproduction.
Politique : il y a un grave risque d’abus en cas d’échanges non surveillés. Des
affirmations non vérifiées peuvent devenir des dogmes qui peuvent e^être repris
par des dictateurs . dans l’autre sens, les politiques peuvent utiliser des médecins
pour exécuter des actions qu’ils souhaitent.
Droit : passage de l’éthique au droit dans certains cas (lois de bioéthique). La
dernière loi de bioéthique date du 6 août 2004. Il s’agit d’une mise à jour de la loi
de 1994. L’éthique peut-elle légiférée ? Non, la loi est là pour fixer des limites et
non pour définir l’éthique.
Géographie : il existe des différences culturelles, spirituelles, médicales et
économiques qui vont faire varier le sens des réflexions.
Economie : l’argent limite-t-il la réflexion éthique ?
2- Ethique médicale et progrès thérapeutique
L’eugénisme.
Cette dérive correspond à la mise en œuvre de politiques volontaires d’amélioration
des sociétés humaines. Son but est de limiter la diffusion des mauvais gènes dans la
population.
Elle est d’autant plus facile à mettre en œuvre que les progrès de la génétique se
font, aussi la génétique est devenue un domaine très sensible.
L’eugénisme refait parler de lui car les moyens techniques existent : le risque de
dérive est réel car ce qui interdit à un endroit peut être fait ailleurs. Les frontières
« éthiques » sont très fragiles : peut-on définir des caractères génétiques
inacceptables ? quelle maladie doit-on éviter par avortement ? Peut-on choisir les
caractères génétiques de ses enfants et lesquels ?
Maladies et médecine prédictive.
Pour les maladies, on peut ranger les maladies sur une échelle virtuelle :
A gauche, les affections presque totalement déterminées par l’altération d’un
gène.
Un peu à droite, les maladies très dépendantes de l’altération d’un gène, mais
dont la pénétrance n’est pas totale (cancer du sein, cancer du côlon)
A droite, les affections communes en partie déterminées par la constitution
génétique (par plusieurs gènes) mais en grande partie par les habitudes de vie et
par l’environnement (hypertension artérielle, certains cancers, le diabète…).

Bioéthique 5 16/04/17
Tout à droite : les maladies sans fondement génétique, toxiques ou accidentelles
Pour les affections possédant des déterminants génétiques, la partie de la médecine
qui s’en occupe s’appelle la médecine prédictive (attention, prévoir ne permet pas
toujours de prévenir : il ne s’agit donc pas de médecine préventive).
Ce principe de prévision, basé sur l’étude génétique, semble idéal. Mais tout prévoir
n’est pas forcément éthique : une prévision qui débouche sur une impasse
thérapeutique n’a pas d’intérêt médical.
Il faut faire attention à des dérives possibles, notamment la reprise de données
génétiques pour d’autres objectifs : assurances, sélection à l’emploi, prêts
bancaires… (voir le film Bienvenue à Gattaca).
3- Enjeux éthiques de la génétique et de la médecine.
Les caractéristiques génétiques ont une valeur symbolique très forte : elles
véhiculent à la fois un passé, un état (représentation de soi), et un avenir
(descendance). Toute nouveauté importante tant soit peu médiatisée va entraîner
des réactions pas toujours bien informées.
Le clonage reproductif.
C’est un vieux mythe. Surtout le clonage humain.
Le point de départ est l’annonce de la naissance de Dolly le 23 février 1997 : une
brebis clonée par une technique de manipulation génétique associant micro-injection
et clonage.
Cette technique est très prometteuse car elle a une portée économique et
scientifique indéniable. Néanmoins, la technique de micro-injection a un rendement
très faible (moins d’un demi pour mille).
Quelques mois plus tard, Polly est née : c’est une brebis née aussi par clonage mais
dotée d’un gène humain.
Il est donc possible de créer des animaux transgéniques en intégrant dans leur
patrimoine héréditaire un ou plusieurs gènes étrangers. Ceci est un grand espoir
pour la pharmacologie car elle peut faciliter la production de protéines humaines.
Les techniques n’en sont encore qu’à leur début ; la micro-injection est déjà
remplacée par la recombinaison homologue.
Depuis on a cloné des souris , des chats (Carbon Copy, Little Nicky), une vache, un
mulet, un cheval (Promethea), un chien.
Malheureusement la technique n’est pas encore parfaite. A côté d’un rendement très
faible, on a aussi découvert des ratés : Dolly a de l’arthrose, les souris sont
devenues obèses et ont des troubles cardiaques. Le petit chat va bien.
La question est bien sûr de savoir si un clonage humain est possible. Techniquement
il le sera sûrement un jour, aussi la question doit se poser autrement : est-il
souhaitable ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%