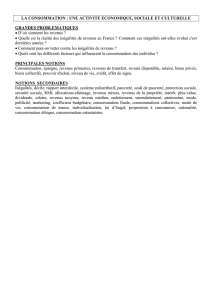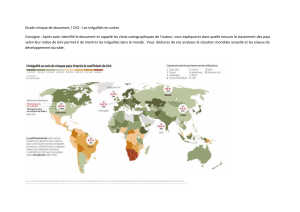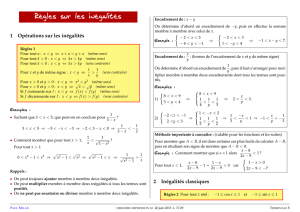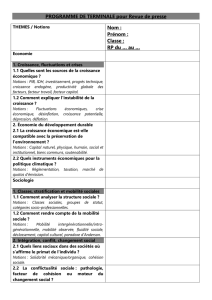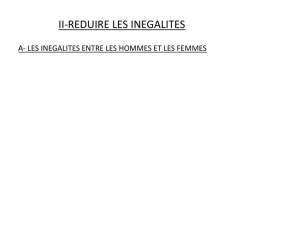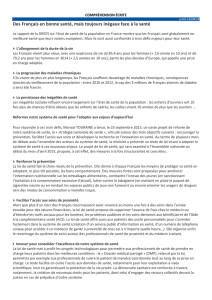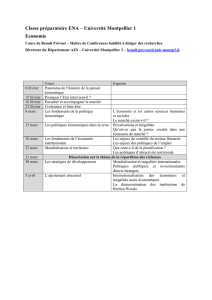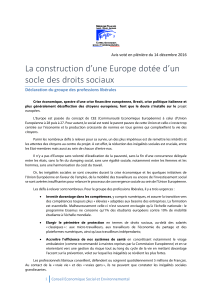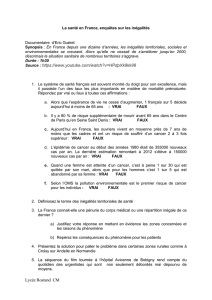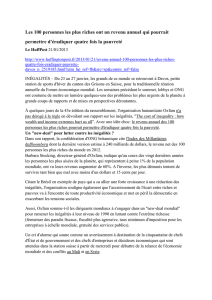chapitre 5 : la dynamique de la stratification sociale

1
C
CH
HA
AP
PI
IT
TR
RE
E
5
5
L
LA
A
D
DY
YN
NA
AM
MI
IQ
QU
UE
E
D
DE
E
L
LA
A
S
ST
TR
RA
AT
TI
IF
FI
IC
CA
AT
TI
IO
ON
N
S
SO
OC
CI
IA
AL
LE
E
I
IN
NT
TR
RO
OD
DU
UC
CT
TI
IO
ON
N
:
:
L
Le
es
s
n
no
ot
ti
io
on
ns
s
d
de
e
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
e
e
et
t
d
d’
’i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
é
d
do
oi
iv
ve
en
nt
t
ê
êt
tr
re
e
d
di
is
st
ti
in
ng
gu
ué
ée
es
s
m
mê
êm
me
e
s
si
i
e
el
ll
le
es
s
a
ap
pp
pa
ar
ra
ai
is
ss
se
en
nt
t
l
li
ié
ée
es
s.
.
L
Le
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
s
so
on
nt
t
s
so
ou
uv
ve
en
nt
t
é
éc
co
on
no
om
mi
iq
qu
ue
es
s
e
et
t
f
fi
in
na
an
nc
ci
iè
èr
re
es
s,
,
m
ma
ai
is
s
e
el
ll
le
es
s
e
ex
xi
is
st
te
en
nt
t
d
da
an
ns
s
l
l’
’e
en
ns
se
em
mb
bl
le
e
d
de
es
s
d
do
om
ma
ai
in
ne
es
s
s
so
oc
ci
ia
au
ux
x.
.
T
To
ou
ut
te
es
s
c
ce
es
s
f
fo
or
rm
me
es
s
d
d’
’i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
o
on
nt
t
t
te
en
nd
da
an
nc
ce
e
à
à
s
se
e
c
cu
um
mu
ul
le
er
r.
.
C
Co
om
mm
me
en
nt
t
c
ce
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
é
év
vo
ol
lu
ue
en
nt
t-
-
e
el
ll
le
es
s
s
su
ur
r
l
le
e
l
lo
on
ng
g
t
te
er
rm
me
e
d
da
an
ns
s
l
le
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s
d
dé
ém
mo
oc
cr
ra
at
ti
iq
qu
ue
es
s
d
do
on
nt
t
l
l’
’o
ob
bj
je
ec
ct
ti
if
f
e
es
st
t
l
l’
’é
ég
ga
al
li
it
té
é
?
?
(
(I
I)
)
L
La
a
s
st
tr
ru
uc
ct
tu
ur
re
e
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
d
dé
és
si
ig
gn
ne
e
l
l’
’o
or
rg
ga
an
ni
is
sa
at
ti
io
on
n
d
de
e
l
la
a
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é
e
en
n
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s
s
so
oc
ci
ia
au
ux
x
r
re
el
la
at
ti
iv
ve
em
me
en
nt
t
s
st
ta
ab
bl
le
es
s
e
et
t
e
el
ll
le
e
p
pe
eu
ut
t
ê
êt
tr
re
e
é
ét
tu
ud
di
ié
ée
e
à
à
l
l’
’a
ai
id
de
e
d
de
es
s
c
ca
at
té
ég
go
or
ri
ie
es
s
s
so
oc
ci
io
op
pr
ro
of
fe
es
ss
si
io
on
nn
ne
el
ll
le
es
s.
.
E
Ev
vo
ol
lu
ue
e-
-t
t-
-e
el
ll
le
e
d
da
an
ns
s
l
le
e
s
se
en
ns
s
d
d’
’u
un
n
r
re
eg
gr
ro
ou
up
pe
em
me
en
nt
t
d
de
e
l
la
a
m
ma
aj
jo
or
ri
it
té
é
d
de
e
l
la
a
p
po
op
pu
ul
la
at
ti
io
on
n
d
da
an
ns
s
u
un
ne
e
v
va
as
st
te
e
c
cl
la
as
ss
se
e
c
ce
en
nt
tr
ra
al
le
e
o
ou
u,
,
a
au
u
c
co
on
nt
tr
ra
ai
ir
re
e,
,
l
l’
’o
op
pp
po
os
si
it
ti
io
on
n
e
en
nt
tr
re
e
d
de
es
s
c
cl
la
as
ss
se
es
s
d
di
is
st
ti
in
nc
ct
te
es
s
s
se
e
m
ma
ai
in
nt
ti
ie
en
nt
t-
-e
el
ll
le
e
?
?
(
(I
II
I)
)
I
I.
.
L
La
a
d
dy
yn
na
am
mi
iq
qu
ue
e
d
de
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
L
Le
es
s
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
es
s
n
ne
e
d
dé
éb
bo
ou
uc
ch
he
en
nt
t
p
pa
as
s
o
ob
bl
li
ig
ga
at
to
oi
ir
re
em
me
en
nt
t
s
su
ur
r
d
de
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s,
,
m
ma
ai
is
s
c
ce
el
ll
le
es
s-
-c
ci
i
s
se
e
t
tr
ra
ad
du
ui
is
se
en
nt
t
p
pa
ar
r
u
un
n
a
ac
cc
cè
ès
s
p
pl
lu
us
s
o
ou
u
m
mo
oi
in
ns
s
a
ai
is
sé
é
à
à
d
de
es
s
r
re
es
ss
so
ou
ur
rc
ce
es
s
r
ra
ar
re
es
s
t
tr
rè
ès
s
d
di
iv
ve
er
rs
se
es
s.
.
S
Si
i
l
le
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
s
so
on
nt
t
d
do
on
nc
c
m
mu
ul
lt
ti
id
di
im
me
en
ns
si
io
on
nn
ne
el
ll
le
es
s,
,
e
el
ll
le
es
s
s
so
on
nt
t
a
au
us
ss
si
i
é
év
vo
ol
lu
ut
ti
iv
ve
es
s.
.
A
A.
.
D
Di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
es
s
e
et
t
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
L
Le
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s
s
so
on
nt
t
s
st
tr
ra
at
ti
if
fi
ié
ée
es
s
s
se
el
lo
on
n
d
de
e
n
no
om
mb
br
re
eu
ux
x
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
q
qu
ui
i
d
de
ev
vi
ie
en
nn
ne
en
nt
t
d
de
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
l
lo
or
rs
sq
qu
u’
’i
il
ls
s
s
so
on
nt
t
t
tr
ra
ad
du
ui
it
ts
s
e
en
n
t
te
er
rm
me
es
s
d
d’
’a
av
va
an
nt
ta
ag
ge
es
s
e
et
t
d
de
e
d
dé
és
sa
av
va
an
nt
ta
ag
ge
es
s.
.
O
On
n
p
pe
eu
ut
t
c
ci
it
te
er
r
l
le
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
d
de
e
p
pr
re
es
st
ti
ig
ge
e
o
ou
u
c
ce
er
rt
ta
ai
in
ne
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
e
en
nt
tr
re
e
h
ho
om
mm
me
es
s
e
et
t
f
fe
em
mm
me
es
s.
.
1
1.
.
D
De
es
s
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
es
s
a
au
ux
x
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
T
To
ou
ut
te
es
s
l
le
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s
é
ét
ta
ab
bl
li
is
ss
se
en
nt
t
d
de
es
s
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
es
s
s
so
oc
ci
ia
al
le
es
s
e
en
nt
tr
re
e
l
le
eu
ur
rs
s
m
me
em
mb
br
re
es
s
à
à
p
pa
ar
rt
ti
ir
r
d
de
e
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
d
de
e
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ci
ia
at
ti
io
on
n
n
no
om
mb
br
re
eu
ux
x
:
:
d
de
es
s
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
d
dé
ém
mo
og
gr
ra
ap
ph
hi
iq
qu
ue
es
s
:
:
l
le
es
s
h
ho
om
mm
me
es
s
e
et
t
l
le
es
s
f
fe
em
mm
me
es
s
(
(g
ge
en
nr
re
e)
),
,
l
le
es
s
j
je
eu
un
ne
es
s
e
et
t
l
le
es
s
v
vi
ie
eu
ux
x
(
(â
âg
ge
e)
)
;
;
d
de
es
s
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
é
éc
co
on
no
om
mi
iq
qu
ue
es
s
:
:
l
le
es
s
r
ri
ic
ch
he
es
s
e
et
t
l
le
es
s
p
pa
au
uv
vr
re
es
s
(
(r
re
ev
ve
en
nu
u
o
ou
u
p
pa
at
tr
ri
im
mo
oi
in
ne
e)
)
;
;
d
de
es
s
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
s
sy
ym
mb
bo
ol
li
iq
qu
ue
es
s
:
:
l
le
es
s
é
él
li
it
te
es
s
e
et
t
l
le
es
s
m
ma
ar
rg
gi
in
na
au
ux
x
(
(n
ni
iv
ve
ea
au
u
d
d’
’é
éd
du
uc
ca
at
ti
io
on
n,
,
n
ni
iv
ve
ea
au
u
d
de
e
p
pr
re
es
st
ti
ig
ge
e
s
so
oc
ci
ia
al
l)
)
;
;
d
de
es
s
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
p
po
ol
li
it
ti
iq
qu
ue
es
s
:
:
l
le
es
s
d
do
om
mi
in
na
an
nt
ts
s
e
et
t
l
le
es
s
d
do
om
mi
in
né
és
s
(
(p
po
ou
uv
vo
oi
ir
r)
).
.

2
D
D’
’a
au
ut
tr
re
es
s
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
p
pe
eu
uv
ve
en
nt
t
ê
êt
tr
re
e
é
év
vo
oq
qu
ué
és
s
s
se
el
lo
on
n
l
le
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s
e
et
t
l
le
es
s
é
ép
po
oq
qu
ue
es
s
:
:
p
ph
hy
ys
si
iq
qu
ue
es
s
(
(b
be
ea
au
ut
té
é
o
ou
u
f
fo
or
rc
ce
e
d
du
u
c
co
or
rp
ps
s)
),
,
m
me
en
nt
ta
au
ux
x
(
(d
de
eg
gr
ré
é
o
ou
u
t
ty
yp
pe
e
d
d’
’i
in
nt
te
el
ll
li
ig
ge
en
nc
ce
e)
),
,
e
et
th
hn
ni
iq
qu
ue
es
s
(
(c
co
om
mm
mu
un
na
au
ut
té
é
d
de
e
s
sa
an
ng
g)
),
,
r
re
el
li
ig
gi
ie
eu
ux
x
(
(c
cr
ro
oy
ya
an
nc
ce
es
s)
),
,
e
et
tc
c.
.
C
Ce
ep
pe
en
nd
da
an
nt
t,
,
u
un
ne
e
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
e
n
ne
e
d
do
oi
it
t
p
pa
as
s
ê
êt
tr
re
e
c
co
on
nf
fo
on
nd
du
ue
e
a
av
ve
ec
c
u
un
ne
e
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
é.
.
U
Un
ne
e
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
e
q
qu
ue
el
lc
co
on
nq
qu
ue
e
e
en
nt
tr
re
e
d
de
eu
ux
x
i
in
nd
di
iv
vi
id
du
us
s
o
ou
u
d
de
eu
ux
x
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s
d
d'
'i
in
nd
di
iv
vi
id
du
us
s
n
ne
e
d
de
ev
vi
ie
en
nt
t
u
un
ne
e
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
é
q
qu
u'
'à
à
p
pa
ar
rt
ti
ir
r
d
du
u
m
mo
om
me
en
nt
t
o
où
ù
e
el
ll
le
e
e
es
st
t
v
va
al
lo
or
ri
is
sé
ée
e,
,
c
c’
’e
es
st
t-
-à
à-
-d
di
ir
re
e
t
tr
ra
ad
du
ui
it
te
e
e
en
n
t
te
er
rm
me
es
s
d
d'
'a
av
va
an
nt
ta
ag
ge
es
s
o
ou
u
d
de
e
d
dé
és
sa
av
va
an
nt
ta
ag
ge
es
s
p
pa
ar
r
r
ra
ap
pp
po
or
rt
t
à
à
u
un
ne
e
é
éc
ch
he
el
ll
le
e
d
de
e
v
va
al
le
eu
ur
rs
s.
.
D
Da
an
ns
s
u
un
ne
e
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é
d
do
on
nt
t
l
l’
’é
éc
ch
he
el
ll
le
e
d
de
e
v
va
al
le
eu
ur
rs
s
s
se
er
ra
ai
it
t
f
fo
on
nd
dé
ée
e
s
su
ur
r
d
de
es
s
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
p
ph
hy
ys
si
iq
qu
ue
es
s
(
(q
qu
ui
i
c
co
or
rr
re
es
sp
po
on
nd
de
en
nt
t
e
en
n
f
fa
ai
it
t
à
à
d
de
es
s
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
r
ra
ac
ci
ia
au
ux
x,
,
l
la
a
r
ra
ac
ce
e
n
n’
’é
ét
ta
an
nt
t
p
pa
as
s
u
un
n
c
co
on
nc
ce
ep
pt
t
b
bi
io
ol
lo
og
gi
iq
qu
ue
e
m
ma
ai
is
s
p
po
ol
li
it
ti
iq
qu
ue
e)
),
,
l
le
es
s
b
br
ru
un
ns
s
e
et
t
l
le
es
s
b
bl
lo
on
nd
ds
s
(
(o
ou
u
l
le
es
s
g
gr
ra
an
nd
ds
s
e
et
t
l
le
es
s
p
pe
et
ti
it
ts
s,
,
l
le
es
s
y
ye
eu
ux
x
b
bl
le
eu
us
s
e
et
t
l
le
es
s
y
ye
eu
ux
x
m
ma
ar
rr
ro
on
ns
s)
),
,
p
pa
ar
r
e
ex
xe
em
mp
pl
le
e,
,
p
po
ou
ur
rr
ra
ai
ie
en
nt
t
ê
êt
tr
re
e
d
di
is
st
ti
in
ng
gu
ué
és
s
s
se
el
lo
on
n
l
le
eu
ur
r
c
ca
ap
pa
ac
ci
it
té
é
à
à
e
ex
xe
er
rc
ce
er
r
l
le
e
p
po
ou
uv
vo
oi
ir
r
:
:
«
«
l
le
es
s
b
bl
lo
on
nd
ds
s
s
so
on
nt
t
n
né
és
s
p
po
ou
ur
r
c
co
om
mm
ma
an
nd
de
er
r,
,
l
le
es
s
b
br
ru
un
ns
s
p
po
ou
ur
r
e
ex
xé
éc
cu
ut
te
er
r
l
le
eu
ur
rs
s
o
or
rd
dr
re
es
s
»
».
.
C
C’
’e
es
st
t
l
le
e
m
mê
êm
me
e
t
ty
yp
pe
e
d
de
e
c
cr
ri
it
tè
èr
re
es
s
p
ph
hy
ys
si
iq
qu
ue
es
s
(
(l
la
a
f
fo
or
rc
ce
e
e
et
t
l
le
es
s
c
ca
ar
ra
ac
ct
tè
èr
re
es
s
s
se
ex
xu
ue
el
ls
s)
)
q
qu
ue
e
l
le
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s
p
pa
at
tr
ri
ia
ar
rc
ca
al
le
es
s
(
(=
=
d
do
om
mi
in
né
ée
es
s
p
pa
ar
r
l
le
es
s
h
ho
om
mm
me
es
s)
),
,
a
au
ux
xq
qu
ue
el
ll
le
es
s
l
le
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s
o
oc
cc
ci
id
de
en
nt
ta
al
le
es
s
a
ap
pp
pa
ar
rt
ti
ie
en
nn
ne
en
nt
t,
,
o
on
nt
t
u
ut
ti
il
li
is
sé
é
d
de
ep
pu
ui
is
s
l
la
a
n
nu
ui
it
t
d
de
es
s
t
te
em
mp
ps
s
p
po
ou
ur
r
j
ju
us
st
ti
if
fi
ie
er
r
l
l’
’e
ex
xe
er
rc
ci
ic
ce
e
d
du
u
p
po
ou
uv
vo
oi
ir
r
p
pa
ar
r
l
le
es
s
h
ho
om
mm
me
es
s
e
et
t
c
ca
an
nt
to
on
nn
ne
er
r
l
le
es
s
f
fe
em
mm
me
es
s
à
à
d
de
es
s
p
po
os
si
it
ti
io
on
ns
s
s
su
ub
ba
al
lt
te
er
rn
ne
es
s.
.
C
C’
’e
es
st
t
d
do
on
nc
c
l
l’
’a
ap
pp
pl
li
ic
ca
at
ti
io
on
n
d
d’
’u
un
ne
e
(
(d
de
e
p
pl
lu
us
si
ie
eu
ur
rs
s)
)
é
éc
ch
he
el
ll
le
e(
(s
s)
)
d
de
e
v
va
al
le
eu
ur
rs
s
a
au
u
m
mo
on
nd
de
e
s
so
oc
ci
ia
al
l
q
qu
ui
i
v
va
a
c
co
on
nd
du
ui
ir
re
e
à
à
p
po
ol
la
ar
ri
is
se
er
r
l
l’
’e
es
sp
pa
ac
ce
e
d
de
es
s
p
po
os
si
it
ti
io
on
ns
s
s
so
oc
ci
ia
al
le
es
s
e
et
t
c
cr
ré
ée
er
r
a
ai
in
ns
si
i
u
un
ne
e
(
(p
pl
lu
us
si
ie
eu
ur
rs
s)
)
h
hi
ié
ér
ra
ar
rc
ch
hi
ie
e(
(s
s)
)
s
so
oc
ci
ia
al
le
e(
(s
s)
).
.
P
Pa
ar
r
e
ex
xe
em
mp
pl
le
e
:
:
l
le
e
f
fo
or
rt
t,
,
l
le
e
m
ma
as
sc
cu
ul
li
in
n,
,
l
le
e
b
bo
on
n,
,
l
le
e
b
be
ea
au
u,
,
l
le
e
j
ju
us
st
te
e,
,
l
le
e
r
ri
ic
ch
he
e,
,
l
le
e
s
sa
av
va
an
nt
t,
,
l
le
e
c
cr
ro
oy
ya
an
nt
t
(
(e
et
tc
c.
.)
),
,
a
au
u
s
so
om
mm
me
et
t
(
(l
la
a
«
«
c
ci
im
me
e
»
»)
)
d
de
e
l
la
a
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é
;
;
l
le
e
f
fa
ai
ib
bl
le
e,
,
l
le
e
f
fé
ém
mi
in
ni
in
n,
,
l
le
e
m
mé
éc
ch
ha
an
nt
t,
,
l
le
e
l
la
ai
id
d,
,
l
l’
’i
in
nj
ju
us
st
te
e,
,
l
le
e
p
pa
au
uv
vr
re
e,
,
l
l’
’i
ig
gn
no
or
ra
an
nt
t,
,
l
le
e
m
mé
éc
cr
ré
éa
an
nt
t
(
(e
et
tc
c.
.)
),
,
a
au
u
b
ba
as
s
(
(«
«
l
l’
’a
ab
bî
îm
me
e
»
»)
)
d
de
e
l
la
a
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é.
.
2
2.
.
L
La
a
h
hi
ié
ér
ra
ar
rc
ch
hi
ie
e
d
de
es
s
r
rô
ôl
le
es
s
s
so
oc
ci
ia
au
ux
x
I
Il
l
e
es
st
t
h
ha
ab
bi
it
tu
ue
el
l
e
en
n
s
so
oc
ci
io
ol
lo
og
gi
ie
e
d
de
e
d
di
is
st
ti
in
ng
gu
ue
er
r
l
la
a
s
st
tr
ra
at
ti
if
fi
ic
ca
at
ti
io
on
n
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
e
et
t
l
le
e
s
sy
ys
st
tè
èm
me
e
c
cu
ul
lt
tu
ur
re
el
l.
.
[
[R
Ra
ap
pp
pe
el
ls
s
d
du
u
c
co
ou
ur
rs
s
d
de
e
P
Pr
re
em
mi
iè
èr
re
e]
]
P
Pa
ar
r
a
an
na
al
lo
og
gi
ie
e
a
av
ve
ec
c
l
la
a
n
no
ot
ti
io
on
n
d
de
e
s
st
tr
ra
at
te
e
e
en
n
g
gé
éo
ol
lo
og
gi
ie
e
q
qu
ui
i
d
dé
és
si
ig
gn
ne
e
u
un
ne
e
c
co
ou
uc
ch
he
e
d
de
e
t
te
er
rr
ra
ai
in
n,
,
l
la
a
s
st
tr
ra
at
ti
if
fi
ic
ca
at
ti
io
on
n
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
e
es
st
t
l
l’
’e
en
ns
se
em
mb
bl
le
e
d
de
es
s
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s
d
d’
’i
in
nd
di
iv
vi
id
du
us
s
o
oc
cc
cu
up
pa
an
nt
t
d
de
es
s
p
po
os
si
it
ti
io
on
ns
s
s
so
oc
ci
ia
al
le
es
s
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nt
te
es
s
s
su
ur
r
u
un
ne
e
é
éc
ch
he
el
ll
le
e
v
ve
er
rt
ti
ic
ca
al
le
e,
,
d
do
on
nt
t
l
la
a
n
na
at
tu
ur
re
e
p
pe
eu
ut
t
ê
êt
tr
re
e
r
re
el
li
ig
gi
ie
eu
us
se
e,
,
p
po
ol
li
it
ti
iq
qu
ue
e,
,
é
éc
co
on
no
om
mi
iq
qu
ue
e
o
ou
u
c
cu
ul
lt
tu
ur
re
el
ll
le
e
:
:
c
c’
’e
es
st
t
e
en
n
q
qu
ue
el
lq
qu
ue
e
s
so
or
rt
te
e
«
«
l
l’
’a
an
na
at
to
om
mi
ie
e
»
»
(
(l
la
a
c
co
on
ns
st
ti
it
tu
ut
ti
io
on
n)
)
d
du
u
c
co
or
rp
ps
s
s
so
oc
ci
ia
al
l.
.
E
En
n
f
fa
ai
is
sa
an
nt
t
r
ré
éf
fé
ér
re
en
nc
ce
e
a
au
ux
x
t
tr
ra
av
va
au
ux
x
d
d’
’E
Em
mi
il
le
e
D
DU
UR
RK
KH
HE
EI
IM
M
(
(1
18
85
58
8-
-1
19
91
17
7)
),
,
p
pè
èr
re
e
f
fo
on
nd
da
at
te
eu
ur
r
d
de
e
l
la
a
s
so
oc
ci
io
ol
lo
og
gi
ie
e
f
fr
ra
an
nç
ça
ai
is
se
e,
,
o
on
n
p
pe
eu
ut
t
a
af
ff
fi
ir
rm
me
er
r
q
qu
ue
e
l
le
e
s
sy
ys
st
tè
èm
me
e
c
cu
ul
lt
tu
ur
re
el
l
e
es
st
t
l
l’
’e
en
ns
se
em
mb
bl
le
e
d
de
es
s
m
ma
an
ni
iè
èr
re
es
s
d
d’
’ê
êt
tr
re
e
e
et
t
d
d’
’a
ag
gi
ir
r
p
pa
ar
rt
ta
ag
gé
ée
es
s
p
pa
ar
r
l
le
es
s
m
me
em
mb
br
re
es
s
d
d’
’u
un
ne
e
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é.
.
L
Le
es
s
p
pr
ri
in
nc
ci
ip
pa
al
le
es
s
c
co
om
mp
po
os
sa
an
nt
te
es
s
d
du
u
s
sy
ys
st
tè
èm
me
e
c
cu
ul
lt
tu
ur
re
el
l
s
so
on
nt
t
d
do
on
nc
c
l
le
es
s
v
va
al
le
eu
ur
rs
s,
,
l
le
es
s
n
no
or
rm
me
es
s,
,
l
le
e
l
la
an
ng
ga
ag
ge
e
e
et
t
l
le
es
s
p
pr
ra
at
ti
iq
qu
ue
es
s
e
en
n
g
gé
én
né
ér
ra
al
l.
.
C
Ce
es
s
é
él
lé
ém
me
en
nt
ts
s
f
fo
or
rm
me
en
nt
t
u
un
n
s
sy
ys
st
tè
èm
me
e
c
ca
ar
r
i
il
ls
s
s
so
on
nt
t
i
in
nt
te
er
rd
dé
ép
pe
en
nd
da
an
nt
ts
s
:
:
l
le
es
s
v
va
al
le
eu
ur
rs
s
s
so
on
nt
t
d
de
es
s
i
id
dé
éa
au
ux
x
(
(b
bu
ut
ts
s)
)

3
c
co
on
nc
cr
ré
ét
ti
is
sé
és
s
p
pa
ar
r
d
de
es
s
n
no
or
rm
me
es
s
(
(à
à
l
la
a
f
fo
oi
is
s
r
rè
èg
gl
le
es
s
e
et
t
m
mo
oy
ye
en
ns
s
p
po
ou
ur
r
r
ré
éa
al
li
is
se
er
r
l
le
es
s
i
id
dé
éa
au
ux
x)
),
,
q
qu
ui
i
o
or
ri
ie
en
nt
te
en
nt
t
e
et
t
h
ha
ar
rm
mo
on
ni
is
se
en
nt
t
l
le
es
s
p
pr
ra
at
ti
iq
qu
ue
es
s
i
in
nd
di
iv
vi
id
du
ue
el
ll
le
es
s
(
(q
qu
ui
i,
,
d
du
u
m
mê
êm
me
e
c
co
ou
up
p,
,
d
de
ev
vi
ie
en
nn
ne
en
nt
t
s
so
oc
ci
ia
al
le
es
s,
,
c
c’
’e
es
st
t-
-à
à-
-d
di
ir
re
e
c
co
om
mm
mu
un
ne
es
s
à
à
l
la
a
p
pl
lu
up
pa
ar
rt
t
d
de
es
s
i
in
nd
di
iv
vi
id
du
us
s)
)
e
et
t
s
so
on
nt
t
e
ex
xp
pr
ri
im
mé
ée
es
s
à
à
t
tr
ra
av
ve
er
rs
s
l
le
e
l
la
an
ng
ga
ag
ge
e
(
(l
lu
ui
i-
-m
mê
êm
me
e
n
no
or
rm
me
e
d
de
e
c
co
om
mp
po
or
rt
te
em
me
en
nt
t
l
li
in
ng
gu
ui
is
st
ti
iq
qu
ue
e)
).
.
P
Po
ou
ur
r
p
pr
ro
ol
lo
on
ng
ge
er
r
l
l’
’a
an
na
al
lo
og
gi
ie
e
m
mé
éd
di
ic
ca
al
le
e,
,
c
co
om
mm
me
e
l
la
a
c
cu
ul
lt
tu
ur
re
e
c
co
or
rr
re
es
sp
po
on
nd
d
a
au
u
f
fo
on
nc
ct
ti
io
on
nn
ne
em
me
en
nt
t
d
de
e
l
la
a
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é,
,
c
c’
’e
es
st
t
e
en
n
q
qu
ue
el
lq
qu
ue
e
s
so
or
rt
te
e
«
«
l
la
a
p
ph
hy
ys
si
io
ol
lo
og
gi
ie
e
»
»
(
(l
le
es
s
p
pr
ro
oc
ce
es
ss
su
us
s)
)
d
du
u
c
co
or
rp
ps
s
s
so
oc
ci
ia
al
l.
.
M
Ma
ai
is
s
l
la
a
s
st
tr
ra
at
ti
if
fi
ic
ca
at
ti
io
on
n
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
e
et
t
l
le
e
s
sy
ys
st
tè
èm
me
e
c
cu
ul
lt
tu
ur
re
el
l
s
so
on
nt
t
n
né
éc
ce
es
ss
sa
ai
ir
re
em
me
en
nt
t
e
en
n
r
re
el
la
at
ti
io
on
n
é
ét
tr
ro
oi
it
te
e
l
l’
’u
un
ne
e
a
av
ve
ec
c
l
l’
’a
au
ut
tr
re
e.
.
C
C’
’e
es
st
t
l
la
a
n
no
ot
ti
io
on
n
d
de
e
r
rô
ôl
le
e
s
so
oc
ci
ia
al
l
(
(=
=
f
fo
on
nc
ct
ti
io
on
n
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
d
de
e
l
l’
’i
in
nd
di
iv
vi
id
du
u)
)
q
qu
ui
i
p
pe
er
rm
me
et
t
d
d’
’é
ét
ta
ab
bl
li
ir
r
c
ce
et
tt
te
e
r
re
el
la
at
ti
io
on
n.
.
E
En
n
e
ef
ff
fe
et
t,
,
d
de
e
l
la
a
m
mê
êm
me
e
m
ma
an
ni
iè
èr
re
e
q
qu
ue
e
l
le
es
s
o
or
rg
ga
an
ne
es
s
q
qu
ui
i
c
co
on
ns
st
ti
it
tu
ue
en
nt
t
l
le
e
c
co
or
rp
ps
s
p
pe
er
rm
me
et
tt
te
en
nt
t
d
de
e
l
le
e
f
fa
ai
ir
re
e
v
vi
iv
vr
re
e
e
en
n
e
ex
xe
er
rç
ça
an
nt
t
l
le
eu
ur
r
f
fo
on
nc
ct
ti
io
on
n,
,
l
le
es
s
i
in
nd
di
iv
vi
id
du
us
s
a
af
ff
fe
ec
ct
té
és
s
à
à
c
ch
ha
aq
qu
ue
e
p
po
os
si
it
ti
io
on
n
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
v
vo
on
nt
t
p
pe
er
rm
me
et
tt
tr
re
e
l
le
e
f
fo
on
nc
ct
ti
io
on
nn
ne
em
me
en
nt
t
d
de
e
l
la
a
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é
e
en
n
j
jo
ou
ua
an
nt
t
l
le
eu
ur
r
r
rô
ôl
le
e.
.
O
On
n
d
dé
éf
fi
in
ni
it
t
a
ai
in
ns
si
i
c
ch
ha
aq
qu
ue
e
r
rô
ôl
le
e
c
co
om
mm
me
e
l
l’
’e
en
ns
se
em
mb
bl
le
e
d
de
es
s
m
ma
an
ni
iè
èr
re
es
s
d
d’
’ê
êt
tr
re
e
e
et
t
d
d’
’a
ag
gi
ir
r
c
co
or
rr
re
es
sp
po
on
nd
da
an
nt
t
à
à
u
un
ne
e
p
po
os
si
it
ti
io
on
n
o
ou
u
u
un
ne
e
s
st
tr
ra
at
te
e
(
(e
en
ns
se
em
mb
bl
le
e
d
de
es
s
p
po
os
si
it
ti
io
on
ns
s
d
de
e
m
mê
êm
me
e
n
ni
iv
ve
ea
au
u)
)
s
so
oc
ci
ia
al
le
e.
.
L
Le
e
r
rô
ôl
le
e
s
so
oc
ci
ia
al
l
a
a
d
do
on
nc
c
u
un
ne
e
f
fo
on
nc
ct
ti
io
on
n
d
de
e
r
ré
ég
gu
ul
la
at
ti
io
on
n
i
in
nd
di
is
sp
pe
en
ns
sa
ab
bl
le
e
d
da
an
ns
s
l
le
e
c
co
or
rp
ps
s
s
so
oc
ci
ia
al
l.
.
D
De
e
m
mê
êm
me
e
q
qu
u’
’o
on
n
a
at
tt
te
en
nd
d
d
du
u
c
cœ
œu
ur
r
q
qu
u’
’i
il
l
f
fa
as
ss
se
e
c
ci
ir
rc
cu
ul
le
er
r
l
le
e
s
sa
an
ng
g
e
et
t
d
de
e
l
l’
’e
es
st
to
om
ma
ac
c
q
qu
u’
’i
il
l
d
di
ig
gè
èr
re
e
l
le
es
s
a
al
li
im
me
en
nt
ts
s
(
(e
et
t
n
no
on
n
l
l’
’i
in
nv
ve
er
rs
se
e)
),
,
o
on
n
a
at
tt
te
en
nd
d
d
du
u
p
pr
ro
of
fe
es
ss
se
eu
ur
r
q
qu
u’
’i
il
l
e
en
ns
se
ei
ig
gn
ne
e,
,
d
du
u
m
mé
éd
de
ec
ci
in
n
q
qu
u’
’i
il
l
s
so
oi
ig
gn
ne
e,
,
d
du
u
b
bo
ou
ul
la
an
ng
ge
er
r
q
qu
u’
’i
il
l
c
cu
ui
is
se
e
l
le
e
p
pa
ai
in
n,
,
d
du
u
m
me
en
nu
ui
is
si
ie
er
r
q
qu
u’
’i
il
l
f
fa
ab
br
ri
iq
qu
ue
e
d
de
es
s
m
me
eu
ub
bl
le
es
s,
,
d
du
u
m
mu
us
si
ic
ci
ie
en
n
q
qu
u’
’i
il
l
e
en
nc
ch
ha
an
nt
te
e
n
no
os
s
o
or
re
ei
il
ll
le
es
s,
,
e
et
tc
c.
.
L
Le
e
r
rô
ôl
le
e
d
do
on
nn
ne
e
u
un
ne
e
u
ut
ti
il
li
it
té
é
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
(
(=
=
u
un
ne
e
f
fo
on
nc
ct
ti
io
on
n)
)
à
à
l
l’
’i
in
nd
di
iv
vi
id
du
u
q
qu
ui
i
l
le
e
j
jo
ou
ue
e
e
et
t
c
ce
e
r
rô
ôl
le
e
j
ju
us
st
ti
if
fi
ie
e
s
so
on
n
s
st
ta
at
tu
ut
t
(
(s
sa
a
p
po
os
si
it
ti
io
on
n)
),
,
c
c'
'e
es
st
t-
-à
à-
-d
di
ir
re
e
s
so
on
n
e
ex
xi
is
st
te
en
nc
ce
e
d
da
an
ns
s
l
la
a
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é.
.
M
Ma
ai
is
s
l
le
e
r
rô
ôl
le
e
f
fa
ai
it
t
p
pl
lu
us
s
e
en
nc
co
or
re
e.
.
I
Il
l
s
si
im
mp
pl
li
if
fi
ie
e
é
ég
ga
al
le
em
me
en
nt
t
l
le
es
s
r
re
el
la
at
ti
io
on
ns
s
s
so
oc
ci
ia
al
le
es
s
e
en
n
r
re
en
nd
da
an
nt
t
p
pr
ré
év
vi
is
si
ib
bl
le
es
s
l
le
es
s
c
co
om
mp
po
or
rt
te
em
me
en
nt
ts
s
d
de
e
c
ch
ha
ac
cu
un
n.
.
O
On
n
s
s’
’a
at
tt
te
en
nd
d
à
à
c
ce
e
q
qu
ue
e
l
l’
’e
em
mp
pl
lo
oy
yé
é
d
de
e
l
la
a
p
po
os
st
te
e
s
s’
’o
oc
cc
cu
up
pe
e
d
de
e
n
no
ot
tr
re
e
c
co
ou
ur
rr
ri
ie
er
r
e
et
t
n
no
on
n
à
à
c
ce
e
q
qu
u’
’i
il
l
n
no
ou
us
s
d
di
is
se
e
l
l’
’a
av
ve
en
ni
ir
r
:
:
o
on
n
l
lu
ui
i
t
te
en
nd
d
d
do
on
nc
c
l
le
es
s
l
le
et
tt
tr
re
es
s
e
et
t
n
no
on
n
l
le
es
s
l
li
ig
gn
ne
es
s
d
de
e
l
la
a
m
ma
ai
in
n.
.
O
On
n
s
s’
’a
at
tt
te
en
nd
d
à
à
c
ce
e
q
qu
ue
e
l
le
e
p
po
ol
li
ic
ci
ie
er
r
v
ve
er
rb
ba
al
li
is
se
e
l
le
es
s
c
co
on
nt
tr
re
ev
ve
en
na
an
nt
ts
s
a
au
u
c
co
od
de
e
d
de
e
l
la
a
r
ro
ou
ut
te
e
e
et
t
n
no
on
n
q
qu
u’
’i
il
l
l
le
es
s
f
fé
él
li
ic
ci
it
te
e
:
:
o
on
n
r
ra
al
le
en
nt
ti
it
t
d
do
on
nc
c
a
au
u
c
ca
ar
rr
re
ef
fo
ou
ur
r
a
au
u
l
li
ie
eu
u
d
d’
’a
ac
cc
cé
él
lé
ér
re
er
r…
…
C
Ce
ep
pe
en
nd
da
an
nt
t,
,
d
da
an
ns
s
c
ch
ha
aq
qu
ue
e
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é,
,
c
co
om
mp
pt
te
e
t
te
en
nu
u
d
du
u
s
sy
ys
st
tè
èm
me
e
c
cu
ul
lt
tu
ur
re
el
l
e
en
n
v
vi
ig
gu
ue
eu
ur
r,
,
i
il
l
y
y
a
a
d
de
es
s
r
rô
ôl
le
es
s
p
pl
lu
us
s
v
va
al
lo
or
ri
is
sé
és
s
q
qu
ue
e
d
d’
’a
au
ut
tr
re
es
s
:
:
l
le
e
m
mi
in
ni
is
st
tr
re
e
e
et
t
l
l’
’o
ou
uv
vr
ri
ie
er
r
n
n’
’o
on
nt
t
p
pa
as
s
l
le
e
m
mê
êm
me
e
p
pr
re
es
st
ti
ig
ge
e,
,
n
ni
i
d
d’
’a
ai
il
ll
le
eu
ur
rs
s
l
le
e
m
mê
êm
me
e
p
po
ou
uv
vo
oi
ir
r
o
ou
u
l
le
e
m
mê
êm
me
e
r
re
ev
ve
en
nu
u.
.
L
La
a
h
hi
ié
ér
ra
ar
rc
ch
hi
ie
e
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
r
re
ep
po
os
se
e
d
do
on
nc
c
s
su
ur
r
l
la
a
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ci
ia
at
ti
io
on
n
v
ve
er
rt
ti
ic
ca
al
le
e
d
de
es
s
r
rô
ôl
le
es
s
s
so
oc
ci
ia
au
ux
x
:
:
a
au
u
s
so
om
mm
me
et
t
d
de
e
l
la
a
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é,
,
l
le
es
s
r
rô
ôl
le
es
s
d
di
ir
ri
ig
ge
ea
an
nt
ts
s
;
;
e
en
n
b
ba
as
s,
,
l
le
es
s
r
rô
ôl
le
es
s
s
su
ub
ba
al
lt
te
er
rn
ne
es
s.
.
C
Ce
et
tt
te
e
h
hi
ié
ér
ra
ar
rc
ch
hi
is
sa
at
ti
io
on
n
s
se
e
m
ma
at
té
ér
ri
ia
al
li
is
se
e
p
pa
ar
r
l
le
es
s
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
es
s
d
d’
’a
ac
cc
cè
ès
s
a
au
ux
x
r
re
es
ss
so
ou
ur
rc
ce
es
s
s
so
oc
ci
ia
al
le
em
me
en
nt
t
v
va
al
lo
or
ri
is
sé
ée
es
s,
,
t
te
el
ll
le
es
s
q
qu
ue
e
l
la
a
r
ri
ic
ch
he
es
ss
se
e,
,
l
le
e
p
pr
re
es
st
ti
ig
ge
e
o
ou
u
l
le
e
p
po
ou
uv
vo
oi
ir
r.
.
C
Co
om
mm
me
e
c
ce
es
s
r
re
es
ss
so
ou
ur
rc
ce
es
s
s
so
on
nt
t
m
mu
ul
lt
ti
ip
pl
le
es
s,
,
i
il
l
e
es
st
t
c
ce
ep
pe
en
nd
da
an
nt
t
p
po
os
ss
si
ib
bl
le
e
d
de
e
r
re
ep
pé
ér
re
er
r
p
pl
lu
us
si
ie
eu
ur
rs
s
h
hi
ié
ér
ra
ar
rc
ch
hi
ie
es
s
s
so
oc
ci
ia
al
le
es
s
d
da
an
ns
s
l
le
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s
m
mo
od
de
er
rn
ne
es
s.
.
L
Le
e
g
gr
ra
an
nd
d
s
so
oc
ci
io
ol
lo
og
gu
ue
e
a
al
ll
le
em
ma
an
nd
d
M
Ma
ax
x
W
WE
EB
BE
ER
R
(
(1
18
86
64
4-
-1
19
92
20
0)
)
d
di
is
st
ti
in
ng
gu
ue
e
e
en
n
e
ef
ff
fe
et
t
t
tr
ro
oi
is
s
t
ty
yp
pe
es
s
d
de
e
h
hi
ié
ér
ra
ar
rc
ch
hi
ie
e
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
:
:
l
le
es
s
c
cl
la
as
ss
se
es
s
q
qu
ui
i
r
re
ep
po
os
se
en
nt
t
s
su
ur
r
d
de
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
d
de
e
r
re
ev
ve
en
nu
u
;
;

4
l
le
es
s
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s
d
de
e
s
st
ta
at
tu
ut
t
q
qu
ui
i
s
se
e
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ci
ie
en
nt
t
p
pa
ar
r
l
le
eu
ur
r
n
ni
iv
ve
ea
au
u
d
de
e
p
pr
re
es
st
ti
ig
ge
e
;
;
l
le
es
s
p
pa
ar
rt
ti
is
s
q
qu
ui
i
o
on
nt
t
d
de
es
s
c
ch
ha
an
nc
ce
es
s
i
in
né
ég
ga
al
le
es
s
d
d’
’a
ac
cc
cé
éd
de
er
r
a
au
u
p
po
ou
uv
vo
oi
ir
r.
.
P
Po
ou
ur
r
W
WE
EB
BE
ER
R,
,
i
il
l
y
y
a
a
d
do
on
nc
c
t
tr
ro
oi
is
s
o
or
rd
dr
re
es
s
d
de
e
c
cl
la
as
ss
se
em
me
en
nt
t
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nt
ts
s
:
:
l
l’
’é
éc
co
on
no
om
mi
iq
qu
ue
e,
,
l
le
e
s
so
oc
ci
ia
al
l
e
et
t
l
le
e
p
po
ol
li
it
ti
iq
qu
ue
e.
.
C
Co
on
nt
tr
ra
ai
ir
re
em
me
en
nt
t
à
à
M
MA
AR
RX
X,
,
l
le
es
s
c
cl
la
as
ss
se
es
s
é
éc
co
on
no
om
mi
iq
qu
ue
es
s
n
ne
e
c
co
on
ns
st
ti
it
tu
ue
en
nt
t
q
qu
u’
’u
un
n
a
as
sp
pe
ec
ct
t
d
de
e
l
la
a
s
st
tr
ra
at
ti
if
fi
ic
ca
at
ti
io
on
n
s
so
oc
ci
ia
al
le
e.
.
I
Il
l
e
en
n
r
ré
és
su
ul
lt
te
e
u
un
ne
e
g
gr
ra
an
nd
de
e
c
co
om
mp
pl
le
ex
xi
it
té
é
d
de
e
l
l’
’o
or
rg
ga
an
ni
is
sa
at
ti
io
on
n
d
de
e
l
la
a
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é
:
:
d
de
eu
ux
x
p
pe
er
rs
so
on
nn
ne
es
s
p
pe
eu
uv
ve
en
nt
t
a
ap
pp
pa
ar
rt
te
en
ni
ir
r
à
à
l
la
a
m
mê
êm
me
e
c
cl
la
as
ss
se
e
é
éc
co
on
no
om
mi
iq
qu
ue
e
e
et
t
à
à
d
de
es
s
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s
d
de
e
s
st
ta
at
tu
ut
t
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nt
ts
s
(
(E
Ex
xe
em
mp
pl
le
e
:
:
g
gr
ro
os
s
a
ag
gr
ri
ic
cu
ul
lt
te
eu
ur
r
e
et
t
p
pr
ro
of
fe
es
ss
se
eu
ur
r
d
d’
’u
un
ni
iv
ve
er
rs
si
it
té
é,
,
j
je
eu
un
ne
e
m
mé
éd
de
ec
ci
in
n
e
et
t
o
ou
uv
vr
ri
ie
er
r
q
qu
ua
al
li
if
fi
ié
é)
).
.
L
La
a
p
po
op
pu
ul
la
at
ti
io
on
n
e
es
st
t
d
do
on
nc
c
p
pa
ar
rt
ta
ag
gé
ée
e
e
en
n
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s
s
so
oc
ci
ia
au
ux
x
m
mu
ul
lt
ti
if
fo
or
rm
me
es
s
p
pa
ar
r
d
de
es
s
c
cl
li
iv
va
ag
ge
es
s
m
mu
ul
lt
ti
ip
pl
le
es
s
(
(â
âg
ge
e,
,
s
se
ex
xe
e,
,
q
qu
ua
al
li
if
fi
ic
ca
at
ti
io
on
n,
,
r
re
ev
ve
en
nu
u,
,
e
et
tc
c.
.)
)
C
Ce
ep
pe
en
nd
da
an
nt
t,
,
i
il
l
e
es
st
t
t
to
ou
uj
jo
ou
ur
rs
s
p
po
os
ss
si
ib
bl
le
e
d
d’
’i
id
de
en
nt
ti
if
fi
ie
er
r
d
de
es
s
é
él
li
it
te
es
s,
,
c
c’
’e
es
st
t-
-à
à-
-d
di
ir
re
e
l
le
es
s
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s
d
d’
’i
in
nd
di
iv
vi
id
du
us
s
q
qu
ui
i
m
mo
on
no
op
po
ol
li
is
se
en
nt
t
l
le
es
s
p
po
os
si
it
ti
io
on
ns
s
s
so
oc
ci
ia
al
le
es
s
s
su
up
pé
ér
ri
ie
eu
ur
re
es
s.
.
P
Pa
ar
r
e
ex
xe
em
mp
pl
le
e,
,
l
le
es
s
P
PD
DG
G
d
de
es
s
g
gr
ra
an
nd
de
es
s
f
fi
ir
rm
me
es
s
o
oc
cc
cu
up
pe
en
nt
t
l
le
e
s
so
om
mm
me
et
t
d
de
e
l
la
a
h
hi
ié
ér
ra
ar
rc
ch
hi
ie
e
é
éc
co
on
no
om
mi
iq
qu
ue
e,
,
l
le
es
s
m
mi
in
ni
is
st
tr
re
es
s
s
so
on
nt
t
a
au
u
s
so
om
mm
me
et
t
d
de
e
l
la
a
h
hi
ié
ér
ra
ar
rc
ch
hi
ie
e
p
po
ol
li
it
ti
iq
qu
ue
e
e
et
t
l
le
es
s
v
ve
ed
de
et
tt
te
es
s
d
du
u
s
sp
po
or
rt
t,
,
d
de
e
l
la
a
c
ch
ha
an
ns
so
on
n,
,
d
du
u
c
ci
in
né
ém
ma
a,
,
d
de
e
l
la
a
m
mo
od
de
e
e
et
t
d
de
e
l
la
a
t
té
él
lé
év
vi
is
si
io
on
n
o
on
nt
t
a
au
uj
jo
ou
ur
rd
d’
’h
hu
ui
i
u
un
n
p
pr
re
es
st
ti
ig
ge
e
s
so
oc
ci
ia
al
l
é
él
le
ev
vé
é.
.
L
Lo
or
rs
sq
qu
ue
e
c
ce
er
rt
ta
ai
in
ns
s
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s
p
pa
ar
rv
vi
ie
en
nn
ne
en
nt
t
d
du
ur
ra
ab
bl
le
em
me
en
nt
t
à
à
o
oc
cc
cu
up
pe
er
r
l
le
es
s
p
po
os
si
it
ti
io
on
ns
s
s
su
up
pé
ér
ri
ie
eu
ur
re
es
s
s
su
ur
r
c
ch
ha
aq
qu
ue
e
é
éc
ch
he
el
ll
le
e,
,
v
vo
oi
ir
re
e
à
à
l
le
es
s
t
tr
ra
an
ns
sm
me
et
tt
tr
re
e
à
à
l
le
eu
ur
rs
s
d
de
es
sc
ce
en
nd
da
an
nt
ts
s,
,
i
il
l
f
fa
au
ut
t
a
al
lo
or
rs
s
p
pa
ar
rl
le
er
r
d
d’
’u
un
ne
e
é
él
li
it
te
e
s
so
oc
ci
ia
al
le
e
a
au
u
s
si
in
ng
gu
ul
li
ie
er
r.
.
D
Da
an
ns
s
l
la
a
F
Fr
ra
an
nc
ce
e
c
co
on
nt
te
em
mp
po
or
ra
ai
in
ne
e,
,
o
on
n
p
pe
eu
ut
t
s
se
e
d
de
em
ma
an
nd
de
er
r
s
si
i
l
la
a
g
gr
ra
an
nd
de
e
b
bo
ou
ur
rg
ge
eo
oi
is
si
ie
e
n
ne
e
f
fo
or
rm
me
e
p
pa
as
s
c
ce
et
tt
te
e
é
él
li
it
te
e
u
un
ni
iq
qu
ue
e
:
:
L
Le
es
s
m
me
em
mb
br
re
es
s
d
de
e
c
ce
e
m
mi
il
li
ie
eu
u
s
so
oc
ci
ia
al
l
o
oc
cc
cu
up
pe
en
nt
t
d
de
es
s
p
po
os
st
te
es
s
d
de
e
d
di
ir
re
ec
ct
ti
io
on
n
d
da
an
ns
s
l
le
es
s
g
gr
ra
an
nd
de
es
s
e
en
nt
tr
re
ep
pr
ri
is
se
es
s
i
in
nd
du
us
st
tr
ri
ie
el
ll
le
es
s
e
et
t
f
fi
in
na
an
nc
ci
iè
èr
re
es
s,
,
o
ou
u
d
de
es
s
p
po
os
st
te
es
s
d
de
e
r
re
es
sp
po
on
ns
sa
ab
bi
il
li
it
té
é
d
da
an
ns
s
l
la
a
h
ha
au
ut
te
e
f
fo
on
nc
ct
ti
io
on
n
p
pu
ub
bl
li
iq
qu
ue
e
(
(p
po
ou
uv
vo
oi
ir
r)
).
.
T
Ti
it
tu
ul
la
ai
ir
re
es
s
d
de
e
r
re
ev
ve
en
nu
us
s
é
él
le
ev
vé
és
s,
,
i
il
ls
s
p
pr
ro
of
fi
it
te
en
nt
t
s
su
ur
rt
to
ou
ut
t
d
d’
’u
un
n
p
pa
at
tr
ri
im
mo
oi
in
ne
e
m
mo
ob
bi
il
li
ie
er
r
e
et
t
i
im
mm
mo
ob
bi
il
li
ie
er
r
t
tr
rè
ès
s
s
su
up
pé
ér
ri
ie
eu
ur
r
à
à
l
la
a
m
mo
oy
ye
en
nn
ne
e
q
qu
ui
i
l
le
eu
ur
r
p
pr
ro
oc
cu
ur
re
e
l
l’
’a
ai
is
sa
an
nc
ce
e
m
ma
at
té
ér
ri
ie
el
ll
le
e
(
(r
ri
ic
ch
he
es
ss
se
e)
).
.
I
Il
ls
s
s
se
e
d
di
is
st
ti
in
ng
gu
ue
en
nt
t
p
pa
ar
r
u
un
n
m
mo
od
de
e
d
de
e
v
vi
ie
e
m
ma
ar
rq
qu
ué
é
p
pa
ar
r
l
le
e
r
re
es
sp
pe
ec
ct
t
d
de
e
v
va
al
le
eu
ur
rs
s
t
tr
ra
ad
di
it
ti
io
on
nn
ne
el
ll
le
es
s
(
(l
la
a
f
fa
am
mi
il
ll
le
e,
,
l
le
e
t
tr
ra
av
va
ai
il
l,
,
l
la
a
r
re
el
li
ig
gi
io
on
n)
),
,
l
le
e
g
go
oû
ût
t
d
de
es
s
«
«
b
be
el
ll
le
es
s
c
ch
ho
os
se
es
s
»
»
(
(q
qu
ui
i
s
so
on
nt
t
a
au
us
ss
si
i
l
le
es
s
p
pl
lu
us
s
c
co
oû
ût
te
eu
us
se
es
s)
)
e
et
t
d
du
u
l
lu
ux
xe
e
d
di
is
sc
cr
re
et
t,
,
l
la
a
d
dé
éf
fi
in
ni
it
ti
io
on
n
d
de
es
s
r
rè
èg
gl
le
es
s
d
du
u
s
sa
av
vo
oi
ir
r-
-v
vi
iv
vr
re
e
q
qu
ui
i
l
le
eu
ur
r
c
co
on
nf
fè
èr
re
e
«
«
l
l’
’h
ho
on
no
or
ra
ab
bi
il
li
it
té
é
»
»
(
(p
pr
re
es
st
ti
ig
ge
e)
).
.
E
En
nf
fi
in
n,
,
l
la
a
c
co
on
nn
na
ai
is
ss
sa
an
nc
ce
e
d
de
es
s
b
bo
on
nn
ne
es
s
f
fi
il
li
iè
èr
re
es
s
s
sc
co
ol
la
ai
ir
re
es
s
l
le
eu
ur
r
p
pe
er
rm
me
et
t
d
d’
’a
as
ss
su
ur
re
er
r
à
à
l
le
eu
ur
rs
s
e
en
nf
fa
an
nt
ts
s
l
le
es
s
m
mê
êm
me
es
s
a
av
va
an
nt
ta
ag
ge
es
s
s
so
oc
ci
ia
au
ux
x
e
et
t
d
de
e
r
re
ep
pr
ro
od
du
ui
ir
re
e
a
ai
in
ns
si
i
l
le
eu
ur
r
g
gr
ro
ou
up
pe
e
s
so
oc
ci
ia
al
l.
.
3
3.
.
D
Di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
e
e
et
t
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
é
:
:
l
l’
’e
ex
xe
em
mp
pl
le
e
d
de
es
s
f
fe
em
mm
me
es
s
H
Ho
om
mm
me
es
s
e
et
t
f
fe
em
mm
me
es
s
s
so
on
nt
t
d
di
is
st
ti
in
nc
ct
ts
s
p
pa
ar
r
n
na
at
tu
ur
re
e
:
:
l
le
eu
ur
r
a
ap
pp
pa
ar
re
en
nc
ce
e
e
et
t
l
le
eu
ur
rs
s
c
ca
ap
pa
ac
ci
it
té
és
s
p
ph
hy
ys
si
iq
qu
ue
es
s
n
ne
e
s
so
on
nt
t
p
pa
as
s
l
le
es
s
m
mê
êm
me
es
s
(
(c
co
om
mm
me
e
l
le
e
m
mo
on
nt
tr
re
e
l
le
es
s
p
pe
er
rf
fo
or
rm
ma
an
nc
ce
es
s
d
de
es
s
a
at
th
hl
lè
èt
te
es
s)
),
,
l
le
e
f
fo
on
nc
ct
ti
io
on
nn
ne
em
me
en
nt
t
b
bi
io
ol
lo
og
gi
iq
qu
ue
e
d
de
e
l
le
eu
ur
r
c
co
or
rp
ps
s
e
es
st
t
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nt
t
(
(n
no
ot
ta
am
mm
me
en
nt
t
a
au
u
n
ni
iv
ve
ea
au
u
d
de
e
l
la
a
r
re
ep
pr
ro
od
du
uc
ct
ti
io
on
n)
).
.
C
Ce
et
tt
te
e
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
e
n
na
at
tu
ur
re
el
ll
le
e
r
re
en
nd
d
l
le
es
s
h
ho
om
mm
me
es
s
e
et
t
l
le
es
s
f
fe
em
mm
me
es
s
c
co
om
mp
pl
lé
ém
me
en
nt
ta
ai
ir
re
es
s
e
et
t
n
ne
e
c
co
on
ns
st
ti
it
tu
ue
e
p
pa
as
s
e
en
n
e
el
ll
le
e-
-m
mê
êm
me
e
u
un
ne
e
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
é.
.
L
L’
’i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
é
n
n’
’a
ap
pp
pa
ar
ra
aî
ît
t
e
en
n
e
ef
ff
fe
et
t
q
qu
ue
e
s
si
i
c
ce
et
tt
te
e
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
e
e
es
st
t
à
à
l
l’
’o
or
ri
ig
gi
in
ne
e
d
de
e
p
pr
ri
iv
vi
il
lè
èg
ge
es
s
s
so
oc
ci
ia
au
ux
x
(
(a
av
va
an
nt
ta
ag
ge
es
s
r
ré
és
se
er
rv
vé
és
s)
)
p
po
ou
ur
r
l
l’
’u
un
n
d
de
es
s
d
de
eu
ux
x
s
se
ex
xe
es
s.
.

5
I
Il
l
f
fa
au
ut
t
c
ce
ep
pe
en
nd
da
an
nt
t
r
re
ec
co
on
nn
na
aî
ît
tr
re
e
q
qu
ue
e
d
da
an
ns
s
l
la
a
p
pl
lu
up
pa
ar
rt
t
d
de
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s,
,
p
pr
ri
im
mi
it
ti
iv
ve
es
s
o
ou
u
t
tr
ra
ad
di
it
ti
io
on
nn
ne
el
ll
le
es
s,
,
l
la
a
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
e
h
ho
om
mm
me
es
s
–
–
f
fe
em
mm
me
es
s
e
es
st
t
d
de
ev
ve
en
nu
ue
e
u
un
ne
e
c
ca
au
us
se
e
d
d’
’i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
s
so
oc
ci
ia
al
le
es
s.
.
L
Le
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
l
le
es
s
p
pl
lu
us
s
f
fr
ré
éq
qu
ue
en
nt
te
es
s
s
so
on
nt
t
l
li
ié
ée
es
s
à
à
l
l’
’e
ex
xe
er
rc
ci
ic
ce
e
d
du
u
p
po
ou
uv
vo
oi
ir
r
(
(l
le
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s
m
ma
at
tr
ri
ia
ar
rc
ca
al
le
es
s
s
so
on
nt
t
d
de
es
s
e
ex
xc
ce
ep
pt
ti
io
on
ns
s
h
hi
is
st
to
or
ri
iq
qu
ue
es
s)
)
a
ai
in
ns
si
i
q
qu
u’
’à
à
l
l’
’o
ob
bt
te
en
nt
ti
io
on
n
d
de
e
p
po
os
si
it
ti
io
on
ns
s
s
so
oc
ci
ia
al
le
es
s
p
pr
re
es
st
ti
ig
gi
ie
eu
us
se
es
s
(
(l
le
es
s
p
pr
rê
êt
tr
re
es
s
e
et
t
l
le
es
s
s
sc
cr
ri
ib
be
es
s,
,
l
le
es
s
a
ar
rc
ch
hi
it
te
ec
ct
te
es
s
e
et
t
l
le
es
s
a
ar
rt
ti
is
st
te
es
s
s
so
on
nt
t
l
le
e
p
pl
lu
us
s
s
so
ou
uv
ve
en
nt
t
d
de
es
s
h
ho
om
mm
me
es
s
c
ca
ar
r
l
l’
’a
ac
cc
cè
ès
s
a
au
u
s
sa
av
vo
oi
ir
r
l
le
eu
ur
r
e
es
st
t
r
ré
és
se
er
rv
vé
é)
).
.
M
Mê
êm
me
e
d
da
an
ns
s
l
le
es
s
s
so
oc
ci
ié
ét
té
és
s
m
mo
od
de
er
rn
ne
es
s
f
fo
on
nd
dé
ée
es
s
s
su
ur
r
l
l’
’a
af
ff
fi
ir
rm
ma
at
ti
io
on
n
d
de
e
l
l’
’é
ég
ga
al
li
it
té
é
d
de
es
s
d
dr
ro
oi
it
ts
s
e
en
nt
tr
re
e
l
le
es
s
c
ci
it
to
oy
ye
en
ns
s,
,
l
la
a
r
ré
ép
pa
ar
rt
ti
it
ti
io
on
n
d
de
es
s
t
tâ
âc
ch
he
es
s
e
en
nt
tr
re
e
l
le
es
s
h
ho
om
mm
me
es
s
e
et
t
l
le
es
s
f
fe
em
mm
me
es
s
r
re
es
st
te
e
p
pr
ro
of
fo
on
nd
dé
ém
me
en
nt
t
m
ma
ar
rq
qu
ué
ée
e
p
pa
ar
r
c
ce
et
tt
te
e
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
é
t
tr
ra
ad
di
it
ti
io
on
nn
ne
el
ll
le
e.
.
P
Pa
ar
r
e
ex
xe
em
mp
pl
le
e,
,
e
en
n
l
l’
’a
an
n
2
20
00
00
0
e
en
n
F
Fr
ra
an
nc
ce
e,
,
d
da
an
ns
s
l
le
es
s
c
co
ou
up
pl
le
es
s
a
av
ve
ec
c
e
en
nf
fa
an
nt
ts
s
d
do
on
nt
t
l
le
es
s
c
co
on
nj
jo
oi
in
nt
ts
s
t
tr
ra
av
va
ai
il
ll
le
en
nt
t
à
à
t
te
em
mp
ps
s
c
co
om
mp
pl
le
et
t,
,
l
le
e
t
te
em
mp
ps
s
p
pa
as
ss
sé
é
p
pa
ar
r
l
le
es
s
f
fe
em
mm
me
es
s
a
au
ux
x
t
tâ
âc
ch
he
es
s
d
do
om
me
es
st
ti
iq
qu
ue
es
s
e
et
t
p
pa
ar
re
en
nt
ta
al
le
es
s
e
es
st
t
p
pr
rè
ès
s
d
de
e
1
1,
,9
9
f
fo
oi
is
s
s
su
up
pé
ér
ri
ie
eu
ur
r
à
à
c
ce
el
lu
ui
i
d
de
es
s
h
ho
om
mm
me
es
s
(
(E
En
nq
qu
uê
êt
te
e
I
In
ns
se
ee
e)
).
.
P
Po
ou
ur
r
s
s’
’o
oc
cc
cu
up
pe
er
r
d
da
av
va
an
nt
ta
ag
ge
e
d
de
e
l
le
eu
ur
r
f
fo
oy
ye
er
r
e
et
t
d
de
e
l
le
eu
ur
rs
s
e
en
nf
fa
an
nt
ts
s,
,
l
le
es
s
f
fe
em
mm
me
es
s
d
do
oi
iv
ve
en
nt
t
a
ai
in
ns
si
i
r
ro
og
gn
ne
er
r
s
su
ur
r
l
le
eu
ur
r
t
te
em
mp
ps
s
p
ph
hy
ys
si
io
ol
lo
og
gi
iq
qu
ue
e
(
(s
so
om
mm
me
ei
il
l
e
et
t
r
re
ep
pa
as
s)
),
,
p
pr
ro
of
fe
es
ss
si
io
on
nn
ne
el
l
(
(s
st
tr
ri
ic
ct
t
r
re
es
sp
pe
ec
ct
t
d
de
es
s
h
ho
or
ra
ai
ir
re
es
s
d
de
e
t
tr
ra
av
va
ai
il
l)
)
e
et
t
p
pe
er
rs
so
on
nn
ne
el
l
(
(l
lo
oi
is
si
ir
rs
s)
).
.
C
Ce
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
o
on
nt
t
c
co
on
nd
du
ui
it
t
l
le
es
s
m
mo
ou
uv
ve
em
me
en
nt
ts
s
f
fé
ém
mi
in
ni
is
st
te
es
s
à
à
r
re
ev
ve
en
nd
di
iq
qu
ue
er
r
l
lo
og
gi
iq
qu
ue
em
me
en
nt
t
p
po
ou
ur
r
l
le
es
s
d
de
eu
ux
x
s
se
ex
xe
es
s
d
de
es
s
r
rô
ôl
le
es
s
i
id
de
en
nt
ti
iq
qu
ue
es
s,
,
n
no
ot
ta
am
mm
me
en
nt
t
a
au
u
n
ni
iv
ve
ea
au
u
p
pr
ro
of
fe
es
ss
si
io
on
nn
ne
el
l.
.
M
Ma
ai
is
s
l
l’
’é
ég
ga
al
li
it
ta
ar
ri
is
sm
me
e
(
(i
id
dé
éo
ol
lo
og
gi
ie
e
f
fo
on
nd
dé
ée
e
s
su
ur
r
u
un
n
p
pr
ri
in
nc
ci
ip
pe
e
d
d’
’é
ég
ga
al
li
it
té
é
a
ab
bs
so
ol
lu
ue
e)
)
p
pe
eu
ut
t
c
co
on
nd
du
ui
ir
re
e
d
da
an
ns
s
c
ce
e
d
do
om
ma
ai
in
ne
e,
,
s
se
el
lo
on
n
l
la
a
s
so
oc
ci
io
ol
lo
og
gu
ue
e
I
Ir
rè
èn
ne
e
T
TH
HE
ER
RY
Y,
,
à
à
r
re
en
ni
ie
er
r
l
la
a
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
e
n
na
at
tu
ur
re
el
ll
le
e
e
en
nt
tr
re
e
l
le
es
s
h
ho
om
mm
me
es
s
e
et
t
l
le
es
s
f
fe
em
mm
me
es
s.
.
I
Il
l
s
se
er
ra
ai
it
t
p
pr
ré
éf
fé
ér
ra
ab
bl
le
e
d
de
e
«
«
r
ré
éi
in
nv
ve
en
nt
te
er
r
l
la
a
m
mi
ix
xi
it
té
é
»
»,
,
c
c’
’e
es
st
t-
-à
à-
-d
di
ir
re
e
u
un
ne
e
s
so
oc
ci
ié
ét
té
é
d
da
an
ns
s
l
la
aq
qu
ue
el
ll
le
e
c
ce
et
tt
te
e
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nc
ce
e
s
se
er
ra
ai
it
t
r
re
ec
co
on
nn
nu
ue
e
e
et
t
l
l’
’é
ég
ga
al
li
it
té
é
r
re
es
sp
pe
ec
ct
té
ée
e.
.
L
Le
e
s
st
ta
at
tu
ut
t
d
de
e
l
la
a
f
fe
em
mm
me
e
n
ne
e
s
se
er
ra
ai
it
t
p
pl
lu
us
s
a
al
lo
or
rs
s
d
dé
év
va
al
lo
or
ri
is
sé
é,
,
b
bi
ie
en
n
q
qu
u’
’i
il
l
c
co
or
rr
re
es
sp
po
on
nd
de
e
à
à
d
de
es
s
r
rô
ôl
le
es
s
s
so
oc
ci
ia
au
ux
x
d
di
if
ff
fé
ér
re
en
nt
ts
s.
.
B
B.
.
L
Le
e
c
cu
um
mu
ul
l
d
de
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
L
La
a
d
di
im
me
en
ns
si
io
on
n
é
éc
co
on
no
om
mi
iq
qu
ue
e
s
se
em
mb
bl
le
e
ê
êt
tr
re
e
a
au
u
c
cœ
œu
ur
r
d
de
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s,
,
d
do
on
nt
t
c
ce
er
rt
ta
ai
in
ne
es
s
s
so
on
nt
t
n
no
ou
uv
ve
el
ll
le
es
s.
.
A
Au
u
t
to
ot
ta
al
l
l
le
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
s
se
e
r
re
en
nf
fo
or
rc
ce
en
nt
t
l
le
es
s
u
un
ne
es
s
l
le
es
s
a
au
ut
tr
re
es
s,
,
p
po
ou
uv
va
an
nt
t
c
co
on
nd
du
ui
ir
re
e
d
da
an
ns
s
l
le
e
p
pi
ir
re
e
d
de
es
s
c
ca
as
s
à
à
l
l’
’e
ex
xc
cl
lu
us
si
io
on
n.
.
1
1.
.
L
La
a
m
me
es
su
ur
re
e
d
de
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
O
On
n
d
di
is
sp
po
os
se
e
d
de
e
c
ce
er
rt
ta
ai
in
ns
s
o
ou
ut
ti
il
ls
s
m
mé
ét
th
ho
od
do
ol
lo
og
gi
iq
qu
ue
es
s
p
po
ou
ur
r
m
me
es
su
ur
re
er
r
l
le
es
s
i
in
né
ég
ga
al
li
it
té
és
s
[
[L
Li
ir
re
e
l
la
a
F
Fi
ic
ch
he
e
–
–
m
mé
ét
th
ho
od
de
e
n
n°
°9
9
p
p.
.4
45
53
3
d
du
u
m
ma
an
nu
ue
el
l
B
Br
ré
éa
al
l]
].
.
P
Pa
ar
r
e
ex
xe
em
mp
pl
le
e,
,
o
on
n
p
pe
eu
ut
t
d
dé
éc
co
ou
up
pe
er
r
l
l'
'e
en
ns
se
em
mb
bl
le
e
d
de
es
s
m
mé
én
na
ag
ge
es
s
e
en
n
d
di
ix
x
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s,
,
o
ou
u
d
dé
éc
ci
il
le
es
s,
,
a
al
ll
la
an
nt
t
d
de
es
s
1
10
0
%
%
l
le
es
s
p
pl
lu
us
s
p
pa
au
uv
vr
re
es
s
j
ju
us
sq
qu
u'
'a
au
ux
x
1
10
0
%
%
l
le
es
s
p
pl
lu
us
s
r
ri
ic
ch
he
es
s
e
et
t
r
re
el
li
ie
er
r
e
en
ns
su
ui
it
te
e
c
ce
es
s
g
gr
ro
ou
up
pe
es
s
à
à
l
la
a
p
pa
ar
rt
t
d
de
es
s
r
re
ev
ve
en
nu
us
s
q
qu
u'
'i
il
ls
s
r
re
eç
ço
oi
iv
ve
en
nt
t
(
(d
dé
éc
ci
il
le
es
s
d
de
e
r
re
ev
ve
en
nu
us
s)
)
o
ou
u
à
à
l
la
a
p
pa
ar
rt
t
d
de
es
s
r
ri
ic
ch
he
es
ss
se
es
s
q
qu
u'
'i
il
ls
s
d
dé
ét
ti
ie
en
nn
ne
en
nt
t
(
(d
dé
éc
ci
il
le
es
s
d
de
e
p
pa
at
tr
ri
im
mo
oi
in
ne
e)
).
.
P
Pa
ar
r
e
ex
xe
em
mp
pl
le
e,
,
l
le
es
s
1
10
0%
%
d
de
es
s
m
mé
én
na
ag
ge
es
s
l
le
es
s
p
pl
lu
us
s
p
pa
au
uv
vr
re
es
s
r
re
eç
ço
oi
iv
ve
en
nt
t
5
5%
%
d
de
e
l
l'
'e
en
ns
se
em
mb
bl
le
e
d
de
es
s
r
re
ev
ve
en
nu
us
s
e
et
t
l
le
es
s
2
20
0%
%
d
de
es
s
m
mé
én
na
ag
ge
es
s
l
le
es
s
p
pl
lu
us
s
p
pa
au
uv
vr
re
es
s
(
(c
ce
e
g
gr
ro
ou
up
pe
e
c
co
on
nt
ti
ie
en
nt
t
d
do
on
nc
c
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%