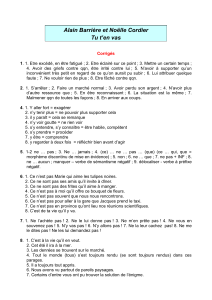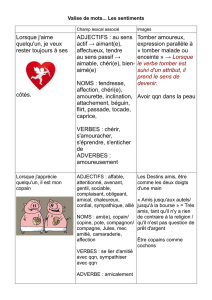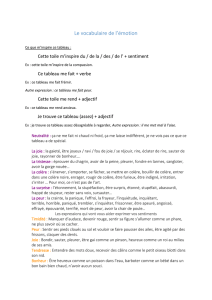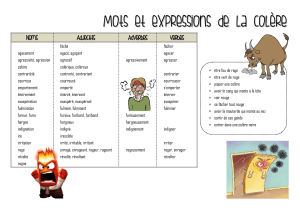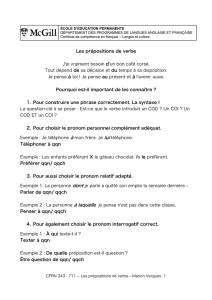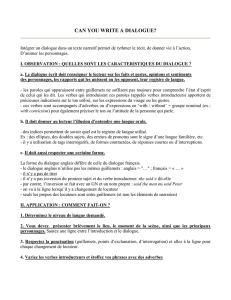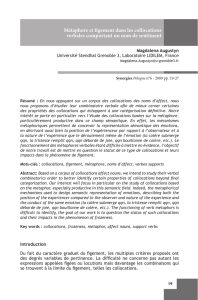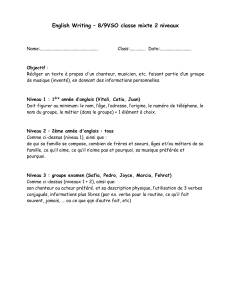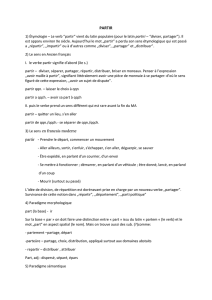Les métaphores spatiales dans le champ des affects

Je nage dans la joie, la colère me submerge….
Etude de quelques métaphores spatiales dans le champ des affects
Magdalena AUGUSTYN & Francis GROSSMANN,
Lidilem, Université Stendhal, Grenoble III
Résumé
L’étude des émotions et des sentiments (regroupés ici sous le terme d’« affects ») est un champ d’étude vivace en
linguistique générale et en linguistique française, et a donné lieu à des études se situant dans des paradigmes
différents (lexique-grammaire, grammaires cognitives, etc.). La présente étude s’efforce de revisiter, pour ce
champ sémantique, l’approche classique du « localisme », en confrontant cette hypothèse théorique à des
données spécifiques, formées par des collocations métaphoriques impliquant l’espace. Deux structures
métaphoriques reliant « expérienceur » et « affect » sont dégagées : la première, statique, présente
l’expérienceur comme situé dans une masse (il nage dans la joie) ou comme « empli » par l’affect (il est plein de
tristesse) ; la seconde, dynamique, traduit la manière dont l’affect intervient sur l’expérienceur (la tristesse le
submerge).
1. Introduction
Lorsqu’on cherche à décrire lexicalement une émotion, ou, de manière plus générale, un affect, on recourt
souvent à des moules métaphoriques de différentes natures. On peut dire, par exemple, que l’on sent l’angoisse
« monter » en nous, que la colère nous « submerge », ou encore que quelqu’un « déverse sa haine » sur autrui.
Dans ces exemples, la dimension spatiale, bien qu’évidente, n’apparaît que secondairement : à travers la
dynamique ascensionnelle impliquée par le verbe monter, ou encore à travers l’action du recouvrement liquide
ou du déversement. Les noms d’affects (cette étiquette conventionnelle voulant regrouper les émotions et les
sentiments, qui sont des noms « intensifs » au sens de Flaux et Van de Velde (2000) présentent en effet les
affects comme des substances, continues, homogènes, non-bornées et le plus souvent non-comptables
1
. Si l’on
observe la manière dont la langue les caractérise, ces substances occupent un certain volume dans l’espace, et y
jouent un rôle dynamique, repérable à travers différents types de construction (la dimension spatiale intervient
ici non seulement à travers des métaphores codées dans le lexique, mais aussi à travers l’utilisation des
prépositions, ou encore à travers la caractérisation aspectuelle des verbes ou de certains noms).
Notre contribution se focalisera sur les aspects linguistiques, distingués du niveau cognitif, même si nous
admettons qu’une part de leur motivation sémantique est liée aux structures cognitives. Nous nous situons sur ce
plan entre la conception autonomiste, telle qu’elle a été défendue dans le cadre de la linguistique structurale
classique et une linguistique cognitive radicale, qui présente les structures linguistiques comme le reflet des
structures conceptuelles. En nuançant, sur ce point, certaines des positions de la sémantique cognitive, nous
définissons les affects comme une catégorie cognitive abstraite dont la conceptualisation est effectuée, non par la
« projection » de structures conceptuelles, issues d’autres domaines, mais à travers des relations complexes qui
relient l’organisation linguistique – et en ce qui concerne notre propos, l’organisation lexicale – à d’autres
aspects anthropologiques (nous revenons sur ce point en 2.1).
Nous nous limiterons ici aux verbes et aux adjectifs qui leur sont fréquemment associés (les collocations
dans lesquelles ils entrent) ainsi qu’aux collocations binominales les plus fréquentes. Outre son intérêt théorique,
cette démarche peut avoir à terme, au moins l’espérons-nous, des retombées pratiques permettant une meilleure
cohérence du traitement lexicographique pour ce champ lexical ainsi que, sous réserve que la réflexion
didactique s’en empare, faciliter l’apprentissage du français, langue maternelle ou étrangère.
Dans la section suivante, nous reviendrons sur la définition que l’on peut donner de la dimension spatiale
comme schème organisateur de l’expression des émotions, en discutant quelques unes des approches issues de la
littérature. Nous présenterons ensuite nos choix méthodologiques. Enfin, notre dernière partie sera consacrée à
1
On trouve cependant des emplois comptables avec les noms d’émotion, comme lorsqu’on parle des « petites peurs qui nous
envahissent parfois ».

l’analyse des données issues du corpus, avec la typologie des différents « types » spatiaux que nous avons
repérés.
2. La spatialité comme schème organisateur de l’expression des émotions
2.1. L’hypothèse localiste
De nombreux linguistes ont souligné le caractère fondamental des expressions spatiales dans les langues,
les expressions non spatiales en étant souvent dérivées. L’hypothèse du localisme (formulée explicitement dans
Anderson, 1971) reconnaît le rôle fondamental de l’espace dans la description linguistique (sémantique et
syntaxique) du monde. Selon Lyons (1980 : 340), « une grande partie de ce que l’on considère généralement
comme métaphorique dans l’utilisation du langage peut s’expliquer en termes « localistes ». Nous avons déjà
signalé nos réserves par rapport à une conception trop directement dérivationniste. Mais, même lorsqu’on se
situe à l’intérieur du paradigme localiste, il reste à préciser l’interprétation que l’on donne du terme, et
notamment la manière dont est défini le transfert qui permet, à travers les structures conceptuelles spatiales,
d’envisager d’autres aspects.
Dans son application radicale, certains linguistes attribuent à l’espace le rôle principal dans la cognition en
général. Nous n’interrogerons pas ici – comme le fait Rastier (2005) le statut donné à la notion d’ « espace »
dans le cadre des sémantiques cognitives, ni l’ontologie naïve qu’elle traduit parfois. On peut rappeler cependant
que chez certains auteurs, (cf. en particulier Lakoff et Johnson, 1980/1985) cette naïveté est assumée et se
présente, habilement, comme consubstantielle à la description linguistique elle-même, celle-ci n’étant rien
d’autre qu’un moyen d’analyser la manière dont l’homme fait usage du langage dans sa vie quotidienne. Nous
retenons essentiellement de la critique de Rastier l’idée que les image schemas spatiaux de la sémantique
cognitive sont à réinterpréter dans une perspective plus sémiotique, instituant une médiation entre le
« physique » et le « représentationnel ». On peut, en effet, chercher à mieux comprendre comment
l’organisation linguistique « travaille » la dimension spatiale, et inversement comment elle est travaillée par elle,
sans pour autant faire de la dimension spatiale le point de départ de toute construction linguistique. Dans cette
perspective, l’espace mobilisé ici n’est pas à considérer comme une structure originelle à partir de laquelle sont
dérivées les structures de la langue, mais comme un construit linguistique parmi d’autres, qui se traduit, surtout
lorsqu’on se fonde sur une approche lexicale, par un ensemble de « micro-mondes » spécifiques, liés à la
manière dont la langue a sédimenté et intégré des données culturelles ou issues de l’expérience. L’idée même de
dérivation (ou de « transfert » conceptuel), si l’on adopte une telle approche, devient inadéquate, et il vaut mieux
effectivement se limiter à utiliser la notion d’espace de manière heuristique, pour débusquer les différents types
d’organisation sémantique propres aux constructions linguistiques. Dans notre approche, nous tenterons donc de
ne pas fétichiser le terme espace en le présentant comme une clé permettant d’ouvrir toutes les portes, mais
plutôt comme un concept anthropologique général permettant de relier/opposer différents types d’expériences
locales et très diverses : physique, culturelle, et linguistique. Par commodité, nous conservons le terme de
métaphore, malgré les problèmes qu’il pose, pour désigner ces va-et-vient entre différents niveaux
anthropologiques.
Le caractère fondamental et universel prêté à la spatialité par la sémantique cognitive explique le fait que
les expressions spatiales soient utilisées pour construire le sémantisme de domaines considérés comme plus
abstraits, ou relevant moins directement de la perception. Comme le rappelle Gingras (1995 : 84), l’approche
localiste « forte » s’est, au moins dans un premier temps, focalisée préférentiellement sur l’analyse des
constructions syntaxiques, en prenant en compte les prépositions, le temps, l’aspect, les constructions infinitives,
ou celles impliquant la possession. Le localisme plus « faible » de Jackendoff (1983) a quant à lui davantage pris
en compte le lexique, notamment en ce qui concerne le sens des verbes. Selon l’ « hypothèse localiste » qu’il
énonce, le sens de tous les verbes peut être construit comme celui de verbes de mouvement ou de situation.
Cependant, comme le remarque encore Gingras (1995 : 87), cette analyse présente, au plan descriptif, un double
inconvénient. D’une part, elle recourt à deux types d’éléments pour analyser le passage de l’interprétation locale
à celle qui en dérive : ainsi, les verbes sont analysés à partir de verbes de mouvement ou de localisation dans
l’espace, tandis que pour les substantifs et les adjectifs, c’est une approche componentielle du sens qui est
mobilisée. D’autre part, le fait de vouloir dériver l’interprétation sémantique de tous les verbes est pour le moins

excessive, puisqu’elle aboutit à mettre sur le même plan un verbe spatial comme aller
2
et un verbe comme
donner. A ces considérations, on peut ajouter le fait (Levin & Hovav, 2005 : 84) que du point de vue de la
structure argumentale, l’hypothèse localiste se révèle peu utile dès lors que l’on cherche à prédire la
configuration et la nature des arguments. Jackendoff (1990) a pris en compte certaines des difficultés
rencontrées par sa théorie en introduisant d’autres types de primitifs dans sa description. Il postule par exemple
un primitif « INCH » (rappelant « inchoatif ») comme nécessaire à la description des verbes de changement
d’état, primitif qu’il substitue au verbe aller (« GO ») utilisé dans ses analyses précédentes. On voit que
l’hypothèse localiste perd ici son caractère direct et exclusif, pour ne plus devenir qu’un élément dans un
système plus complexe.
Etudiant prioritairement des noms, nous ne recourons pas à des verbes conçus comme des primitifs
spatiaux, mais nous nous situerons plus classiquement dans le cadre d’un modèle visant à analyser les traits
sémantiques de ces noms, en précisant ceux de ces traits qui relèvent de la dimension spatiale, ce qui s’avère il
est vrai parfois difficile. Nous refusons cependant une approche qui attribuerait des traits intrinsèques à ces
noms, et nous efforcerons d’identifier ces traits à partir des collocatifs qui leur sont associés de manière
privilégiée.
2.2. La métaphore comme conceptualisation
Le point de vue localiste (conceptualisation de l’abstrait à travers des expressions considérées comme plus
concrètes) trouve une illustration bien connue dans les travaux de Lakoff et Johnson (1980), où la métaphore est
comprise comme principe organisateur de la pensée. En effet, un principe fondamental de l'aspect expérientiel
de la cognition est la théorie selon laquelle les structures conceptuelles prennent leur source, en premier lieu, au
travers de l'expérience du corps et deuxièmement, au travers des capacités de projection des images sur des
structures conceptuelles abstraites (Lakoff, 1986). La notion de « transfert » renvoie ainsi à la métaphore
comprise, d’après les auteurs, comme un processus purement conceptuel et non pas comme un procédé
stylistique
3
). Ce phénomène concerne diverses catégories sémantiques, la métaphore structurant par exemple la
représentation sémantique du temps ou des idées, effectuée principalement au travers des concepts spatiaux.
Cependant, ce point de vue radical peut être relativisé, dès lors que l’on peut montrer que le transfert ne
s’effectue pas toujours de manière unilatérale à partir d’un domaine-source, la métaphore conduisant plutôt à la
création d’un nouvel espace conceptuel, comme dans les modèles plus complexes du type de celui présenté dans
Fauconnier & Turner (1994). Un tel point de vue, s’il est développé par ces auteurs en termes d’ « espace
mentaux » peut aussi être traduit, de manière préférable pour notre problématique, en termes de « micro-mondes
linguistiques » intégrant la dimension spatiale.
3. Quelques principes méthodologiques liés à nos choix théoriques
Nous avons décidé d’abord de nous limiter à la classe des noms d’affects, pour des raisons pratiques, mais
aussi pour une raison théorique. On sait qu’il n’est pas possible de généraliser les constatations faites pour une
catégorie aux mots de la même famille morphologique et qu’il existe, dans une certaine mesure, une sémantique
des catégories, la classe des noms « intensifs » à laquelle appartiennent les noms d’affect ayant une série de
caractéristiques communes.. Cette remarque ne doit pas cependant aboutir à cloisonner de manière étanche les
catégories, le passage de l’une à l’autre s’effectuant fréquemment de manière transitionnelle : par exemple, dans
les collocations, le nom de base support permet souvent de fabriquer une expression verbale, comme par
exemple dans avoir peur. Nous intéressant aux collocations métaphoriques, et excluant une perspective localiste
« forte » qui traduirait par exemple la possession par le mouvement, nous n’avons pas été confrontés cependant
à ce cas de figure. Notre deuxième parti pris réside en effet dans le fait que nous retenons, pour l’analyse, non
pas les noms seuls, mais aussi leur combinatoire lexicale. Nous analysons plus particulièrement, à cet effet, ce
qu’il est convenu d’appeler des collocations, c’est-à-dire des expressions semi-figées dans lesquelles une unité
lexicale (ici le nom d’affect, qui est en l’occurrence la base de la collocation) est associé à un verbe, à un
adjectif, ou éventuellement, même si ce cas présente peu d’intérêt pour les affects, d’un autre nom. Ces associés
seront nommés, suivant la tradition usuelle dans le domaine, ses collocatifs. Le choix d’étudier les collocations a
2
Même si ce statut lui est parfois refusé, étant donné sa polyfonctionnalité. Par verbe spatial au sens strict, nous n’entendons pas
un verbe qui a toujours un sens spatial, mais un verbe dont le sens spatial est prototypique, et bien attesté, ce qui semble bien le cas
pour aller.
3
Là encore, on aurait beau jeu de montrer comment nos sémanticiens oublient parfois la dimension « cognitive » de la rhétorique
ancienne en la réduisant à un jeu stylistique.

selon nous deux intérêts, le premier d’ordre général, le second spécifique de notre objet d’étude. En tant
qu’expressions semi-figées, les collocations renvoient à un niveau intermédiaire entre lexique et discours ; dans
les dictionnaires de langue, elles sont souvent présentées dans les exemples, plutôt que comme entrées. Cette
particularité nous permet de les considérer comme des indices traduisant certaines des tendances du processus de
lexicalisation, ce qui nous permet d’analyser la structuration métaphorique en tant que phénomène relevant de la
langue. En ce qui concerne notre champ d’étude, les collocations, qui sont par définition des expressions
usuelles, nous permettront d’apprécier la manière dont se marque couramment la dimension spatiale pour les
noms d’affect : les métaphores lexicalisées fournissent selon nous un observatoire privilégié pour l’étude
systématique des relations entre spatialité et affects, telles qu’elles se tissent dans la langue. Pour les raisons
théoriques déjà exposées (choix d’une approche localiste « faible »), nous ne considérons que les termes dans
lesquels il nous semble indiscutable qu’un sème impliquant la dimension spatiale est présent. Cependant, le
sème comme on sait, n’est pas visible à l’œil nu, si bien que nous ne nous interdisons pas des discussions sur des
cas limites ou problématiques.
Enfin, le choix de nous limiter aux métaphores lexicalisées, à travers les collocations, nous permet de nous
centrer plus spécifiquement sur le système de la langue, cette dernière n’étant pas conçue comme détachée du
discours, mais comme sédimentant la production discursive. Dans certains cas, les limites entre collocation
métaphorique et association lexicale « occasionnelle » ne sont pas nettes. Ceci est essentiellement dû au
caractère conventionnel de la métaphore qui peut qualifier également des métaphores vives, c’est-à-dire des
associations lexicales à caractère novateur mais dont la structuration métaphorique renvoie aux connaissances
communes. Dans cette situation, un des critères pris en compte est la fréquence au sein du corpus. Ainsi les
expressions avec des combinatoires plus rares et recherchées au plan littéraire ont été exclues de la liste
principale.
Le corpus utilisé à l’appui de cet article est un corpus de romans de 1950 à 2004 (197 textes), d'environ 16
millions de mots. A défaut d’outils automatiques de repérage des expressions métaphoriques, nous avons
procédé d’une manière semi-automatique. La recherche à partir des noms d’affect choisis a permis d’extraire les
combinaisons lexicales. On a procédé ensuite à l'extraction manuelle des collocations métaphoriques, puis à un
tri en fonction de la valeur spatiale. Nous avons également consulté des dictionnaires de la langue française
(Nouveau Petit Robert, Trésor de la Langue Française Informatisé). Ont été exclues les collocations désignant
des manifestations (trembler de peur, etc.) et les marques de verbalisation (hurler/grogner de colère), qui ne
renvoient pas au processus métaphorique proprement dit. Nous avons écarté les métaphores littéraires trop
marquées stylistiquement (de type : la peur rôde dans le noir). Enfin, précisons que le recours à ce corpus
n’avait pas pour but de présenter des tendances statistiques, mais de fournir une base suffisamment réaliste pour
l’étude descriptive.
4. Analyse des données issues du corpus
4.1. La dimension spatiale par rapport aux autres dimensions
L’analyse du champ sémantique des affects tel qu’il peut être observé dans notre corpus – à partir des
collocations incluant des noms d’émotion ou d’affect - montre bien l’intérêt d’une approche modérée du
localisme. Dans ce champ, le réseau métaphorique est structuré d’une manière relativement diversifiée, la
dimension spatiale n’étant pas le mode unique de conceptualisation linguistique, ou plutôt, comme nous l’avons
signalé en introduction, n’en représentant souvent qu’une caractéristique secondaire, indirecte. Nous
commençons par en proposer un inventaire lié au type métaphorique, avant de nous intéresser plus précisément à
leur fonction linguistique.
4.2. Les principaux types métaphoriques observés pour la dimension spatiale
Voici quelques unes des dimensions métaphoriques propres à l’expression linguistique des affects, tels
qu’elles apparaissent à partir de notre corpus.
4.2.1. Dimension/Croissance
Colère :
grande, démesurée, énorme
s’accroît, augmente, redouble, grimpe
augmenter la colère de qqn

Joie :
ample, démesurée, énorme, grande, vaste, sans mesure, sans bornes, profonde
Tristesse :
énorme, grande, infinie, petite, profonde, accrue
grandit
augmenter la tristesse de qqn
Peur :
grande, grandissante, immense, profonde
croît, redouble
augmenter la peur de qqn
Ce premier type, le plus basique – on peut discuter son statut métaphorique – marque l’intensité grâce à
des adjectifs de dimension (grand, immense,…) ou des verbes marquant l’agrandissement ou la croissance. Dans
le champ sémantique des affects, le marquage de l’intensité s’effectue de manière standard grâce à des adjectifs
impliquant la dimension ou la taille (Grossmann et Tutin, 2005) : grand (le plus standard), immense, énorme,
gros. Marqueur d’intensité standard des noms abstraits « intensifs », grand, par exemple, n’est certes plus perçu
dans ces contextes comme spatial. Sa fonction intensive est spécifique des noms « intensifs », et ne s’applique
pas lorsqu’on parle d’un grand arbre par exemple. Les adjectifs « dimensionnels » sont donc en grande partie
dans le champ sémantique qui nous intéresse, devenus de simples outils grammaticaux, des intensifieurs. Une
étude plus fine permet de montrer qu’ils ne sont cependant pas interchangeables, et que les différences d’emploi,
devenues parfaitement conventionnelles, restent motivées. Ainsi, gros accompagne volontiers chagrin lorsqu’il a
une nuance hypocoristique, alors que grand sera préféré dans des emplois moins marqués. Grand et immense
fonctionnent comme standard (le second ajoutant un degré d’intensité), tandis que gros et énorme, qui
impliquent la troisième dimension, ne sont compatibles qu’avec certains noms (on dit un gros chagrin, mais
guère une grosse tristesse).
4.2.2 Métaphore de l’habitation
Colère :
demeure en qqn, habite qqn
Joie :
est en qqn
Tristesse :
demeure en qqn
habité par la/le
On a affaire ici à des collocations verbales, qui spécifient souvent des valeurs aspectuelles (nous y
revenons plus loin), mais qui ont pour caractéristique, au plan métaphorique, de présenter l’affect comme
« habitant » l’expérienceur qui en est le siège. Le procès est présenté comme statif, même lorsque l’affect
pourrait sembler, au départ, encourager un procès dynamique, comme pour colère.
4.2.3 Métaphore du trop plein
Colère :
déborde, éclate, explose / explosion, jaillit
Tristesse :
évacuer sa tristesse
Joie :
débordante
déborde /débordement
explose/explosion
jaillit de qqn, éclate
déborder de, éclater de, exploser de
La dimension spatiale n’est présente qu’indirectement, à travers le mouvement « vers l’extérieur » que décrit la
collocation, et qui évoque un contenu prototypiquement liquide (déborde) ou gazeux (explose).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%