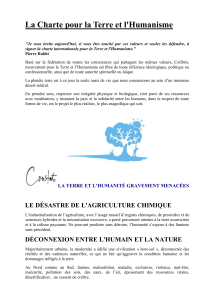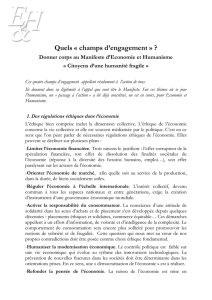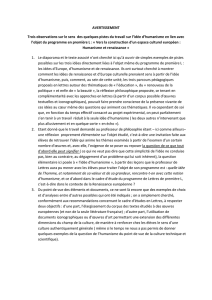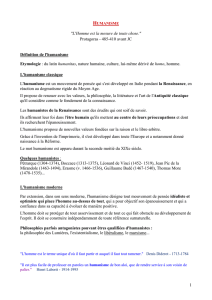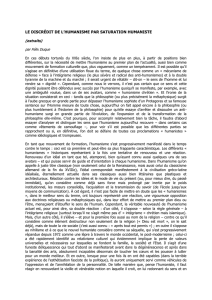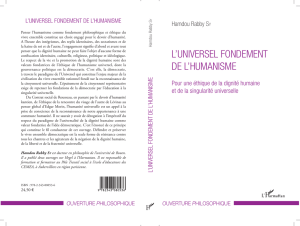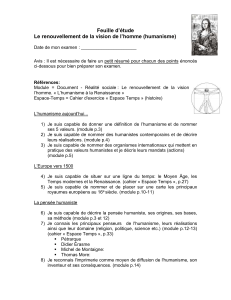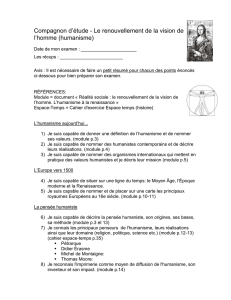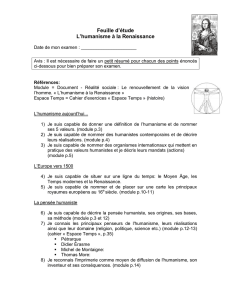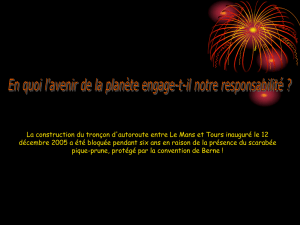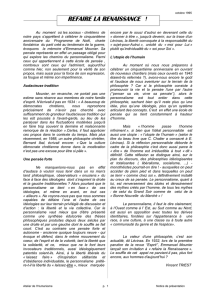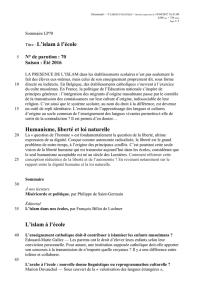A la Gloire du Grand Architecte de l`Univers

0
« Faire ses Humanités pour faire un Humaniste »
Telle pourrait être la devise du Franc-Maçon qui, à l’issue de ses
voyages initiatiques au cours desquels il sera mis en possession des moyens et des objets de la
Connaissance, coopérera à l’exécution du Grand Œuvre. En effet, le symbole commun à tous les
degrés du Rite Ecossais Ancien et Accepté est celui de la construction d’un édifice, construction
du Temple, symbole de l’univers, dont l’homme est lui-même l’image en tant que microcosme.
Ainsi, ayant fait en quelque sorte ses Humanités afin de se construire lui-même, l’éternel
Compagnon que nous sommes participera donc à la construction de l’homme en général, c'est-à-
dire l’autre, le « tout autre », en rendant le monde qui l’entoure plus humain, témoignant ainsi de
son humanisme.
Mais, qu’est-ce que l’humanisme ? et tout d’abord, qu’est-ce que l’humanité ?
Prolégomènes :
La notion d’Humanité :
L’Homme est-il un animal politique et qui parle, comme le voulait Aristote ? Un animal à
deux pieds et sans plume, comme l’affirmait Platon. Un animal raisonnable, comme le pensaient
les stoïciens puis les scolastiques ? Un être qui rit, pour Rabelais ; qui pense, pour Descartes ; qui
juge pour Kant ; qui travaille pour Marx ; qui crée pour Bergson ? Aucune de ces réponses ni
leur somme n’est en fait satisfaisante car l’humanité ne se définit pas par ce qu’elle fait ou sait
faire mais parce qu’elle est… Ainsi l’humanité est d’abord un fait biologique et si elle peut
devenir valeur ou vertu, ce n’est que par la fidélité à ce fait et à cette espèce. « Chaque homme,
disait Montaigne, porte la forme entière de l’humaine condition ».

1
On naît homme, on devient humain ; mais qui échoue à le devenir n’en est pas moins
homme pour autant. L’humanité n’est pas une création mais bien plus une transmission ; elle est
ainsi naturelle avant que d’être culturelle, ce n’est pas une essence, c’est une filiation : Homme
parce que fils de l’homme…
Que l’humanité soit d’abord une espèce animale, c’est ce qui pose aussi, et surtout, la
question de l’humanisme comme morale. Il y a donc tout d’abord un humanisme pratique qui
consiste à accorder une certaine valeur à l’humanité, c'est-à-dire à s’imposer un certains nombre
de devoirs et d’interdits. Ainsi, si les hommes ont des droits, c’est d’abord que nous avons des
devoirs, tous les uns par rapport aux autres : agir humainement et pour l’humanité.
Philosophie et Humanisme :
L’Antiquité, et singulièrement l’Antiquité grecque, est le lieu de naissance de la
philosophie ; elle contient en germe tout le développement de celle de l’occident. Des
philosophies comme celles de Platon et d’Aristote ne sont pas des approximations grossières que
la philosophie moderne aurait dépassées, mais des systèmes exemplaires, sinon complètement
achevés, qui continuent, peut-être en raison de leur ouverture, à solliciter notre réflexion, au
même titre que les systèmes de Descartes ou de Kant. La philosophie grecque, relayée à partir du
Ier siècle av. J.C. par la philosophie romaine, a exercé une influence déterminante sur les formes
de pensée caractéristiques de la civilisation occidentale et qui se sont universalisées au point de
régir aujourd’hui notre planète tout entière. En épurant le mythe de ses ambiguïtés, la
philosophie grecque n’a pas été seulement le banc d’essai de la pensée rationnelle ; elle a fourni
les cadres conceptuels de la grammaire, de l’administration, de la science et, finalement, de
l’exploitation technique de la nature.
D’un autre côté, la philosophie grecque, dans ses différentes écoles, a développé un art de
vivre, de se comporter à l’égard de la nature, des dieux et des autres hommes. Cet art, appelé
aussi « sagesse » (sophia), exige que l’homme prenne soin de soi ou ait le « souci de soi », qu’il
domine ses passions, qu’il se prépare à la mort. Les problèmes pratiques eux-mêmes ne peuvent
être résolus sans le recours à la théorisation, sans le passage au concept. Pour apprendre à
devenir vertueux, dit Platon dans La République, il faut « prendre le circuit le plus long » :

2
non l’imitation d’un héros, mais l’apprentissage de la science, qui, après une longue ascension,
permet à l’apprenti-philosophe d’atteindre la science la plus haute : celle du Bien. La philosophie
n’est sagesse, pratique du bien, que parce qu’elle est d’abord le long détour intellectuel qui
permet d’y accéder et d’en fonder rationnellement l’exigence.
On pourrait en dire tout autant de notre Voie Initiatique : « L’épreuve de la Terre qu’est
pour nous le commencement de notre vie maçonnique, est-ce une préparation à mourir ? Non,
c’est une préparation à une certaine façon de vivre parce que nous passons notre vie à mourir »
(G Komar).
Humanités et Humanisme :
Au sens premier (XVI° siècle), l’expression « faire ses humanités » (1539) signifiait
étudier la langue et la littérature gréco-latine… Par extension, il s’agit de nos jours d’études plus
générales (ex. en Belgique : études secondaires), même orientées sur la littérature et les sciences
humaines. L’humaniste (1677) était un homme lettré qui se consacrait à l’étude des écrivains
Antiques et à en faire connaître les œuvres et les idées… Ce terme a désigné tout d’abord une
attitude intellectuelle qui, historiquement, s’était manifestée au temps de la Renaissance. Il
s’agissait au début d’une discipline de l’intelligence plutôt que d’une conception philosophique.
Le mot se rattachait étroitement à celui d’« humanités » par son étymologie. « L’humaniste était,
dans cette vue, l’homme qui a cultivé son esprit, qui a extrait de certaines disciplines, telles que
les langues anciennes, des principes de pensées » (Daniel Rops : Ce qui se meurt). L’humanisme
définit ainsi un mouvement de libération de l’homme par la redécouverte des valeurs morales et
intellectuelles encloses dans la littérature gréco-latine et leur adaptation à des besoins nouveaux.
Mais parler d’humanisme c’est aussi revenir inévitablement aux sources moyenâgeuses
de la culture méditerranéenne, donc de « Mare Nostrum », et plus particulièrement celles du
courant précurseur Arabo-Andalou, né au XII° siècle en Espagne… En effet, au temps de
Maïmonide, Médecin et philosophe né en 1138 à Cordoue et mort au Caire en 1204 (Serait-ce
l’endroit d’où sont nées les Voies Initiatiques de notre culture, comme le lieu où elle y
retournent ? Cf. Guénon), l’Espagne musulmane, « l’Andalus », fut une terre de philosophes de
l’une ou l’autre religion, assez nombreux pour se répartir en tendances différentes, à la
confluence des cultures grecque, latine, hébraïque, chrétienne et musulmane, et assez tolérants
pour y construire une véritable Culture nouvelle et enrichie de mutuelles différences (Cf.
Université, bibliothèque… etc.).

3
Maïmonide partagera avec bien d’autres les concepts ontologiques d’Avicenne (X° siècle)
et la rigueur démonstrative mise au point par Aristote (IV° av. J.C.), en affirmant qu’il ne faut
point mélanger deux types de connaissance : celle des prophètes et celle des philosophes ! Il
s’agit donc déjà, à cette époque, d’une réflexion relevant de deux usages de la vie apparemment
irréductibles l’un à l’autre : la tension entre la foi en l’intellect, d’une part, et l’amour de la Loi,
d’autre part ; un double postulat vers la solitude philosophique et vers l’existence
communautaire…
Du point de vue de la religion, ce que les humanistes de la Renaissance, tels Pic de la
Mirandole en Italie au XV° siècle, Erasme en Hollande au XVI°, etc., ont retenu de ce pèlerinage
aux sources, c’est que la philosophie platonicienne ou stoïcienne (Zénon, au III° av. J.C. puis
Epictète et Sénèque, 50 ap. J.C.) est une propédeutique à la philosophie chrétienne et que la
fréquentation des grands auteurs, tels que Platon (IV° av. J.C.) ou Cicéron (50 av. J.C.), peut
avoir une finalité éthico religieuse et que le monde de la culture est « Un ». De même, Bérulle
(en France, au XVI°), s’opposant à la dévotion, préparera ainsi la voie à Pascal (fameuse nuit
mystique du 23 Novembre 1654 !) dans une spiritualité héritée de Saint Augustin (III°-IV° ap.
J.C.).
Sur le plan politique, le pacifisme, l’esprit d’œcuménisme et parfois de cosmopolitisme,
l’amour du peuple et la volonté d’équilibre et d’harmonie entre les pouvoirs, sont des traits
communs à tous les humanistes du XV° et XVI° siècle. Ils sont alors volontiers réformateurs
(More, Rabelais) : le sens de l’histoire et de la continuité du destin de l’humanité leur fait
préférer une réforme intérieure à un renversement brutal des institutions sociales, car ils restent
persuadés du triomphe nécessaire de l’esprit.
Au XVIII° siècle (1765), il s’agit d’un mouvement caractérisé par un effort pour relever
la dignité de l’esprit humain et le mettre en valeur en rénovant la culture Antique. L’humanisme
oppose donc au formalisme scolastique (enseignement théologique du XI° au XVII°) une culture
plus vivante, un ensemble d’études plus humaines. Par lui, se répand le meilleur de la sagesse
Antique. Fort de la philosophie païenne, il aide à secouer le joug de la théologie et révèle le
monde des idées pures… A l’esprit de soumission il substitue l’esprit d’examen, le goût de la
recherche critique. De là un vaste effort de rénovation spirituelle et esthétique (Javinski :
Histoire de la littérature française). En fait, l’humanisme est simplement le fait de se rendre
compte que le problème philosophique concerne des êtres humains s’efforçant de comprendre un
monde d’expériences humaines avec les ressources de l’esprit humain (Schiller).

4
Au XIX° siècle (1877), l’humanisme prend le sens général de formation de l’esprit
humain par la culture littéraire ou scientifique (sciences humaines). Ainsi, une culture générale
vraiment digne de ce nom devra toujours comporter, en dehors de l’acquisition des
connaissances scientifiques, une réflexion approfondie sur la complexité de la personne humaine
et sur les divers aspects qu’elle présente, une initiation aussi à l’art de sentir et de vouloir. Louis
de Broglie d’affirmer : « Un humanisme moderne, même s’il doit devenir tout à fait indépendant
de la culture gréco-latine, devra conserver ce caractère et, pour cette raison, il devra toujours
réserver une place importante aux études littéraires » (La culture scientifique).
Par son aspect philosophique actuel, c’est une théorie ou une doctrine, qui prend pour fin
la personne humaine et son épanouissement, qui s’attache à la mise en valeur de l’homme par les
seules forces humaines. Ainsi Sartre a-t-il pu dire : « Par humanisme on peut entendre une
théorie qui prend l’homme comme fin et comme valeur supérieure et par chacun de ses actes,
tous exemplaires, engage l’humanité entière » (L’existentialisme est un humanisme…). C’est en
outre une conception philosophique de la vie d’après laquelle l’homme, du point vue moral, doit
s’affranchir de toute croyance religieuse et construire son avenir en se fondant sur les forces
humaines … Marx ou Nietzsche en sont des exemples classiques. Depuis lors, des philosophes,
des éducateurs et des politiques ont mis en question un grand nombre de valeurs sur lesquelles
reposait naguère l’idée que la plupart des hommes se faisaient de leur propre destin et du progrès
de la civilisation. Mouvement historique, force socioculturelle, l’Humanisme n’exprime pas une
philosophie déterminée mais une synthèse harmonieuse (syncrétisme) de l’Erudition et de la
Vertu : Ces sciences (« studia humanitatis » & « litterae humaniores ») qui nous rendent « plus
humains » sont précisément celles qui doivent nous permettre de réaliser en nous un modèle
anthropologique, voire un idéal…
Humanisme et Franc-Maçonnerie :
Dans ses discours (1721/1736), Michel de Ramsay affirme : « Le monde entier
n’est qu’une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un
enfant…Nous voulons réunir tous les hommes d’un esprit éclairé et d’une humeur agréable, non
seulement par l’amour des beaux-arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, où
l’intérêt de la confraternité devient celui du genre humain entier» …
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%