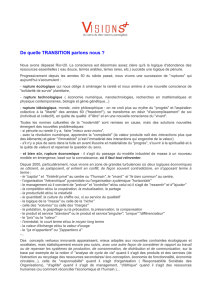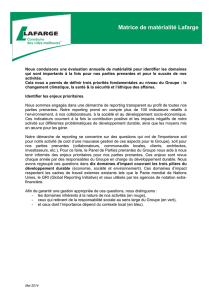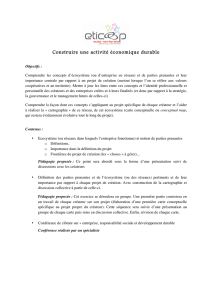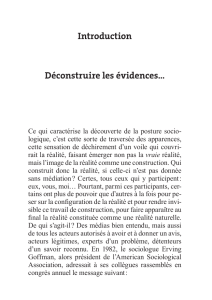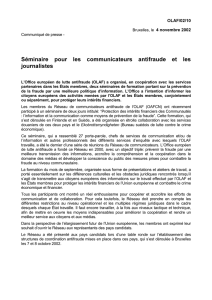La crise, une affaire de valeur(s)

1
La crise, une affaire de valeur(s)
"Pour ou contre l'austérité? Faut-il réduire la dette, le coût du travail?"... Ces questions
simplistes sont utiles pour entretenir les affrontements médiatiques mais absolument pas pour
répondre à la crise, relancer l'économie européenne et l'emploi. Les « bonnes » questions
restent tabous : presque personne n’ose à la radio, la TV, remettre en cause nos pratiques
d’organisation et de management farouchement défendues par des élites que nos prestigieuses
grandes écoles continuent à formater. On s’obstine à ignorer qu’en Occident et
particulièrement en France, nous gérons plutôt stupidement les intelligences disponibles, nous
dépensons mal les crédits et les ressources matérielles (de moins en moins) disponibles ; nous
entretenons un gachis insupportable dans le contexte actuel. Il y a trois décennies déjà, Hervé
Sérieyx expliquait que Toyota réussissait à tailler des croupières à Detroit parce qu’il avait
refusé l’organisation taylorienne et ne traitait pas ses ouvriers comme des robots. Des dizaines
d’experts américains, européens, du syndicaliste italien Bruno Trentin aux Français Alain
d’Iribarne, Yann Algan et Pierre Cahuc, François Dupuy, Pierre-Yves Gomez, Thomas
Philippon, la liste n’est pas exhaustive,
1
répétent dans le désert ces évidences : les
organisations rentables dans la durée doivent leur succès économique durable à des choix
internes, pas au contexte. Elles créent plus de valeur parce qu’elles mobilisent mieux les
talents et la volonté de tous leurs employés, à tous les niveaux ; pour cela, elles donnent du
sens au travail de chacun, en respectant la dignité et les légitimes attentes de toutes les parties
prenantes internes et externes, pas seulement celles des actionnaires. Des hommes d’industrie,
Francis Mer, Jean-François Zobrist, pour ne citer qu’eux, corroborent ces conclusions
illustrées au quotidien par le fonctionnement d’entreprises très diverses. Elles vont de la
coopérative espagnole Irizar à la société familiale française Favi, aux américains Costco,
concurrent de Wal Mart, et SAS Institute, l’informaticien dont le propriétaire refuse d’entrer
en Bourse.
Pourquoi ces évidences sont-elles ignorées par les Etats, alors que leur prise en compte
réduirait de 30% les dépenses de l’administration selon une estimation d’Hervé Sérieyx ? On
aurait évité les coûteux désatres des Alcatel et autres Thomson, les plans sociaux, c’est-à-dire
associaux, de nombre de grands groupes, les destructions constantes d’emplois et de talents ?
Pour des raisons de vision et de valeurs. La vision froide, rationalisante mais erronée, imposée
par les néo-libéraux, occulte une donnée essentielle : si les coûts sont objectifs, la valeur
produite est subjective. Un produit, un service ne créent de valeur économique que si
l’utilisateur visé considère, d’après ses critères personnels, qu’ils lui apportent un avantage
personnel. Or l’organisation jacobine, pyramidale, le management par le mépris, où les chefs
n’écoutent ni subordonnés, ni clients, rend incapable les dirigeants d’imaginer ce que désirent
des personnes différentes d’eux. C’est contre-productif à terme, mais on continue, pour deux
raisons, l’une subjective, nombre de dirigeants sacrifiant tout à leur ego, l’autre très
matérialiste : la valse des PDG, rémunérés selon la valeur des actions, incite à gérer le court
terme, à flatter la Bourse au lieu d’étayer l’avenir de l’entreprise à long terme par des
investissements réduisant les résultats immédiats.
Sommes-nous obligés de continuer ainsi ? Absolument pas si nous trouvons le courage de
rompre avec le paradigme néo-libéral et si nous honorons des valeurs impliquant une vision
de long terme et la recherche du bien-public. Cette option éthique et mentale dicte un principe
simple : les organisations publiques et privées doivent créer de la valeur non seulement pour
quelques intérêts particuliers mais pour l’ensemble des parties prenantes, Société y comprise.
1
La malédiction du paradigme spécieux, Futuribles n° 394. Mai 2013, pp. 104-107.

2
Utopique ? Révolutionnaire ? C’est le credo des entreprises citées plus haut et, en France,
d’un mouvement d’entrepreneurs, le Centre des Jeunes Dirigeants…depuis 1938.
Les outils pour passer à l’acte existent. Ce sont notamment les méthodes proches de l’analyse
de la valeur, datant pour l’essentiel de l’après-guerre. Les Japonais, pour bâtir leur
développement, se sont servi massivement de ces outils qui permettent généralement de
réduire les coûts de 10 à 30% sans perte de qualité. L’analyse de la valeur est une application
collective du bon sens. En gros, on réunit autour d’une table les fonctions impliquées, de la
conception à la livraison ; on examine ensemble si les dépenses engagées à chaque stade, pour
chaque partie du système produit, sont justifiées par la valeur perçue par l’utilisateur futur.
Pourquoi ne généralise-t-on pas de telles méthodes ? On m’a expliqué chez un fournisseur de
l’aéronautique que les relations conflictuelles entre les personnes que l’on aurait dû
rassembler avaient fait échouer les tentatives. Un consultant a récemment claqué la porte d’un
client qui refusait d’élargir le champ du problème traité, ce qui aurait permis des
améliorations évidente mais obligeait d’impliquer d’autres collègues. Le management par la
mise en rivalité des gens et des équipes bloque la progression de ces méthodes. Un autre frein
est la peur de la transparence. Un expert qui proposait à une grande administration française
une étude pour cerner les objectifs les plus pertinents s’est vu répondre que le directeur était
un visionnaire qui avait déjà, tout seul, fixé les objectifs…
Imagine-t-on les projets de loi passés publiquement au crible de l’analyse de la valeur : on
comprendrait pourquoi la majorité des lois attendent toujours leurs décrets d’application. Si
un exercice collectif de créativité critique avait démontré qu’ils n’avaient pour but que de
réagir à un sondage, de flatter l’opinion publique ou de pérenniser le nom de leur auteur, les
textes n’auraient pas été soumis aux votes des parlementaires et la Cour des comptes aurait
moins de travail.
Dans les ministères concernés, on se rend compte qu’il y a des centaines de procédures
d’aides à l’innovation et d’organismes qui souvent s’ignorent, font double emploi, et que les
PME s’y perdent. Un gouvernement qui ferait le choix à la fois de la transparence et de
démarches participatives pour la modernisation de l’État, avec un pilotage par le sens,
obtiendrait des résultats rapides et durables en faisant exploiter par les acteurs concernés les
outils de créativité. Les acteurs responsabilisés sauraient que leur place personnelle ne serait
pas en cause, l’objet étant de mieux employer les ressources humaines et financières pour
créer ensemble plus de valeur, ce qui légitimerait et financerait l’emploi de chacun.
Des problèmes actuellement insolubles, comme la montée de frais de santé bientôt
insupportables pour les États, apparaissent sous un autre jour si l’on applique par exemple le
lean. Il s’agit d’une procédure d’amélioration continue impliquant une forte participation du
personnel. Sa mise en œuvre apporte des résultats spectaculaires, comme dans ce centre de
lutte contre le cancer où il a été possible de faire en sorte que les patientes obtiennent un
rendez-vous avec un médecin dans les trois jours suivant leur premier appel au lieu de 18 à 57
jours auparavant. D’où un net soulagement des patientes, mais aussi du personnel dont les
conditions de travail très tendues ont été apaisées. Tout cela sans nouveaux moyens humains
ou matériels. Encore faut-il que les différentes professions concernées acceptent de réfléchir
ensemble et que des égocentrismes personnels ne viennent pas tout perturber.
La question de fond n’est pas faut-il créer de la valeur, mais pour qui, pourquoi, et à quelle
échéance, cette valeur ? Une fois le court-termisme du tout financier écarté et l’option du bien
commun affirmée face aux pressions des intérêts de quelques lobbies, tout devient possible.
C’est donc bien une question de valeurs, avec un s. L’analyse de la valeur, le lean, ont plus
d’une fois été dévoyés pour réduire les coûts en dégradant la qualité au détriment des clients,
pour tailler dans les effectifs en réduisant la résilience d’une entreprise et en créant à terme un
coût social considérable. Mais si l’on inscrit son action dans le long terme, ces méthodes

3
montrent que des relations win-win avec toutes les parties prenantes sont possibles,
nécessaires et rentables.
Nous n’avons évoqué que deux méthodes, mais on en compte des dizaines basées sur ces
principes Valeur(s), dont les experts s’ignorent souvent. Le président de l’association
française pour l’analyse de la valeur (afaV), Olaf de Hemmer, a pris l’initiative de réunir 19
experts français et suisses de méthodes d’amélioration de la performance et de les amener à
un début de collaboration sous le prétexte d’un ouvrage collectif
2
. Chacun y a recherché des
liens entre sa pratique et celles de ses collègues.
Cette juxtaposition de témoignages allant de l’économie de la fonctionnalité à la stratégie
Océan Bleu en passant par le pilotage par les processus et la création de valeur par les achats
montre que toutes ces méthodes ont en commun une approche systémique et la prise en
compte de facteurs immatériels. Il y aurait intérêt à approfondir ce qui les relie, en dépassant
la tentation de se distinguer des autres pour mieux « se vendre ». Telles quelles, plus et mieux
exploitées, elles permettraient de sortir de l’impasse où nous mènent des politiques réduisant
la dette par des contraintes de moins en moins supportables, au lieu de chercher à agir
autrement avec la participation et dans l’intérêt de tous. Construirons-nous des entreprises et
une économie plus fortes, produisant plus de valeur, plus respectueuses de l’environnement et
du bien commun ? La réponse dépend des valeurs qui l’emporteront dans notre société. C’est
une question éminemment politique. André-Yves Portnoff
Directeur de recherche associé à Futuribles international.
Professeur associé au MBA de la HEG, Fribourg.
2
Valeur(s) & Management. Des méthodes pour plus de valeur(s) dans le management. Ouvrage dirigé par Olaf
de Hemmer Gudme et Hugues Poissonnier. Préface de Joël de Rosnay. Editions EMS. Avril 2013.
1
/
3
100%