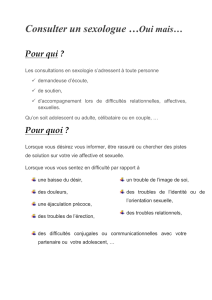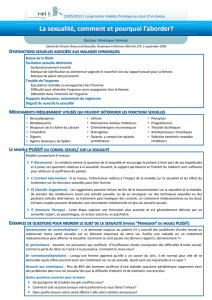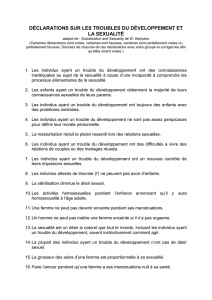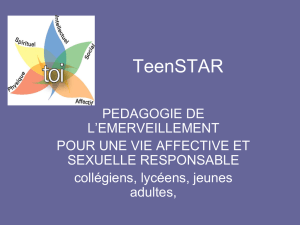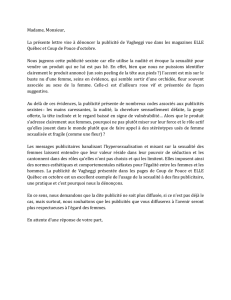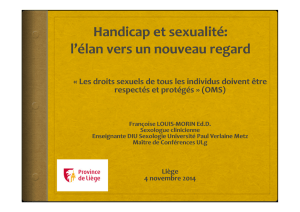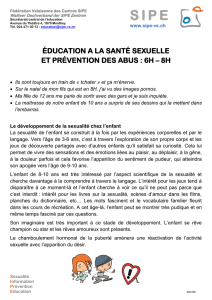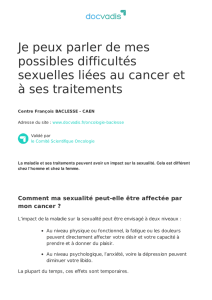La nouvelle normativité des conduites sexuelles

1
La nouvelle normativité des conduites sexuelles
ou la difficulté de mettre en cohérence les expériences intimes
Michel Bozon (INED)
18/02/04
Introduction
Si l’on veut dégager les grandes caractéristiques de ce qui serait une nouvelle normativité
contemporaine des conduites sexuelles, une première interprétation doit être écartée: l’idée,
pourtant répandue, qu’il se serait produit une « révolution sexuelle », et qu’elle aurait
contribué, pour le meilleur ou pour le pire, à lever les contraintes et les normes antérieures
en matière de sexualité
1
. Cette représentation des changements et de l’évolution normative
dans les trois ou quatre dernière décennies ne résiste pas à un examen approfondi. A la
manière de Michel Foucault, et dans le prolongement de la critique que dès 1976, il faisait de
«l’hypothèse répressive » (c’est-à-dire de l’idée commune selon laquelle le seul élément qui
affecterait les manifestations de la sexualité humaine serait le degré de répression auquel la
pulsion sexuelle est soumise), on se propose de décrire les transformations des dernières
décennies comme le passage d’une sexualité construite par des contrôles et des disciplines
externes aux individus à une sexualité organisée par des disciplines internes. Parallèlement,
on pourrait dire qu’un des effets de la médicalisation de la sexualité, qui a vivement
progressé dans cette période, est que les problèmes du sujet et de son engagement dans la
sexualité ont cessé d’être principalement appréhendés comme des problèmes moraux pour
tendre à être interprétés comme une question de bien-être individuel et social, dont rendent
compte la notion de santé sexuelle (Giami, 2003), et celle de comportement responsable.
Plus que d’une émancipation, d’une libération ou d’un effacement des normes sociales, on
pourrait parler d’une individualisation, voire d’une intériorisation, produisant un déplacement
et un approfondissement des exigences et des contrôles sociaux. Notre argument est
parallèle à celui d’un Ehrenberg (1998) lorsqu’il décrit le déclin historique de l’angoisse
névrotique, qui était liée au conflit du désir et des interdits sociaux, et la montée
contemporaine de la dépression, caractéristique d’une société qui exige des individus un
niveau élevé d’autonomie. Dans un univers qui ne cesse pas d’être structuré en profondeur
1
Cette idée, sous-produit d’une vision vieillie de la sexualité (Bozon, 2002), apparaît dans de nombreux essais,
très inégaux dans leur contenu. Pour quelques exemples, voir Bruckner et Finkielkraut (1977), Guillebaud
(1998), Folscheid (2002), Badinter (2003). C’est également un topos de la représentation médiatique courante
des évolutions de la sexualité.

2
par les inégalités entre sexes et entre classes mais où les normes en matière de sexualité se
sont mises à proliférer plutôt qu’à faire défaut, les individus sont désormais sommés d’établir
eux-mêmes, malgré ce flottement des références pertinentes, la cohérence de leurs
expériences intimes. Ils continuent néanmoins à être soumis à des jugements sociaux stricts,
différents selon leur âge et selon qu’ils sont hommes ou femmes.
Normes temporelles
Un bon exemple du caractère complexe voire contradictoire des changements
contemporains est la manière dont les conduites sexuelles sont référées désormais à la
temporalité biographique, qui est une composante de la normativité au sens large : à quel
moment devons-nous ou pouvons-nous faire telle ou telle chose ? On peut paradoxalement
défendre aussi bien l’idée d’une disparition des seuils d’âge et d’un élargissement inouï des
possibles, que celui d’une normalisation biographique de la sexualité.
D’un côté, l’activité sexuelle n’est plus l’attribut de l’individu marié, en âge d’avoir des
enfants. Il se produit un allongement de la vie sexuelle, aux jeunes âges et surtout aux âges
avancés, ainsi qu’un déroulement de moins en moins linéaire des biographies sexuelles en
fonction de l’âge. Ce processus renvoie à une réorganisation plus générale des âges (qui se
manifeste aussi par exemple dans le déroulement plus heurté des carrières
professionnelles), en raison de la déstandardisation des transitions et parcours
biographiques, du caractère de plus en plus réversible des passages (il y a par exemple
beaucoup moins de probabilité de rester toute la vie en couple avec la même personne ou,
toutes proportions gardées, dans le même emploi) ou de l’augmentation de la mobilité
conjugale (dont témoigne la croissance des situations de monoparentalité et de
recomposition familiale) : l’âge d’un individu est de moins en moins prédictif de son statut
matrimonial (cohabitant, marié, divorcé, remarié, célibataire) ou de son style d’activité
sexuelle et les transformations des conditions sociales du vieillissement au fil des
générations ont favorisé l’aspiration et l’accès à une activité sexuelle prolongée.
Mais d’un autre côté on observe des signes de normalisation forts. L’entrée dans la sexualité
adulte, au sens du premier rapport sexuel, s’effectue aujourd’hui dans un intervalle de temps
de plus en plus restreint autour de l’âge médian, deux ou trois ans. Cette forte
synchronisation temporelle des premières expériences de la sexualité se substitue à la
relative dispersion des comportements de naguère. L’existence de groupes de pairs, qui
jouent un rôle majeur dans l’élaboration des conduites adolescentes et juvéniles, contribue à

3
ce resserrement
2
, de même que la massification scolaire, avec cet effet que les premières
expériences se trouvent désormais concentrées vers la fin de la scolarité secondaire. De
même, nous y reviendrons à propos de la norme contraceptive, il y a une normalisation de la
définition sociale du bon âge pour avoir des enfants, qui qualifie comme déviantes les
grossesses avant 25 ans ou après 40 ans, voire plus tôt. Enfin si la ménopause a cessé
d’être identifiée à l’arrêt de l’activité sexuelle pour les femmes, elle est de plus en plus
médicalisée, avec le développement des traitements hormonaux substitutifs.
Avec les évolutions de la temporalité biographique de la sexualité, on peut dire que nous
sommes entrés dans une société où règne une obligation diffuse et implicite de ne jamais
interrompre ni en finir avec l’activité sexuelle (une obligation au sexe), quel que soient notre
état de santé, notre âge, notre statut conjugal. Ceux qui n’ont pas d’activité sexuelle le
dissimulent ou se justifient. Cette exigence de continuité de l’activité sexuelle peut être
considérée comme une nouveauté contemporaine.
Contexte social de la nouvelle normativité
De nombreux changements sociaux ont contribué à l’émergence d’une normativité qui ne
repose plus sur la perception par les acteurs qu’il existerait des principes absolus,
intangibles, externes à eux-mêmes.
La diffusion de la contraception médicale a fait reculer le poids des grossesses non prévues :
la disparition de cette peur et le fait que les nouvelles méthodes de contraception soient
mises en œuvre par les femmes permettent l’émergence de nouvelles manières de vivre
l’expérience sexuelle. Féminisme et mouvement des femmes ont contribué à légitimer un
discours et des aspirations à l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la
vie. L’autorité et la légitimité morale des générations adultes et de l’institution familiale ont
par ailleurs décliné, au profit de réseaux de pairs et d’amis, fonctionnant sur un mode électif
et à l’influence mutuelle. L’allongement général de la scolarité contribue au déclin de
l’autorité adulte
3
, en même temps qu’il restructure et uniformise les trajectoires de jeunesse.
Le mariage institutionnel s’est fortement affaibli, ce qui n’équivaut pourtant nullement à une
disparition ni même à un déclin de l’aspiration au couple : les parcours sexuels, affectifs et
conjugaux se complexifient et se déstandardisent, combinant de plus en plus souvent des
séquences de vie conjugale et de vie sans partenaire stable. François de Singly montre par
2
Lagrange et Lhomond (1997) montrent que le passage à l’acte chez les garçons et les filles est très lié au fait
que les membres du groupe de pairs l’aient effectué.

4
ailleurs dans Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune (2001) que la sphère
familiale s’est mis à accorder une plus grande marge de manœuvre à ses membres, en
particulier aux jeunes et aux femmes, qui ont gagné une remarquable autonomie matérielle
en raison de leur participation croissante au marché du travail. Dans le même temps, la
division sexuelle du travail domestique et parental présente une grande immobilité (Brousse,
1999), qui contraste avec l’idéal d’égalité entre les sexes. L’idée de normalité sexuelle a été
bousculée, avec les débats autour du PACS (partenariat civil enregistré), l’augmentation de
la visibilité de l’homosexualité, l’émergence du thème de l’homoparentalité. La
médicalisation de la sexualité et de la vie en général a fortement crû depuis les année 1960
(Aïach, Delanoé, 1998) : en témoignent par exemple le développement des médicaments de
confort (Prozac, psychotropes, etc.), dénommés dans les pays anglo-saxons médicaments
de « style de vie » (lifestyle drugs), et la tendance à l’effacement des distinctions entre effets
pathologiques et effets normaux du vieillissement. L’épidémie de sida, dont l’histoire a déjà
connu bien des phases (avec notamment l’arrivée des traitements en 1996), a eu un certain
nombre d’effets sur la manière dont la sexualité était vécue, en particulier par les jeunes, les
homosexuels, les personnes qui ont plusieurs partenaires. Les représentations explicites de
l’activité sexuelle sont devenues abondantes et beaucoup plus diverses qu’on ne le dit
souvent (littérature, cinéma, internet…), au point que le consensus établi de longue date sur
la différence entre érotisme et pornographie a été remis en cause, et qu’il se produit de plus
en plus fréquemment des expositions involontaires à des contenus érotiques (panneaux
publicitaires, télévision…). Enfin, alors que nos sociétés se sécularisent et que décline
l’influence des institutions qui transmettaient des principes absolus
4
, les sources émettrices
d’informations et de normes diffuses en matière de sexualité se multiplient : médias,
psychologie vulgarisée, école, enquêtes sur la sexualité, campagnes de prévention,
littérature…etc. Toutes ces sources atteignent des publics divers, mais leurs capacités
d’imposition et de contrôle direct des comportements sont relativement faibles, dans la
mesure où elles ne sont pas associées à des appareils de contrôle et de sanction efficaces.
Nous nous proposons d’explorer d’abord l’évolution des normes du fonctionnement
interpersonnel, en particulier la nouvelle normativité de l’initiation sexuelle, les
transformations de la norme de fidélité, ainsi que la force et les limites de la norme de
réciprocité dans la sexualité conjugale, et les évolutions des relations homosexuelles. Dans
3
L’évolution des savoirs et des durées de scolarité a pour effet que de plus en plus d’enfants atteignent des
niveaux de scolarité supérieurs à ceux de leurs parents.
4
Guy Michelat et Jeanine Mossuz-Lavau montrent non seulement qu’il existe de grandes différences en matière
normative entre catholiques et personnes sans religion, mais que même parmi les catholiques les plus
pratiquants, désormais peu nombreux, la discordance entre injonctions de l’Eglise en matière de sexualité et
attitudes personnelles est devenue importante (Michelat, Mossuz-Lavau, 2003).

5
un second temps, est abordé le fonctionnement intrapsychique de la sexualité, avec
l’importance qu’y a pris l’effort pour se connaître et se comprendre, et pour tenter de mettre
en cohérence ses conduites. Deux notions sont utilisées : celle de réflexivité, et celle
d’orientation intime, avancée dans une de nos publications récentes (Bozon, 2001a). Des
différends ou malentendus entre partenaires ou conjoints sont pris comme exemples de
conflits d’orientation en matière de sexualité. En troisième lieu, un point est fait sur la
médicalisation de la sexualité et ses effets sur la structuration des conduites, à partir des
exemples de la contraception, de la prévention du sida et du viagra. En quatrième lieu on
examine, sans les approfondir, quelques débats publics récents sur la sexualité, qui peuvent
être considérés comme des conflits de normes : ainsi les débats d’il y a quelques années sur
le contenu des campagnes de prévention du sida, ou des débats plus récents sur la
prostitution. En conclusion, on aborde une caractéristique fréquente des discours sur la
sexualité dans les dernières décennies du XXème siècle, qui est le fait qu’ils produisent des
injonctions contradictoires, ce qui définit particulièrement bien l’expérience contemporaine de
la sexualité.
Les nouveaux fonctionnements interpersonnels de la sexualité
Un bon exemple de la manière dont a évolué la normativité de la sexualité dans nos sociétés
est la transformation des termes selon lesquels la question de l’exclusivité sexuelle entre
partenaires est posée. Mais il convient d’envisager aussi les règles qui gouvernent l’entrée
dans la sexualité adulte aujourd’hui, ainsi que, plus largement, le fonctionnement de
l ‘échange sexuel au fil de la durée du couple, et dans un autre domaine l’évolution des
relations homosexuelles.
Les normes d’entrée dans la sexualité: d’une morale de la retenue à un idéal du
premier rapport.
Dans les années 1950, les femmes en France faisaient leurs débuts sexuels vers 21 ans.
L’initiation sexuelle était pour une majorité d’entre elles liée au mariage ou à l’espérance d’un
mariage proche (Bozon, 1991). Des entretiens réalisés auprès de femmes ayant rencontré
leur futur conjoint à cette époque montrent le prix accordé alors à la longueur de la
fréquentation (qui pouvait durer des années), à la chasteté et à la capacité à attendre,
considérées comme indice du sérieux de la relation : c’est au cours de cette longue
fréquentation pré-conjugale que l’on apprenait notamment à connaître et jauger le caractère
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%