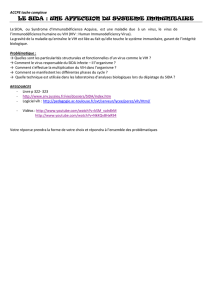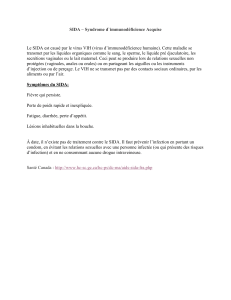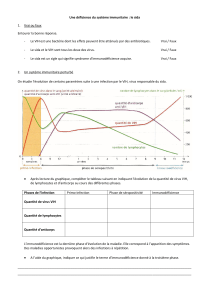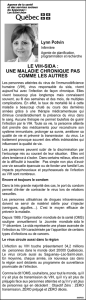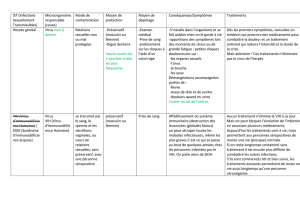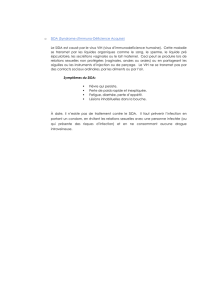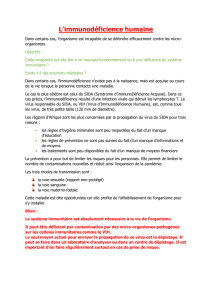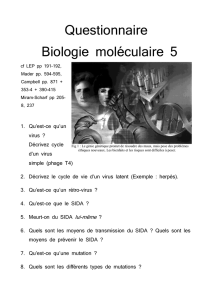Progrès Thérapeutique

30 Juin 2004
SIDA : plus de deux décennies d’innovations thérapeutiques
pour contrôler l’épidémie
La réponse des entreprises du médicament à la découverte du virus HIV a été
extrêmement rapide. Le premier anti-rétroviral était mis à disposition des malades dès 1987,
et les efforts soutenus de Recherche et Développement qui se sont poursuivis ont débouché
sur la mise au point de 4 classes thérapeutiques pour traiter cette maladie.
Traitements plus efficaces, utilisation simplifiée, effets indésirables diminués :
24 médicaments sont désormais disponibles. Les entreprises maintiennent un travail de
recherche multidirectionnel et la piste du vaccin, préventif ou thérapeutique, avance.
Diagnostiqués en 1981, les premiers cas de SIDA (Syndrome
d’Immunodéficience Acquise) ne laissaient pas soupçonner le drame de l’épidémie
mondiale qui s’annonçait.
Après plus de 20 ans de propagation, le SIDA fait des ravages : prés de 19 millions de
morts, dont 15 en Afrique. Les enfants de moins de 15 ans représentent environ un
cinquième des décès. En quelques années, le SIDA est devenu la quatrième cause de
mortalité au monde et la première sur le continent africain. Aujourd’hui 40 millions de
personnes dans le monde et environ 100 000 en France vivent avec une infection à
VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) d’après les sources de l’ONUSIDA et de
l’INVS. Le virus, qui appartient à la famille des rétrovirus, se transmet par voie
sexuelle ou sanguine.
° De la compréhension à la prévention et au traitement
La recherche médicale et thérapeutique a accompli en quelques années de véritables
tours de force pour comprendre et lutter contre ce fléau mondial.
En 1983, le virus du SIDA ainsi que ses deux sérotypes (VIH1 et VIH2) étaient identifiés
et leur mode de fonctionnement sur l’organisme progressivement compris. Le VIH
s’attaque à des cellules-clés du système de défense du corps humain : les lymphocytes
T4 (ou T CD 4), dont le rôle est normalement la destruction des particules étrangères à
l’organisme. Le VIH fusionne avec le lymphocyte. Pénétrant son noyau, le virus transforme
alors la cellule en véritable usine de production de nouveaux VIH qui iront infecter d’autres
lymphocytes. Les T4 disparaissent progressivement, parallèlement le VIH se multiplie. Le
rythme d’évolution de la maladie est variable. La personne atteinte ne ressent initialement
pas de troubles particuliers, alors qu’elle est séropositive (porteuse du virus actif) et
susceptible de transmettre la maladie. A ce stade pourtant, la connaissance de la
séropositivité du malade est fondamentale : d’une part pour initier des traitements
précoces, d’autre part pour assurer la prévention de la contamination.
La baisse importante des lymphocytes entraîne une diminution des défenses naturelles de
l’organisme. En dessous d’un certain taux de T 4, le malade atteint un stade
d’immunodéficience révélé souvent par l’installation de multiples infections, parfois graves,

dites « opportunistes » : infections pulmonaires à germes atypiques, tuberculose (souvent
résistante), herpès extensif, tumeurs (sarcome de Kaposi, lymphomes)…
° Une recherche active pour de nouvelles pistes thérapeutiques
Il existe aujourd’hui 24 médicaments pour lutter contre le virus. Ces médicaments apparus
rapidement au fil des années d’une mobilisation scientifique exceptionnelle, sont tous des
anti-rétroviraux et agissent à des étapes différentes :
° Les inhibiteurs (nucléosidiques) de la transcriptase inverse
L’objectif des traitements est de bloquer la prolifération du virus. Dès 1987,
apparaissait l’AZT, un premier anti-viral de cette famille, rapidement suivi par d’autres.
En inhibant un mécanisme, dans la cellule infectée par le VIH, ils empêchent le virus de se
répliquer et d’aller infecter d’autres cellules.
° les inhibiteurs de protéases
Malgré les inhibiteurs de la transcriptase inverse, rapidement prescrit par 2, en bi-thérapie,
pour plus d’efficacité, jusqu’en 1995, l’épidémie reste croissante et le pronostic souvent fatal.
En effet, les molécules disponibles alors ne font que ralentir le processus d’évolution de la
maladie et 50% des sujets séropositifs, c’est à dire atteint d’une infection à VIH, développent
encore un SIDA dans un délai de 10 à 11 ans après leur contamination.
L’année 1996 marque une étape-clé dans la lutte contre la maladie. C’est
l’arrivée des antiprotéases, qui empêchent la fabrication des protéines du virus.
Le nouveau VIH ne peut plus infecter d’autres cellules. Dès cet instant, ces
antiprotéases vont être associées aux premiers traitements disponibles, les
inhibiteurs de la transcriptase inverse. Ce sont les tri-thérapies. Grâce à cette avancée
majeure, le virus, contrôlé à deux étapes différentes de sa vie, devient indétectable dans le
sang. Dès lors, ne circulant plus dans l’organisme, il ne peut infecter de nouvelles cellules.
Cependant, le virus ne disparaît pas dans un certain nombre de tissus ou d’organes.
Ainsi, afin d’éviter que ce virus « tapi » ne ré-émerge et ne se remette à circuler dans le sang
pour aller ainsi infecter d’autres cellules, les traitements actuels doivent être pris sans
interruption.
°les analogues non-nucléosidiques de la transcriptase inverse
Egalement apparus dès 1996, ces médicaments bloquent l’intégration du bagage génétique
du virus au sein de la cellule saine et empêche l’infection de se propager.
° les inhibiteurs d’entrée.
Depuis 2002, une nouvelle génération de médicaments a vu le jour. Ces traitements
ont un mécanisme d’action encore différent des deux précédentes familles. Ils
interdisent au VIH l’entrée dans la cellule par des moyens différents comme les anti-
fusions déjà disponibles ou les anti-attachement en cours de développement.
Une cinquième classe thérapeutique est en cours de développement, elle interagit sur un
autre mécanisme lié à l’installation du virus dans l’organisme.
° Les inhibiteurs de l’intégrase
Cette nouvelle famille devrait-elle aussi enrichir prochainement l’arsenal thérapeutique
antirétroviral. Ces nouveaux traitements permettent de bloquer l’intégration du virus dans le
noyau de la cellule. Ils constituent une des pistes d’avenir sur lesquelles la recherche se
mobilise.

Depuis 1996, le pronostic de la maladie s’est donc considérablement modifié
dans les pays où les traitements sont distribués et administrés efficacement aux
personnes malades. L’espérance de vie inférieure à 10 ans au début de l’épidémie est
nettement supérieure aujourd’hui, en particulier en cas de dépistage précoce permettant
d’accéder aux soins. Le nombre de décès par sida en France a baissé
considérablement ces dernières années : moins 62% entre 1996 et 1997, moins 35%
l’année suivante. On comptait environ 600 décès par SIDA en France en 2001 contre
près de 4000 en 1995. Afin que ces progrès perdurent, pour simplifier les traitements
actuels et la vie quotidienne des personnes, pour découvrir des traitements encore plus
efficaces et des solutions alternatives pour les malades ayant épuisé le bénéfice des
traitements actuels, la recherche continue. Par ailleurs, la voie vaccinale est explorée
activement depuis de nombreuses années.
Sur la voie du vaccin.
Depuis le début de l’épidémie la recherche se mobilise en effet aussi pour découvrir un
vaccin préventif, solution idéale pour protéger les populations en induisant une réponse
immunitaire durable. Cette piste se heurte à de nombreux obstacles liés, notamment, au
fonctionnement propre du virus et à sa variabilité.
Différents candidats vaccins sont aujourd’hui à l’essai à travers le monde, à des stades plus
ou moins avancés.
Une autre piste vaccinale est le vaccin thérapeutique. Il ne s’agit plus de préserver des
personnes de la contamination, dans une approche pasteurienne, mais de réveiller le
système immunitaire des malades sous traitements. Cette ré-activation permettrait de mieux
contrôler le virus et de gagner du temps. Un des objectifs est de pouvoir alléger les
traitements antirétroviraux afin d’en atténuer les effets secondaires et d’améliorer la qualité
de vie des personnes.
Aujourd’hui 11 entreprises du médicament sont impliquées dans la recherche de
vaccins préventifs ou thérapeutiques contre le virus. On compte « 20 candidats
vaccins », à différentes phases de recherche. Trouver un vaccin contre le sida est un
défi majeur, mais il faut être conscient de la complexité scientifique et technique de ce
défi.
Un quart de siècle pour des évolutions constantes
L’approche de la maladie est désormais radicalement différente, du fait de l’efficacité
des traitements de l’infection par le VIH et des pistes vaccinales. Il s’agit aujourd’hui du
traitement d’une maladie au long cours. La prévention de la transmission du virus, de
l’apparition de résistances (le virus étant capable de muter), la minimisation des effets
secondaires et l’observance (respect de la prescription par le malade) sont désormais des
objectifs prioritaires.
Plus que jamais, trouver de nouvelles voies thérapeutiques et préventives, combattre
le virus, simplifier le traitement et diminuer ses inconvénients pour améliorer
l’observance des patients, sont les pistes actuelles de recherche des entreprises du
médicament.
1
/
3
100%