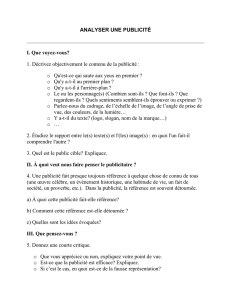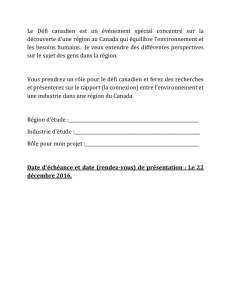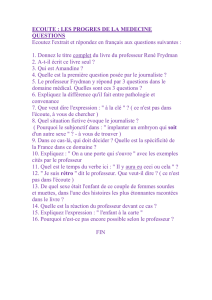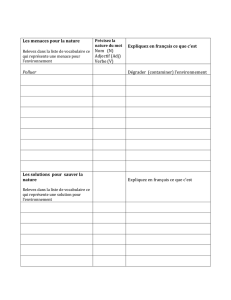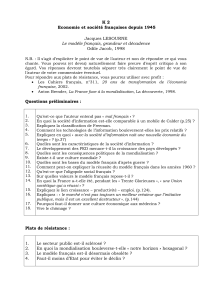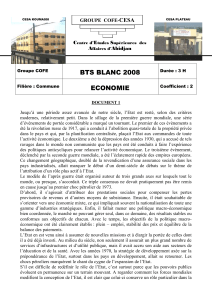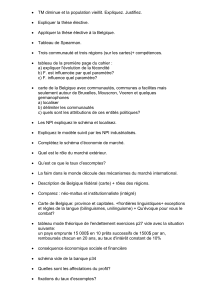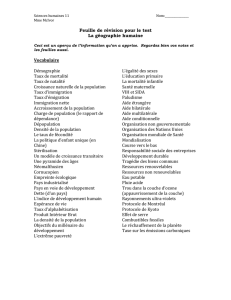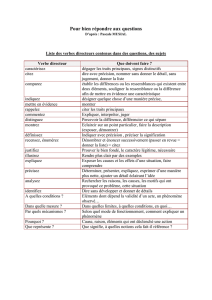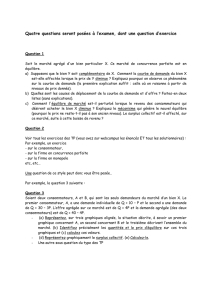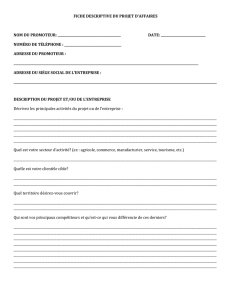quest.exa.ET2.12.13

1
ETHIQUE ET NORMES SOCIALES
Liste indicative de questions d’examen
La liste qui suit comporte des questions de « poids » différents : les unes sont plus « lourdes », les
autres plus « légères ». Les fiches d’examen équilibreront ces « poids » respectifs.
N.B. : -en rouge, certains changements par rapport au questionnaire de l’an dernier. Certaines
questions ont aussi été supprimées, d’autres ajoutées !
-Outre la connaissance du cours, certaines questions demandent aussi une réflexion sur base
d’éléments du cours.
1. L’éthique philosophique et l’éthique professionnelle sont-elles équivalentes ? Après les avoir
définies l’une et l’autre, expliquez et justifiez votre réponse.
2. L’éthique philosophique et la déontologie sont-elles équivalentes ? Après les avoir définies l’une et
l’autre, expliquez et justifiez votre réponse.
3. L’éthique professionnelle et la déontologie sont-elles équivalentes ? Après les avoir définies l’une
et l’autre, expliquez et justifiez votre réponse
4. L’éthique et les morales religieuses sont souvent présentées comme fort proches : indiquez leurs
différences et les conséquences qui en résultent pour la réflexion éthique.
5. La liberté et la responsabilité légales sont-elles équivalentes à la liberté et à la responsabilité
morale ? Expliquez et illustrez par deux exemples.
6. Quel est l’objet de l’éthique philosophique, et quelle est son extension ? Expliquez et justifiez votre
réponse.
8. Après avoir défini le droit, indiquez et expliquez en quoi il est proche de l’éthique ? Illustrez si
nécessaire par des exemples.
9. Après avoir défini le droit, indiquez et expliquez en quoi il est distinct de l’éthique ? Illustrez si
nécessaire par des exemples.
10. Quelle thèse fondamentale sous-tend les diverses théories de droit naturel ? Expliquez. Illustrez
en vous appuyant sur trois auteurs ou démarches relevant de périodes historiques différentes, qui
ont été vus au cours.
10a. Comment Nooteboom illustre-t-il la nécessité actuelle d’une réflexion de droit naturel ?
Expliquez. Quels enseignements peut-on en dégager en ce qui concerne le caractère juste de la loi ?
Expliquez.
12. Le droit naturel consiste-t-il en une interrogation sur la légalité ou sur la légitimité des règles
juridiques ? Expliquez en précisant ces deux concepts.
15. Qu’entendre par sécularisation ? Expliquez. La sécularisation modifie-t-elle le rôle et la place de la
religion dans la société et dans la conscience ? Expliquez.
16. Discerne-t-on aujourd’hui des convergences entre christianisme, morale, religion et droit ?
Expliquez. Comment Gauchet rend-il compte de cette situation ? Expliquez.
16b. Comment Valadier conçoit-il l’articulation du droit et de la morale ? Expliquez et montrez les
enjeux des deux conceptions qu’il propose.
17. Quelles conditions ont permis l’émergence dans l’Antiquité d’une réflexion philosophique sur la
loi et le droit ? Expliquez.
18. Quel est l’apport des sophistes à la réflexion sur le droit ? Expliquez. Peut-on dire que cet apport
est encore significatif pour nous aujourd’hui ? Expliquez et justifiez.
19. Pourquoi les thèses de certains sophistes sont-elles dites conventionnalistes ? Expliquez.
21. Quelle(s) différence(s) discerne-t-on entre le conventionnalisme de l’Antiquité et la conception
moderne de la loi telle que la présente Lefort ? Expliquez.
22. En quoi la conception de la loi positive d’Antiphon se distingue-t-elle de celle des Modernes ?
Explicitez ces deux positions et montrez-en les enjeux en ce qui concerne la conception de la nature
dans ses rapports avec la loi positive.
23. Quelles thèses défendent les sophistes naturalistes ? Expliquez. Quelles sont les répercussions de
ces thèses sur le droit positif ? Expliquez et illustrez en vous appuyant sur des auteurs vus au cours.

2
24. Peut-on discerner plusieurs formes de naturalisme chez les sophistes ? Expliquez et illustrez.
Trouve-t-on un écho de certaines thèses naturalistes chez Thomas d’Aquin ? Expliquez et justifiez.
26. Pourquoi Socrate estime-t-il qu’il faut obéir aux lois ? Expliquez. Quelles raisons les Modernes,
tels qu’ils s’expriment dans les déclarations du 18e siècle, avanceraient-ils pour justifier cette
obéissance ? Expliquez et comparez.
28. Comment Aristote pose-t-il la question du juste naturel et de son articulation au juste
conventionnel? Expliquez. En quoi Aristote échapperait-il à la critique que fait Kelsen du droit naturel
? Expliquez et justifiez.
30. En quoi la conception de la loi naturelle présentée par Cicéron dans la foulée des Stoïciens se
distingue-t-elle des conceptions de Socrate, Platon et Aristote ? Expliquez.
31. Quelles indications la structure de la Somme théologique donne-t-elle à propos de la conception
de la loi naturelle chez Thomas d’Aquin ? Expliquez. Quels bouleversements les Temps modernes
introduisent-ils dans cette conception ? Expliquez et montrez les enjeux de ces bouleversements.
32. Thomas d’Aquin considère-t-il que la loi humaine est nécessaire même si la loi naturelle existe ?
Expliquez sa position. Quel rôle les Modernes attribuent-ils à la loi positive dans les premières
déclarations des droits de l’homme ? Expliquez et marquez la différence entre la conception
thomiste et la conception moderne.
34. Comment la distinction entre droit et morale s’exprime-t-elle dans la conception de la loi positive
que propose Thomas d’Aquin ? Expliquez. En quoi cette position peut-elle être rapprochée de celle
d’Antiphon ? Quelles différences existent cependant entre les conceptions respectives d’Antiphon et
de Thomas d’Aquin : expliquez.
35. Comment Thomas d’Aquin articule-t-il les différents types de lois qu’il distingue ? Expliquez et
précisez les conséquences qui en résultent pour la loi positive.
36. Présentez et commentez la définition de la loi proposée par Thomas d’Aquin. Cette définition
converge-t-elle avec le rôle que les Modernes attribueront à la loi positive au 18e siècle ? Expliquez.
40. Pour les Modernes, quel objectif doit poursuivre l’ordre social ? Expliquez. Quelle différence
discerne-t-on par rapport aux conceptions d’Aristote et de Thomas d’Aquin ? Expliquez et montrez
les enjeux de ces conceptions.
41. En quoi la conception de la nature change-t-elle de l’Antiquité et du Moyen Age aux Temps
modernes ? Quelles répercussions ce changement entraîne-t-il sur la conception de la nature
humaine ? de l’ordre social ? Explicitez.
41b. A l’aide de quels concepts les théoriciens du droit naturel moderne conçoivent-ils la
construction de la société ? Expliquez et illustrez en vous appuyant sur des auteurs vus au cours.
41d. En quoi la conception du droit naturel se transforme-t-elle de l’Antiquité et du Moyen Age aux
Temps Modernes ? Expliquez en vous vous appuyant sur deux auteurs ou démarches de périodes
différentes, qui ont été vus au cours
42. Quelle différence principale discerne-t-on dans la conception du rôle de la loi positive dans
l’Antiquité, au Moyen Age et au début de la modernité ? Expliquez.
43. Quel est l’objectif de Kelsen ? Expliquez. Qu’en résulte-t-il pour sa compréhension des relations
entre le droit et la morale ? Expliquez.
43b. La démarche de Hans Kelsen relève-t-elle du droit naturel ? Expliquez.
43c. Quelle position Kelsen adopte-t-il par rapport au droit naturel ? Expliquez deux de ses
arguments principaux.
43d. Quelles conceptions du droit naturel sont particulièrement critiquées par Kelsen ? Expliquez et
donnez les raisons de sa critique.
43f. Pourquoi Kelsen considère-t-il que le droit naturel est idéologique ? et généralement
conservateur ? Expliquez.
43i. Quelle différence Habermas établit-il entre le principe démocratique et le principe moral ?
Expliquez.
43j. Trouve-t-on chez Kelsen et chez Habermas des inspirations kantiennes ? Expliquez.

3
43l. Pourquoi peut-on soutenir que la plupart des théories du droit naturel antiques et médiévales
vues au cours sont unionistes, tandis que chez les modernes un relâchement se produit ? Expliquez.
En quoi consiste ce relâchement ? Expliquez.
43 o. Quels reproches les unionistes adressent-ils aux séparatistes ? Expliquez le bien-fondé de ces
reproches ? Comment Radbruch prend-il position ? Expliquez l’évolution de sa pensée et ses limites
selon vous.
47. Les déclarations des droits de l’homme sont-elles liées à la modernité ? Expliquez.
53. Quel bouleversement de la structure sociale a permis les déclarations de droits de l’homme
selon Gauchet ? Expliquez et illustrez en vous appuyant sur la pensée de deux théoriciens
précurseurs, vus au cours.
81. En quoi la question de la légitimité du pouvoir se transforme-t-elle du Moyen Age à la
modernité ? Expliquez et illustrez en vous appuyant sur Thomas d’Aquin et Cl. Lefort.
48. Quelle est la signification générale de l’affirmation et de la promulgation des droits de l’homme ?
Expliquez.
44. Comment les premières déclarations des droits de l’homme justifient-elles les droits qu’elles
énoncent ? Expliquez. Ce type de justification se retrouve-t-il dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme ? Expliquez.
45. Pourquoi les droits de l’homme doivent-ils être reconnus par l’Etat ? Expliquez. Peut-on dire pour
autant qu’aujourd’hui c’est le législateur qui définit les droits de l’homme ? Expliquez votre réponse.
38. Quels sont les objets respectifs des trois générations des droits de l’homme ? Expliquez. Quelle
conception de l’Etat peut-on discerner dans chacune de ces générations ? Expliquez.
45b. Comment peut-on penser l’articulation des droits de l’homme avec la loi positive et le pouvoir
étatique ? Qu’en résulte-t-il selon Habermas ? Expliquez.
45d. Pourquoi Derrida considère-t-il que les droits de l’homme sont « baroques » ? Expliquez.
Pourquoi peut-on estimer que cette appréciation est correcte ? Expliquez. Quelle compréhension des
droits de l’homme peut-on néanmoins avancer pour faire face à cette critique ? Expliquez.
48b. Pourquoi peut-on discerner différentes générations de droits de l’homme ? Expliquez la raison
philosophique qui rend compte de cette évolution. Cette distinction annule-t-elle l’affirmation selon
laquelle les droits de l’homme sont indivisibles ? Expliquez.
48c. Quelles conceptions de la liberté discerne-t-on dans les droits civils et politiques ? Expliquez les
implications qui en résultent sur la compréhension du caractère individualiste des droits de l’homme.
En quoi l’approche de Marx et sa critique par Claude Lefort sont-elles éclairantes à cet égard ?
48d. Quelle valeur principale chacune des générations des droits de l’homme promeut-elle ?
Expliquez. Associer une valeur à chacune des générations des droits de l’homme constitue-t-il un
critère adéquat de différenciation entre ces générations. Expliquez et justifiez.
48 f. Quelle évolution dans la conception de l’individu et dans la conception de l’égalité les droits
économiques, sociaux et culturels apportent-ils ? Expliquez
48 g. Les droits de l’homme contemporains permettent-ils de discerner une conception unifiée du
sujet de ces droits ? Expliquez.
49. Qu’appelle-t-on « droits-libertés » et « droits-créances » ? Expliquez. Quelle tension discerne-t-on
entre eux en ce qui concerne le rôle de l’Etat ? Expliquez.
49a. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 pose dans son article 4 : « La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Dans le même esprit la
Constitution de 1793 pose dans l’article 6 : « La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de
faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ;
pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne
veux pas qu’il te soit fait. » En vous appuyant sur Marx, Lefort et Habermas, analysez ces articles afin
de mettre en évidence les différents aspects qu’ils recèlent.

4
51. Que veut dire Lefort lorsqu’il conçoit les déclarations des droits de l’homme comme des auto-
déclarations ? Expliquez et précisez les enjeux de cette conception. Une telle auto-déclaration était-
elle concevable dans l’Antiquité et au Moyen Age ? Expliquez.
54. Les droits de l’homme sont-ils individualistes ? Expliquez en développant les différents aspects
impliqués dans cette question. Montrez les répercussions qui en résultent sur la conception de la
liberté.
55. Au cours de l’Antiquité, avons-nous étudié des positions que l’on pourrait qualifier
d’individualistes ? Si oui, montrez en quoi elles méritent cette qualification, et en quoi elles se
distinguent de l’« individualisme » des droits de l’homme.
59. Comment peut-on comprendre la liberté qu’affirment les déclarations de droits de l’homme ?
Expliquez les différentes approches possibles et leurs enjeux. En quoi cette liberté se distingue-t-elle
de celle des sophistes naturalistes ? Expliquez.
60. Quel sens et quel statut donner à la dignité humaine qu’invoque la Déclaration universelle des
droits de l’homme ? Qu’en résulte-t-il pour la compréhension de l’énoncé des droits de l’homme ?
Expliquez.
61. Peut-on comprendre l’universalité des droits de l’homme comme un dénominateur commun aux
différentes cultures ? Expliquez et justifiez votre réponse en vous appuyant sur Chu Chi How et Sen.
Qu’en est-il pour Jullien et Panikkar ? Mettent-ils aussi en évidence un aspect susceptible d’être
communs aux cultures. Expliquez.
63. Les droits de l’homme peuvent-ils constituer une ressource commune pour l’humanité selon
Supiot et Habermas ? Expliquez et comparez leurs positions respectives.
63b. Les droits de l’homme peuvent-ils constituer une ressource commune pour l’humanité selon
Jullien et Panikkar? Expliquez et comparez leurs positions respectives.
64. Pourquoi Supiot , Panikkar et Jullien considèrent-t-il que les droits de l’homme sont un produit de
l’Occident ? Expliquez.
64a. Quel est le statut des droits de l’homme selon Supiot ? Expliquez. Qu’en résulte-t-il selon lui
pour la communication entre les cultures ? Expliquez. Supiot rejoint-il par là la position de Jullien
lorsqu’il distingue l’universalisable et l’universalisant ? Expliquez.
65. Selon Supiot et Panikkar, quelles démarches faut-il éviter ou proscrire en matière de droits de
l’homme ? Expliquez et justifiez.
66. Pourquoi, selon Habermas, les droits de l’homme doivent-il s’exporter dans les autres cultures ?
Expliquez. A votre avis, la position de Habermas peut-elle être rapprochée d’une des formes de
fondamentalismes que dénonce Supiot ? Expliquez.
70. Le dialogue entre les cultures à propos des droits de l’homme est-il nécessaire selon Supiot,
Habermas et Panikkar ? Expliquez. Quels sont les enjeux d’un tel dialogue selon ces trois auteurs.
71. Comment Supiot conçoit-il concrètement le dialogue entre les cultures à propos des droits de
l’homme ? Expliquez. Et Panikkar ? Expliquez.
76. Pour Habermas, en quoi une culture qui fait valoir une conception cosmique du monde pose-t-
elle problème pour la reconnaissance des droits de l’homme ? Expliquez. Quelles difficulltés Panikkar
met-il en évidence à cet égard ? Expliquez. Ces difficultés le conduisent-elles à renoncer à
l’universalisation des droits de l’homme ? Expliquez.
82. Comment Jullien conçoit-il l’universalité des droits de l’homme ? A quoi tient-elle selon lui ?
Expliquez. En quoi cette conception permet-elle de comprendre la critique qu’il adresse à Panikkar ?
Expliquez .
83. Supiot, Jullien et Panikkar partagent-ils l’idée que les droits de l’homme opèrent un tri dans les
aspects de l’humain qu’ils retiennent ? Expliquez. Quelles conséquences en résultent pour chacun
d’eux? Expliquez.
84. Pourquoi Sen et Jullien voient-ils dans les droits de l’homme une idée unificatrice ? Expliquez et
comparez leurs positions à ce propos.
1
/
4
100%