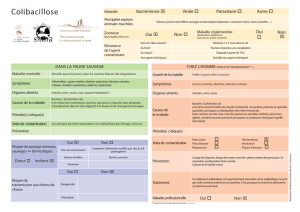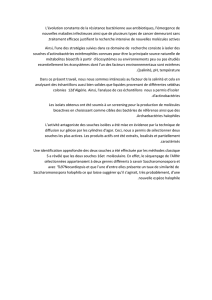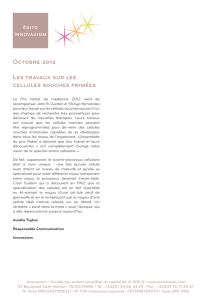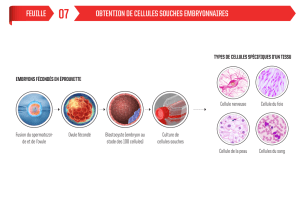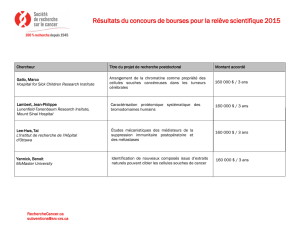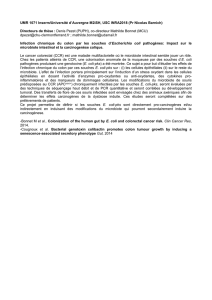NEONATES

1. LES MALADIES NEONATALES.
Nous nous limitons, dans ce chapitre, aux maladies et syndromes de la période
néonatale, c'est-à-dire les tout premiers jours de vie, voire la première semaine dans
certains cas (porcelets par exemple). En dehors des maladies qui vont être décrites,
d'autres peuvent survenir, qui sont normalement décrites chez des animaux plus âgés, le
plus souvent suite à une forte pression d'infection, qui augmente au cours de la saison et
en fonction du nombre de mise-bas et de malades.
1.1. Espèce bovine.
1.1.1. Les diarrhées néonatales.
Les diarrhées néonatales apparaissent pendant la première semaine de la vie chez
le veau. De nombreux microorganismes (bactéries, virus) interviennent, parfois
indépendamment, parfois de concert. Les diarrhées néonatales constituent un syndrome
plutôt qu'une maladie. Elles sont toujours à prendre au sérieux et le pronostic dépend
essentiellement du degré des perturbations biochimiques.
a) Etiologie.
L'agent étiologique bactérien principal est l'espèce Escherichia coli. L'espèce
Salmonella enterica est habituellement pathogène pour des animaux plus âgés.
Déjà en 1893, le vétérinaire danois Jensen associait E.coli à des diarrhées chez
les veaux nouveau-nés. Cependant, la reconnaissance des souches d'E.coli qui
produisent réellement la diarrhée et de leurs mécanismes de virulence ne date que des
années '60 et '70 pour les souches entérotoxinogènes, des années '80 pour les souches
effaçantes. Les mécanismes de virulence de certaines catégories de souches restent
encore à définir.
Cette reconnaissance se fit, tout d'abord, par l'observation que les souches
associées à de la diarrhée appartiennent à des sérotypes O:K:H particuliers (O8:K?:Nm;
09:K?:Nm; O101:K30:Nm); ensuite par l'observation qu'elles portent un antigène
thermolabile commun qui est absent de la surface des bactéries isolées chez des veaux
sains (antigènes K99 ou F5); enfin, par l'observation qu'elles produisent une ou des
toxines qui provoquent une hypersécrétion dans l'intestin (= entérotoxines). Ces souches
constituent les souches entérotoxinogènes (= souches ETEC).
D'autres agents que les bactéries sont, bien entendu, responsables de diarrhées
néonatales: des virus (rota, corona...), des protozoaires (Cryptosporidium..), et sont
décrits dans d'autres cours.
b) Incidence.
Chaque année, en Belgique, près de 130000 veaux sont envoyés au clos
d'équarrissage dont 85000 (65%) sont morts des suites de diarrhée, causant 1,7 milliards
de FB de pertes directes et 2 milliards de FB de pertes indirectes.
c) Pathogénie.
A la naissance, l'intestin du veau ne contient pas de bactérie (le méconium est
stérile). Les premiers contacts du veau nouveau-né avec les bactéries se produisent lors
du passage dans le vagin, ou bien lors des manipulations par le vétérinaire et le fermier
en cas de césarienne. D'autres contacts ont bientôt lieu avec les bactéries présentes dans

la litière. La colonisation par les bactéries "normales" et non pathogènes est
extrêmement importante car elles forment une barrière vis à vis de la colonisation par
les bactéries pathogènes. Cette barrière n'est cependant pas absolue.
La première étape de la pathogénie des souches diarrhogènes d'E.coli est, en
effet, la colonisation de l'intestin ou de portions de celui-ci (selon le type de souches
auxquelles on s'adresse).
C'est ainsi, par exemple, que les souches ETEC vont coloniser l'intestin grêle,
surtout les parties antérieures. Cette colonisation va se faire grâce à la production
d'adhésines, qui peuvent être des fimbriae (il s'agit en l'occurrence de l'antigène
thermolabile commun K99 ou F5). Une autre adhésine connue sous le nom de F41 est
également produite par les souches ETEC du veau. Grâce à ces adhésines, les souches
adhèrent aux microvillosités des entérocytes (sans les détruire car il s'agit de souches
ETEC) et produisent localement une grande quantité de toxine (la toxine thermostable
STa pour les souches ETEC de veaux). Celle-ci provoque une hypersécrétion d'eau et
d'électrolytes. Les récepteurs pour l'adhésine F5 sont présents sur les entérocytes à la
naissance. Ces entérocytes vont progressivement migrer vers le sommet des villosités
intestinales. Les entérocytes qui les remplacent ne possèdent pas ces récepteurs et après
24 à 48 heures, les veaux ne sont plus réceptifs aux souches ETEC (en plus de la
barrière constituée par la flore normale qui s'établit progressivement). Une infection par
des souches ETEC doit donc se produire dans les 12 premières heures au maximum
pour avoir le plus de chances de réussir.
d) Signes cliniques.
Les signes cliniques d'une infection à souches ETEC apparaissent donc très tôt
dans la vie du veau et ,très souvent, avant même qu'il n'ait atteint 24 heures de vie.
L'apparition de la diarrhée (signe clinique principal) est brutale. La diarrhée est profuse,
liquide et brun-jaune. La perte de poids par perte de liquide est rapide de même que
l'apparition des signes de déshydratation (énoptalmie, poil sec, pli de la peau).
Rapidement le veau s'affaiblit, se couche et devient léthargique. La mort s'ensuit assez
rapidement, même si des antibiotiques sont donnés.
e) Lésions.
Les lésions macroscopiques d'un veau mort d'une infection à souches ETEC sont
celles d'un veau mort de diarrhée et de déshydratation: cadavre émacié, sale, poil sec,...
sans aucun signe particulier.
Les lésions microscopiques sont absentes lors de l'infection à souches ETEC car
les bactéries s'attachent aux microvillosités sans les endommager.
f) Diagnostic.
L'apparition d'une diarrhée profuse et aqueuse dans les premières heures de la
vie doit toujours faire penser à une infection par des souches ETEC. Cependant, le
laboratoire devrait confirmer le diagnostic basé sur les signes cliniques (le délai pour
avoir le résultat de la culture bactériologique classique et des tests spécifiques
permettant de reconnaître les souches ETEC est, bien sûr, trop long pour l'animal). Le
diagnostic différentiel des diarrhées d'origine virale ou protozoaire est difficile à faire.
D'autre part, ces différents agents interviennent souvent de manière combinée dans le
syndrome de la diarrhée néonatale.
L'antigène F5 peut être mis en évidence sur les souches ETEC par agglutination,
mais sa production sur milieux de culture n'est pas toujours optimale. La mise en

évidence de la toxine STa est beaucoup plus laborieuse. Cet antigène peut aussi être mis
en évidence directement sur les matières fécales.
g) Traitement.
Le traitement d'une diarrhée à ETEC consiste, avant tout, à remplacer les
liquides perdus par administration d'une solution d'électrolytes, à retirer le lait de
l'alimentation et à traiter aux antibiotiques actifs dans l'intestin et sur les bactéries Gram
négatives.
L'administration d'une solution d'électrolytes devrait se faire en intraveineuse
pendant un temps suffisament long pour rétablir l'équilibre physiologique et demande
donc en théorie un suivi de laboratoire. Ces conditions ne sont pas souvent compatibles
avec la pratique journalière. Il n'y a pas d'antibiotique de choix dans le traitement d'une
colibacillose intestinale, car les entérobactéries renferment de très nombreux plasmides
porteurs de gènes qui déterminent des résistances à tous, ou presque tous (mais pour ces
derniers cela ne saurait tarder) les antibiotiques connus. La détermination de la
sensibilité in vitro des souches ETEC sera utile pour les veaux suivants mais arrivera
trop tard pour le veau concerné.
h) Prophylaxie.
La prophylaxie des diarrhées néonatales du veau est à la fois hygiénique et
médicale.
L'hygiène générale de l'élevage est extrêmement importante: proprété de l'étable,
(sur)population, temps d'occupation des bâtiments, nombre de vêlages déjà faits,
circulation ou non des veaux, etc... sont autant de facteurs à prendre en considération. Il
faut garder à l'esprit que les selles diarrhéiques sont une culture pure de souches ETEC
qui ne demandent qu'à infecter d'autres victimes.
Cependant, toutes choses égales ailleurs, l'élément primordial est le colostrum. Il
doit par ordre d'importance: 1°) être pris à temps; 2°) être pris en quantités adéquates;
3°) être de bonne qualité. Pour permettre aux immunoglobulines de franchir la barrière
intestinale, le colostrum doit être pris dans les douze premières heures (voir 1er
Doctorat et 3ème Candidature). Pour assurer une protection contre les septicémies et
diarrhées néonatales, il doit être pris dès la naissance, soit au pis (difficultés de s'assurer
de la quantité réellement prise), soit au biberon (attention aux manipulations et au
biberon qui pourraient propager ou provoquer une infection au lieu de la prévenir). La
quantité classiquement recommandée est de deux litres dans les deux premières heures
de la vie, en trois ou quatre prises. Une prise trop rapide d'un volume trop grand de
colostrum peut provoquer elle-même une diarrhée passagère.
En ce qui concerne la qualité du colostrum, elle dépend, bien sûr, de la mère:
âge, contacts antérieurs. La vaccination permet d'améliorer cette qualité. Il existe des
vaccins combinés E.coli K99-virus destinés à être administrés chez la mère pendant la
gestation et à assurer la production d'anticorps spécifiques chez celle-ci, anticorps qui se
retrouveront dans le colostrum.
Il faut se souvenir que l'absortion adéquate de colostrum ne permet pas toujours
de protéger le jeune, que l'absence de colostrum résultera presque toujours en l'infection
et la mort du veau dans nos conditions d'élevage.
1.1.2. Les infections généralisées ou septicémies.
a) Etiologie.

L'agent étiologique N°1 de septicémies néonatales chez le veau est E.coli, ou
plutôt certaines souches d'E.coli douées non seulement du pouvoir de coloniser l'intestin
dès la naissance, mais aussi de franchir la barrière intestinale et de se disséminer dans
l'organisme pour provoquer une septicémie. Les sérotypes impliqués sont les suivants
dans l'ordre d'importance: O78:K80:Nm, O137:K79:Nm; O35:K?:Nm; O115:K?:Nm;
O15:K30:Nm. Ces souches produisent des facteurs de virulence qui ne sont pas encore
caractérisés: des adhésines et des toxines. L'adhésine est apparentée soit aux adhésines
des souches uropathogènes de l'homme, soit à l'adhésine Att25 ou F17 (cette seconde
adhésine des souches septicémiques était anciennement appelée adhésine Vir). Les
toxines sont appelées facteurs CNF (= Cytopathic Necrotizing Factors). Deux facteurs
CNF ont été décrits: CNF1 et CNF2 (anciennement appelé toxine Vir).
D'autres bactéries peuvent aussi provoquer des septicémies: Klebsiella spp.,
Enterococcus spp.,..., mais beaucoup plus rarement.
b) Incidence.
L'incidence exacte n'est pas connue, mais à elles deux, la diarrhée et la
septicémie comptent pour la grande majorité des pertes en animaux durant les deux
premières semaines de vie.
c) Pathogénie.
La pathogénie n'est pas bien connue. Il est probable que ces souches envahissent
et colonisent l'intestin grêle dans un premier temps grâce à des structures de surface,
franchissent la barrière épithéliales dans un deuxième temps et envahissent l'organisme
dans un dernier temps. D'autres portes d'entrées sont l'ombilic et le tractus respiratoire.
Les souches septicémiques d'E.coli peuvent envahir l'organisme grâce à deux propriétés
essentielles: la résistance au sérum (elles ne sont pas tuées en présence de sérum
contrairement aux autres souches) et la production d'aérobactine, un puissant chélateur
du fer (celui-ci est lié à d'autres chélateurs produits par le veau mais moins puissants).
Le syndrome peut être reproduit expérimentalement chez des veaux de moins de quatre
jours.
d) Signes cliniques
Les signes classiques apparaissent assez rapidement après l'infection: veau
apathique, réticent à bouger et à se nourrir. L'évolution est extrêmement rapide (12 à 24
heures) et se termine dans presque tous les cas par la mort de l'animal. Entretemps,
celui-ci a présenté de la fièvre, et éventuellement des articulations gonflées, des signes
nerveux et plus rarement de la diarrhée.
Ceux des animaux qui ne meurent pas garderont des séquelles telles des lésions
d'arthrites chroniques, des abcès sur les organes internes, à hauteur de l'ombilic et
parfois dans le système nerveux central.
e) Lésions.
Les lésions classiques de septicémies sont présentes: pétéchies et hémorragies
dans l'ensemble des organes internes (poumons, trachée, myocarde, thymus, rate, etc...).
f) Diagnostic.
Des problèmes chez de très jeunes veaux avec mortalité très importante, voire des morts
subites sans diarrhée (en tous cas pas comme signe clinique principal) dans un contexte
d'hygiène relativement pauvre et d'absence de prise de colostrum doivent faire penser à
des problèmes de septicémies. L'autopsie et l'analyse bactériologique sur cadavres frais
confirmeront le diagnostic clinique. Des cultures pures d'E.coli peuvent être obtenues

du sang et de la moëlle osseuse, mais aussi de divers organes (rate, foie, éventuellement
poumons et cerveau...). Chez les animaux ayant reçu un traitement aux antibiotiques,
des cultures pourront aussi être obtenues à partir des articulations (genoux, jarrets).
g) Traitement.
Le seul traitement qui puisse avoir quelque effet est une injection massive
d'antibiotiques, bien que l'évolution rapide de la colisepticémie rende tout traitement
aléatoire. Pas plus que pour les diarrhées, il n'est possible de guider empiriquement le
choix de l'antibiotique, vu le grand nombre de résistances d'origine plasmidique
rencontrées. Il est donc à conseiller de faire une autopsie et une analyse bactériologique
dans les fermes à problèmes.
h) Prophylaxie.
Voir la diarrhée néonatale du veau.
Il faut cependant insister encore plus dans le cas de septicémie sur l'importance
de l'administration précoce d'un colostrum en quantité suffisante, même s'il ne provient
pas d'une mère vaccinée.
1.1.3. Les polyarthrites.
a) Etiologie et pathogénie.
Diverses espèces bactériennes peuvent être isolées de cas de polyarthrites chez
les jeunes veaux: E.coli et les autres bactéries responsables de septicémies bien sûr
(dans ce cas, la polyarthrite est associée à la septicémie, ou en est une séquelle), mais
aussi Actinomyces (Corynebacterium) pyogenes, Fusobacterium necrophorum, des
staphylocoques, des streptocoques et des entérocoques. Pour ces dernières bactéries, la
porte d'entrée est l'ombilic et la polyarthrite est associée à une omphalophlébite. Les
bactéries envahissent l'organisme, ne provoquent pas de septicémies mais forment des
abcès à hauteur de différents organes internes et dans les articulations.
b) Incidence.
Voir la septicémie pour le premier groupe de bactéries.
Les cas sont sporadiques et associés à une hygiène déficiente de l'exploitation pour le
seconde catégorie.
c) Signes cliniques.
Les signes cliniques de polyarthrite sont: gonflement, chaleur et douleur à
hauteur des articulations atteintes (surtout le carpe, le jarret) avec, bien entendu, de la
réticence à se lever et des boîteries. Les veaux sont faibles et présentent de la fièvre et
de l'anorexie. Une infection de l'ombilic est notée dans la plupart des cas. Les arthrites
évoluent vers la chronicité avec dégénérescence des cartilages et fibrose progressive.
d) Lésions.
Les lésions sont localisées à l'ombilic et aux articulations atteintes. La synovie
est présente en grande quantité et sous pression. Elle contient de la fibrine ou du pus.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%