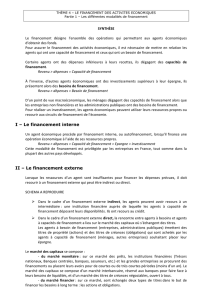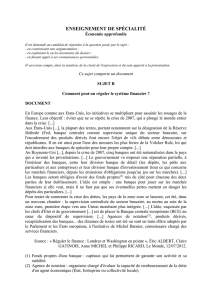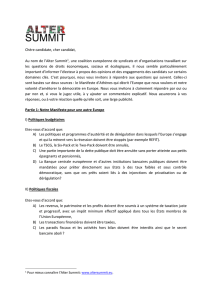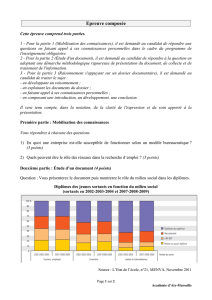Comment réguler les crises financières internationales

Page 1 sur 6
Comment réguler les crises financières internationales ?
Michel Aglietta
Article de la rubrique « L'économie repensée. Théories, enjeux, politiques », Hors-série N° 22 - Septembre/Octobre
1998. L'économie repensée. Théories, enjeux, politiques
La succession des crises financières internationales de ces dernières années a suscité de nombreux travaux
théoriques sur les dispositifs à mettre en place pour les réguler. Pour Michel Aglietta, cette régulation passe par le
renforcement des organismes de contrôle et la mise en place d'un prêteur international en dernier ressort.
La crise financière intervenue en Asie au cours de l'année 1997 était-elle inévitable ? Quels sont
les dispositifs à mettre en place pour réguler ce type de crise? Pour répondre à ces questions, il
importe de souligner d'emblée le caractère systémique des crises financières internationales
intervenues au cours de ces dernières années. Comme celles des années 80-90, la crise
asiatique n'est pas réductible à une seule cause ; elle est la résultante d'une multiplicité de
causes interagissant entre elles.
Dans le cas de la crise asiatique, certaines causes sont profondes, d'autres plus
circonstancielles. Les causes profondes sont liées au processus de libéralisation financière
engagé dans la plupart des pays de cette région à partir de 1992-93. L'ancien régime de finance
des économies asiatiques avait sa logique. L'organisation du crédit était traditionnellement
fondée sur une épargne importante des ménages. Cette épargne servait à financer les
investissements des entreprises, à l'origine de la forte croissance que ces pays ont connue
depuis les années 70. L'Etat exerçait un contrôle quantitatif du crédit. Ce contrôle était
suffisamment cohérent pour empêcher que le (sur) endettement des entreprises n'explose. Sous
la pression des Etats-Unis et du FMI, les pays ont dû passer brutalement au début des années
90 à une logique de libéralisation. Celle-ci s'est traduite par trois changements importants. Il y a
eu d'abord la disparition du contrôle sur le système de crédit, qui a donné toute licence au
financement d'activités à rentabilité douteuse : prêts à des entreprises qui accumulaient des
capacités de production excédentaires ou prêts nourrissant la spéculation immobilière. Ensuite,
les crédits accordés à court terme ont progressé encore plus vite que le total du crédit. Enfin,
l'ouverture des frontières aidant, les banques locales ont eu tendance à emprunter en devises
étrangères (dollar essentiellement) pour prêter dans leurs monnaies nationales.
Ces banques ont donc combiné trois types de risque :
- un risque de crédit (lié au possible défaut de solvabilité de leurs débiteurs) ;
- un risque de distorsion d'échéances (les banques empruntaient à court terme pour prêter à long
terme et risquaient donc de ne pas voir renouveler leurs propres ressources) ;
- enfin, un risque de change (elles ont emprunté en devises étrangères en pensant que l'Etat était
en mesure de garantir la valeur de la monnaie nationale).
Le processus de libéralisation a finalement fait des banques locales le maillon faible du système.
La situation était particulièrement inquiétante en Thaïlande où la spéculation immobilière a
accompagné le processus de libéralisation. Or, la rentabilité des investissements immobiliers est
loin d'être garantie. On sait en effet que ces marchés immobiliers engendrent des bulles
spéculatives. L'effondrement des cours détériore les prêts qui ont été faits en contrepartie.

Page 2 sur 6
Ces différents changements ont engendré une très forte incertitude sur la situation des banques
locales et de leurs prêteurs. Ces banques n'avaient ni l'expérience ni les compétences pour
mettre en place des systèmes internes de contrôle des risques. Elles ont continué à ne se
préoccuper que de la taille de leur bilan et du volume des crédits. La prise de conscience des
risques de fragilisation de toute la structure de dette a été tardive. Il est intéressant d'observer à
cet égard que les grandes banques internationales - qui ont pourtant des méthodes
sophistiquées d'évaluation du risque - n'aient pas perçu le danger. A la veille de la crise, leurs
indicateurs donnaient encore un signal positif.
Une crise systémique
A ces facteurs profonds s'ajoutent des facteurs plus conjoncturels liés à des chocs internes ou
externes. Dans le cas asiatique, le choc ne fut pas monétaire mais industriel. Ce fut
principalement, à partir de 1996, un ralentissement de la croissance du commerce international.
Ce ralentissement concerne les secteurs où les pays asiatiques sont fortement spécialisés :
l'électronique, l'automobile et les industries lourdes. Il a eu des effets immédiats. Les entreprises
qui avaient pourtant fortement investi afin de gagner des parts de marché à l'exportation on vu
leur rentabilité se détériorer. Il en a résulté ensuite un creusement du déficit de la balance des
transactions courantes des pays asiatiques et donc de leur endettement.
Or, les crises précédentes (notamment celles du système monétaire européen, celle du Mexique)
ont rendu les investisseurs et les grands intermédiaires internationaux particulièrement sensibles
à ce type de déficit. Ils se sont aperçus qu'un creusement trop important des déficits de la
balance des transactions courantes produisait tôt ou tard des déséquilibres durables. En
constatant les déficits des pays asiatiques, ils ont aussitôt fait le rapprochement avec les
expériences passées.
C'est dans les pays où le déficit courant s'est le plus creusé que la crise s'est d'abord manifestée
: la Thaïlande et les Philippines. Insistons bien sur ce point : dans ses manifestations initiales, la
crise qui a affecté ces pays est alors relativement classique. Elle se manifeste par le creusement
du déficit courant. C'est sous l'effet de facteurs proprement psychologiques liés à la dynamique
des marchés que la crise s'est ensuite propagée dans les autres pays. Certes, si les systèmes
financiers asiatiques n'avaient pas été fragilisés, la propagation n'aurait pas eu la même intensité.
Le déroulement chronologique de la crise asiatique est instructif : il témoigne de l'importance de
l'incertitude et par là même du caractère autoréalisateur de la crise intervenue en Asie.
Avant le déclenchement des mouvements de panique, il y a une période de latence : entre le
mois de juillet 1997 (où le Bath thaïlandais se déprécie fortement) et le début du mois d'octobre.
Durant cette période, les opérateurs se trouvent dans une situation d'indécision. C'est la période
où une action énergique des autorités internationales aurait pu tranquilliser les marchés. Au
contraire, leur inaction a entretenu l'inquiétude sur le maintien de la parité des monnaies locales
par rapport au dollar.
A partir d'octobre, la crise s'est généralisée brutalement à Hong Kong (très forte baisse de la
Bourse) et à la Corée et l'Indonésie : elle s'est propagée de marché à marché en alimentant les
mouvements de panique.
La propagation ne s'est pas limitée aux seuls pays asiatiques. L'inquiétude s'est manifestée sur
d'autres marchés, notamment au Brésil et en Russie. Il y a eu dans ces pays des secousses non

Page 3 sur 6
négligeables. Les autorités ont dû réagir en relevant leur taux d'intérêt afin de maintenir les
capitaux étrangers.
Dès lors que la crise n'est pas déterminée exclusivement par des fondamentaux (la balance des
transactions courantes, l'inflation, etc.) objectivement détériorés mais plus par des dynamiques
psychologiques de marché, il en résulte une forte incertitude et une pluralité d'issues possibles.
C'est dire si une crise financière internationale est difficilement prévisible.
Les banques internationales ont néanmoins une large part de responsabilité dans l'aggravation
de la crise financière asiatique et sa transformation en crise économique et sociale. Ces banques
ont prêté à court terme aux banques locales sous la forme de lignes de crédits destinées à
financer le commerce extérieur. Devant la détérioration de la situation, elles ont préféré ne pas
reconduire ces lignes de crédits. Les reflux de capitaux au cours de l'automne 1997 ont été très
importants : ils ont représenté plus de 10 % du PIB cumulé des pays asiatiques. Il en a résulté
une crise de liquidité dramatique qui a eu des répercussions immédiates sur l'activité
économique. Ne pouvant plus obtenir d'avances auprès de leurs banques, les entreprises de ces
pays ne pouvaient plus financer leurs exportations, ni, a fortiori, les composants qu'elles
importent. Même les pays les plus compétitifs sur le plan industriel comme la Corée n'ont pas été
épargnés. On voit comment une crise se transmet de la sphère financière à la sphère réelle par
l'étranglement du crédit qui succède brusquement à sa pléthore.
La propagation de la crise s'accompagne de mouvements de panique importants. Ces
mouvements ne se manifestaient pas au niveau international du temps où la circulation des
capitaux était contrôlée. Ils traduisent l'incertitude où se trouvent les opérateurs. Faute de pouvoir
estimer directement l'effet des facteurs qui accroissait la variabilité des rendements de leurs
placements, les opérateurs coordonnent leurs anticipations sur le mouvement des prix de marché
eux-mêmes. Il en résulte une opinion collective qui, en orientant les choix des opérateurs, devient
autoréalisatrice. Les prix varient fortement dans le même sens parce que leur mouvement récent
persuade les acteurs du marché que le mouvement va continuer. Le facteur décisif qui fait passer
la dynamique des marchés financiers d'une fluctuation normale autour d'un prix d'équilibre lui-
même évolutif à un processus autoréférentiel qui les fait diverger de tout équilibre est la liquidité.
Dans le cas des monnaies asiatiques, les prix d'équilibre étaient des taux de change ancrés sur
le dollar depuis plusieurs années. La liquidité dépendait de la poursuite des entrées de capitaux à
court terme par les banques internationales. Dès que les signes de difficulté des banques locales
ont mis en doute la pertinence du taux de change, les mouvements de capitaux ont commencé à
s'inverser, exerçant une pression sur le change ; les banques centrales des pays concernés ont
vendu des dollars pour défendre ce qu'elles estimaient être des taux de change d'équilibre. Mais
la perte des réserves a fait douter les opérateurs internationaux que la liquidité soit suffisante
pour assurer cette défense. C'est alors que la spéculation est devenue autovalidante et s'est
propagée entre les marchés de changes de la région qui souffraient du même assèchement de la
liquidité.
Que faire ?
La crise asiatique et ses effets ont relancé le débat autour des mécanismes à mettre en place
pour réguler, à défaut de prévenir, de telles crises.
Pour les libéraux, la crise viendrait fondamentalement d'une mauvaise information des
opérateurs financiers et de l'absence de contraintes sur les pays qui utilisent les capitaux
internationaux. Selon eux, il faut que les politiques économiques menées par ces pays soient

Page 4 sur 6
davantage surveillées (par le FMI en l'occurrence) ; il faut également améliorer la transparence
en exigeant des organismes financiers qu'ils produisent plus d'informations sur leur véritable
situation financière.
Placer les politiques économiques sous le contrôle d'un organisme comme le FMI implique de
restreindre la souveraineté des Etats. Or, tous les Etats ne sont pas prêts à cette éventualité.
S'agissant de la transparence, elle ne résout pas tout. Dès lors que les crises financières sont de
nature systémique, il existe en effet un niveau d'incertitude qui ne peut être a priori pris en
compte et intégré dans des modèles probabilistes d'évaluation des risques. Les crises financières
internationales ne sont pas des événements reproductibles selon des lois de probabilité connues.
Plutôt que de chercher à prévoir les risques de système, il convient d'assumer l'idée que ces
risques existent en finance internationale.
Tous les experts, qu'ils soient libéraux ou non, s'accordent sur la nécessité de mettre en place
des dispositifs « prudentiels » (incitant les opérateurs à plus de prudence). De telles réformes
sont de longue haleine et doivent respecter les différences des systèmes financiers. Dans
certains pays, l'Etat joue traditionnellement un rôle central. Les conflits engendrés par les
problèmes financiers sont gérés au niveau politique. Cette forme de régulation s'est révélée
efficace même si elle se fait au prix de procédures opaques, voire occultes.
La mise en place de dispositifs plus conformes à une doctrine libérale doit donc être envisagée
dans la longue durée. Cela passe aussi par des compromis qui reflètent des préférences
nationales. Il est illusoire d'imaginer la création d'un système de normes valables pour tous les
agents financiers et appliqué dans le monde entier. Hormis l'action en profondeur au sein des
pays qui s'engagent dans la libéralisation financière, il existe des moyens pour combattre les
aspects proprement globaux des crises financières.
Le premier consiste à redoubler les moyens de sécurité existant en renforçant notamment le
dispositif de contrôle des grandes banques ; le second, à affirmer la nécessité d'un prêteur en
dernier ressort international.
La première voie vise à réduire l'aléa moral occasionné par l'attitude d'imprudence des grandes
banques internationales qui, se croyant garanties, prennent des risques excessifs. Il faut durcir
les exigences prudentielles pour les inciter à évaluer les risques sur leurs créances.
Si un tel rôle peut être confié à un organisme déjà existant, ce ne peut être au FMI. Cette
institution traite avec des pays et non avec des agents privés. Il serait dangereux que le pouvoir
soit concentré entre ses mains, qu'il soit transformé en organisme de supervision des banques et
des Etats. Qui plus est, le FMI ne dispose pas de l'expertise adéquate. Il n'a d'ailleurs pas été en
mesure de diagnostiquer la crise de liquidités des pays asiatiques.
Au contraire, le club des grandes banques centrales localisées à la Banque des règlements
internationaux (BRI) est en mesure d'exercer un tel rôle. Les organismes de supervision bancaire
peuvent renforcer la fourniture d'informations par les grandes banques internationales de
manière à exercer une véritable supervision consolidée de groupes multiformes et habiles à
cacher des positions à risque.

Page 5 sur 6
Ces informations sont en principe confidentielles et permettent une action correctrice précoce des
superviseurs sur les banques comme cela existe déjà à l'intérieur des Etats-Unis. Le superviseur
doit avoir un pouvoir d'injonction dès qu'il a détecté une anomalie : il peut recommander à la
banque de modifier la structure de son portefeuille, de restreindre le versement de dividendes,
d'accroître le montant des provisions, de désinvestir certaines activités, etc. Autrement dit, le
superviseur exercerait une action coercitive, graduée et précoce, fondée sur une information de
qualité.
L'existence d'un prêteur en dernier ressort aurait également permis de contenir la crise asiatique.
La fonction du prêteur en dernier ressort, lorsque des ventes s'effectuent en cascade, est
d'injecter des liquidités (par l'achat de titres ou de devises). Cela permet de maintenir les prix à
un niveau jugé crucial.
Seulement, les ressources d'un prêteur en dernier ressort ne peuvent être illimitées. D'où
l'importance des actes symboliques. On en a eu une illustration avec, par exemple, les
déclarations solennelles de la Banque de France et de la Bundesbank en 1992 au moment des
mouvements de spéculation autour du franc. En affichant leur volonté d'user de tous les moyens,
elles sont parvenus à y mettre fin.
Vers une régulation internationale
De même, en frappant les marchés par ce type de déclaration, le prêteur en dernier ressort peut
dissiper la panique à la source sans avoir eu à mobiliser les fonds.
Le FMI n'est pas le mieux placé pour jouer ce rôle. Le FMI n'agit qu'à la demande des
gouvernements. Une fois sollicité, il s'ensuit une période de négociation. Or, celle-ci ne fait que
contribuer à la dramatisation de la situation. Dans le cas de la Corée, les négociations se sont
échelonnées entre octobre et décembre 1996. Le coût social de l'action du FMI (en termes de
licenciements, de baisse du pouvoir d'achat, etc.) a finalement été très élevé. L'action immédiate
d'un prêteur en dernier ressort aurait pu réduire le coût social.
Dans un monde globalisé, les banques centrales sont les agents les mieux placés pour
comprendre l'interdépendance des marchés monétaires et financiers. Elles sont les seules en
mesure de comprendre les répercussions d'une crise localisée sur l'ensemble du système
financier international.
Cependant, toutes les banques centrales ne sont pas concernées au même titre par une crise
dans telle ou telle partie du monde. Seules les plus concernées interviendraient donc au titre de
prêteur en dernier ressort. S'il y avait eu une action conjointe de la Fed (la banque centrale
américaine) et de la Banque centrale du Japon (les deux pays les plus concernés a priori), sur le
marché des changes de la Corée - pour surmonter la crise de liquidité - la panique aurait pu être
évitée. La Banque du Japon est aujourd'hui celle qui paie le plus cher les effets de cette crise. Sa
passivité montre le chemin à faire pour ancrer le rôle de prêteur en dernier ressort dans les
pratiques. Cependant, le rebondissement de la crise en juin 1998 et sa focalisation sur le yen ont
fait avancer la prise de conscience de la fonction essentielle du prêteur en dernier ressort. La
baisse du yen tendait à devenir un processus auto- réalisateur dont les répercussions sur
l'ensemble de l'économie mondiale étaient fortement perturbatrices. Le trésor et la banque
centrale des Etats-Unis se sont convaincus de la nécessité d'arrêter ce mouvement en
fournissant au marché des dollars (2 milliards, le 17 juin 1998) pour permettre aux opérateurs pris
de panique de réestimer plus sobrement le niveau du yen. Le prêteur en dernier ressort traite les
 6
6
1
/
6
100%