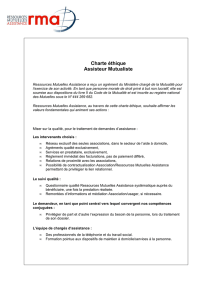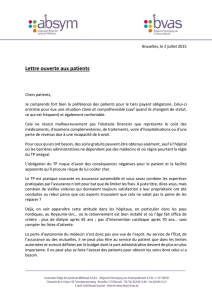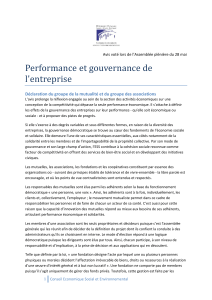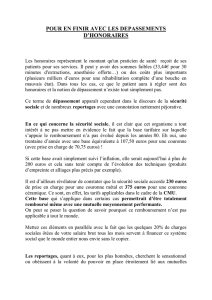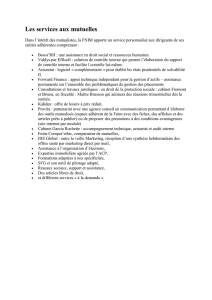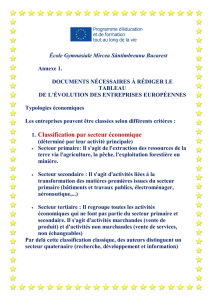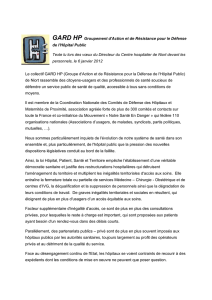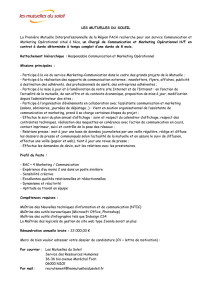compte-rendu - Saw-B

MUTUELLES DE SANTÉ NORD – SUD GNSESS 3/5 ET 4/5/2004
COMPTE-RENDU
PRÉSENTATION HDS « MUTUELLES DE SANTÉ AU NORD ET AU SUD »
3 ET 4 MAI 2004
CONTEXTE
Suite à la publication du dossier de l’Horloge du Sud, le GNSESS a décidé de mettre en
perspective et d’ouvrir le débat sur la question des mutuelles de santé au Nord et au Sud. La
forme optée était celle d’une présentation des articles par les auteurs, suivie d’un débat ouvert
avec les personnes présentes, autour de croissants et de café. L’ambiance se voulait conviviale,
pour permettre un échange de vues profond et constructif. La première rencontre a eu lieu à
Charleroi, avec le soutien de M. l’échevin Léon Casaert ; la seconde à Bruxelles, dans les locaux
de SAW.
ETAIENT PRÉSENTS (cf. dossier annexe)
INTERVENANTS
Graziella Ghesquière, Louvain Développement
Christian Legrève, Intergroupe liégeois des maisons médicales
Michèle Parmentier, Maison médicale du Maelbeek
Valérie Van Belle, Mutualités chrétiennes
Didier Cornet, Mutualité chrétienne du centre de Charleroi
David Gabriel, Groupe Terre
Patrick Bodart, Periferia
Denis Stokkink, SAW
Chantal Vandermeiren, AADC
INTRODUCTION
Dans le respect du savoir-faire et du « faire-savoir », le GNSESS se situe dans une optique de
partage des bonnes pratiques. Convaincus que nous avons à apprendre des expériences du Sud et
que la mise en commun des innovations notamment sociales et économiques, sert l’intérêt du
plus grand nombre, les structures fondatrices du GNSESS proposent en 2004 une série
d’événements axés sur les acteurs de la base avec une mise en perspective critique. Des échanges
bilatéraux entre l’Afrique, l’Amérique latine et la Belgique marqueront la saison. La globalisation
doit avoir pour pendant la solidarité globalisée.
Le GNSESS se situe comme un soutien et un « activateur » d’échanges entre personnes de la
base. Sa vision est la suivante : il faut stimuler les échanges et la globalisation autour de bases
solidaires. L’économie sociale représente une alternative aux effets pervers du néolibéralisme. La
construction d’un monde plus solidaire passe par une série d’alliances : entre ES, syndicats, Nord
et Sud.
EXPÉRIENCES
Les expériences reprises ci-dessous sont autant de manières de voir les systèmes de soins au Nord
et au Sud, et d’envisager le partage des bonnes pratiques.
1. Maisons médicales et observation dans le Sud
Pour rappel, les maisons médicales ont été créées dans un esprit révolutionnaire, des médecins à
la fin des années voulaient opter pour un nouveau type de soins de santé. Ce mouvement
révolutionnaire s’est atténué et a permis d’accéder à un système de soins de santé de qualité. Les
valeurs fondatrices continuent à l’heure actuelle de régir ce type nouveau de soins :

MUTUELLES DE SANTÉ NORD – SUD GNSESS 3/5 ET 4/5/2004
1. globalité (vision de la personne comme formant un tout)
2. intégration
3. continuité dans le suivi
4. accessibilité (géographique, financière et psychologique) du centre de santé
Le patient est au centre des soins, l’équipe fait en sorte de lui donner un pouvoir de concertation
et d’action sur le fonctionnement général. L’enjeu actuel des maisons médicales est de passer le
relais à des personnes conscientes de la démarche, car une partie du personnel arrive aux maisons
médicales motivée par la qualité et le confort et non en concordance avec les valeurs. L’ancrage
local, l’appui sur le réseau local, fait également partie des priorités.
Par ailleurs des personnes de maisons médicales se sont rendues à l’étranger pour observer et
s’inspirer de pratiques étrangères. Elles ont constaté de grosses différences culturelles notamment
autour de la notion relative de confidentialité, de secret (ce qu’on cache, qu’on ne dit pas, les
portes que l’on ferme, etc.) et de l’argent. L’immersion visait avant tout à observer les pratiques et
modes de fonctionnement, afin de remettre en question leurs propres pratiques, leur façon de
s’exprimer et de se gérer ou s’autogérer. Cela a permis également d’améliorer l’accueil et les soins
aux étrangers en Belgique. L’observation est réciproque et les échanges bilatéraux.
A l’heure actuelle ils réfléchissent à une façon de faire prendre conscience aux patients belge que
la mutuelle est basée sur la solidarité. Il faut retourner aux racines historiques du système de santé
pour réaliser que l’affiliation est un acte de solidarité, acquis par des luttes sociales importantes.
2. Mutuelles, mutualités régionales et coopération internationale
Mutualités chrétiennes et socialistes ont innové dans leur secteur en créant un service de
coopération internationale. Elles soutiennent par ce service des mutuelles de santé dans des pays
du Sud et d’Europe centrale et de l’est. Leur soutien est de type partenarial, elles ne créent donc
pas de structures mais apportent leur aide financière et structurelle à des projets locaux qui
émergent. Par ailleurs, elles offrent à la population belge une information complète sur les
mutuelles dans ces pays (cf. www.concertation.org : site inventaire des mutuelles de santé en
Afrique).
Les mutualités chrétiennes offrent un appui à 13 pays en Afrique de l’Ouest et Europe Centrale.
Leur soutien est de différents types : gestion de l’assurance obligatoire et complémentaire, assurer
que les soins de santé soient accessibles et de qualité, promotion de la santé auprès d’enfants. Ils
appuient des structures en place : technique, locaux, salaires, outils d’animation. Par ailleurs, 20
mutualités régionales belges ont développé de leur côté des partenariats dans les pays du Sud. Les
mutualités régionales ont mis en place des comités de partenariat qui s’engagent à, minimum une
fois par an, diffuser de l’information en Belgique sur le partenariat, accueillir un partenaire,
participer à une mission sur place, organiser une activité.
3. Association pour l’action du développement communautaire - AADC
L’AADC est une ONG active au départ dans le micro-crédit au Bénin. A partir des besoins
émergeant de la population locale, ils apportent aujourd’hui des études de faisabilité pour des
mutuelles de santé. L’approche adoptée est participative et la mise en place se fait par la
population locale.
4. Louvain Développement
L’objectif de Louvain développement est d’améliorer le pouvoir de négociation politique, social et
économique et d’améliorer les conditions de vie des populations du Sud. Equité, solidarité et
participation démocratique sont leurs maîtres mots. Les mutuelles de santé sont en ce sens
proches de leurs valeurs.

MUTUELLES DE SANTÉ NORD – SUD GNSESS 3/5 ET 4/5/2004
Ils offrent tout d’abord un appui technique et financier aux partenaires. Les projets émergent de
la base et Louvain Développement est partenaire. Les décisions concernant les cotisations, le
stage d’attente, etc. sont prises par les partenaires locaux tandis que des aides sont apportées en
gestion financière et administrative, en marketing social notamment. Deuxièmement, ils
accordent une grande importance à la sensibilisation, sur un an, pour permettre à la population
locale de s’approprier ce nouveau type de soins de santé. Troisièmement, des « comités
d’initiatives » sont constitués par organes communautaires. Leur but est de s’organiser pour parer
aux changements internes et externes à la mutuelle, en se tenant informés. Ils essaient de
favoriser la présence des femmes, sans pour autant fixer de quota. Finalement ils stimulent les
synergies entre les caisses de micro-crédit et les mutuelles : l’affiliation à la mutuelle de santé
oblige à prendre part à la caisse de crédit.
RÉFLEXIONS COMPLÉMENTAIRES
L’expérience du groupe Mélusine : groupe de discussions, d’activités de femmes souffrant de
troubles psychosomatiques. L’approche de dialogue et d’écoute réciproque a permis une
réduction des visites des maisons médicales de la région.
La création et le fort développement du système social ont eu pour effet pervers de faire
perdre aux bénéficiaires la conscience que le système est basé sur la solidarité. Le lien de
solidarité s’est institutionnalisé et les patients ne s’en rendent plus compte. Les mutuelles
cherchent, pour leur part, à réhabiliter la conscience de cet acte de solidarité qu’est la
cotisation et l’affiliation à une mutuelle, ils voudraient améliorer la participation des affiliés
dans les prises de décision relatives à leur mutuelle.
Les notions de prise en compte globale du patient et d’organisation collective des besoins
sont récentes chez nous. Habituellement, l’action thérapeutique en Belgique est individuelle et
on ne traite que d’un aspect de la personne à la fois. Pourtant la souffrance physique va de
pair avec la souffrance sociale, soit l’une induit l’autre soit il y a renforcement réciproque.
C’est pour cette raison que le personnel accueillant tient une place primordiale, les accueillants
doivent être capables de remettre en contexte les patients que la souffrance rend désagréables.
L’économie sociale n’est pas directement active dans la santé, et pourtant dans l’optique des
mutuelles et maisons médicales d’une part et dans les valeurs de l’économie sociale d’autre
part, il s’agit de mettre l’être humain au centre des préoccupations.
Le système social belge est bien structuré au niveau national, mais il faudrait améliorer la
structure locale. On constate en effet qu’il y a une ignorance de la réalité de terrain,
provoquant une inadéquation entre les besoins de la personne (âgée notamment) et les
structures en place. De plus, il y a un problème de respect de l’usager : équipe de soignants
qui se relaient tous les jours, absence d’équipe permanente, les usagers ne peuvent pas établir
une relation de confiance avec les soignants.
Au Sud, les mutuelles de santé ne reçoivent pas d’argent de l’état, elles trouvent alors des
techniques pour s’autogérer et s’autofinancer. Le problème est donc bien différent.
Bénévolat : un des moyens de réduire les charges financières, mais problème de rotation
d’équipes, de structure de leurs actions et ne pas négliger le coût néanmoins inévitable à
l’encadrement des bénévoles.
Facteurs culturels et religieux : il faut être prudents dans nos échanges Nord – Sud, aux
traditions médicales qui sont liées à la culture et aux croyances. Il est possible de combiner les
ressources : « pour tel type de maladie allez chez le guérisseur, pour d’autres rendez-vous au
centre de santé. » Par ailleurs, en Afrique on rencontre souvent la difficulté de s’associer aux
politiques locales, réticentes à cet apport nouveau. Il est donc important que les ressources
humaines issues de la société civile (mutuelles, ONG, etc.) aillent vers les autorités politiques
locales, les sensibilisent à la démarche. Car les considérer peut amener la population à
accorder sa confiance au centre de santé local.

MUTUELLES DE SANTÉ NORD – SUD GNSESS 3/5 ET 4/5/2004
PROBLÈMES RENCONTRÉS
1. faiblesse de l’accueil, expliquée par une forte rotation du personnel.
2. faible capacité contributive de la population.
3. faible soutien des états au Sud.
4. la gestion et l’organisation reposent souvent sur le bénévolat, d’où dépendance à
la bonne volonté des gens.
5. personnel mal payé, qui fait ses fins de mois en vendant des médicaments
parallèles et avec per diem, le barème des consultations étant fixé ils négligent
l’accueil.
CONCLUSIONS
Importance en Belgique et ailleurs, de la prise de parole et de participation dans le système
de soins de santé choisi par les comités d’usagers, les assemblées générales des usagers.
Importance en Belgique, de développer le niveau local, communautaire. De nombreux
besoins persistent, en particulier chez les personnes âgées et handicapées. Il faut en outre
rester attentif à la prise en charge du nombre grandissant des exclus des soins de santé.
A notre système social institutionnalisé, il faudrait ajouter le dynamisme inspiré des
expériences du Sud. Les relations entre Sud et Nord permettent d’ouvrir les yeux sur sa
propre histoire, de revenir aux sources de notre système de santé. De tels échanges dépassent
la simple prise en compte de l’autre, ils s’établissent sur des bases respectueuses et réalistes de
partenariat.
Points positifs existent, d’excellentes expériences existent, elles ont mis l’importance sur la
fonction d’accueillant et la volonté et la ténacité de médecins qui veulent changer le système.
Le concept d’économie sociale rejoint ces préoccupations : ancrage local, l’humain au
centre, la globalité et la transversalité, le respect et la dignité, la mutualisation des besoins, la
participation des membres, etc. Les mutuelles de santé ont trouvé une alternative socio-
économique, comme l’a fait l’économie sociale : les ponts sont à renforcer !
1
/
4
100%