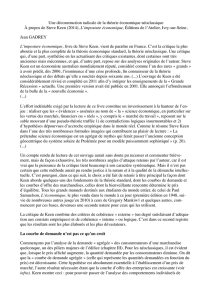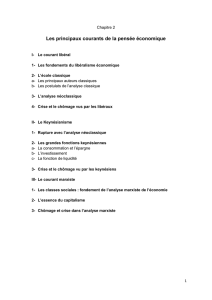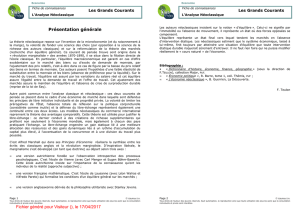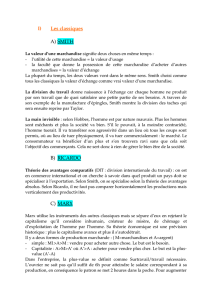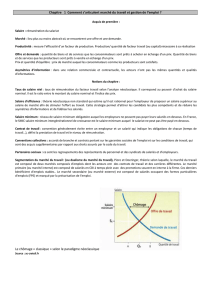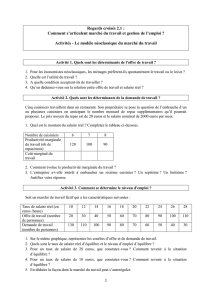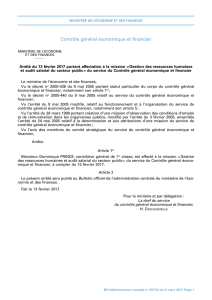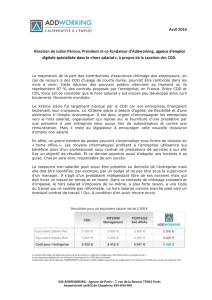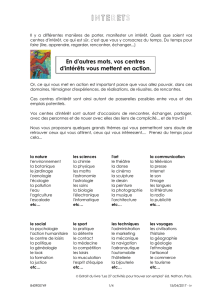Statut des fonctionnaires

Gerard CLEMENT Page 1 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017
1
CENTRE RHONE –ALPES D’INGENERIE SOCIALE SOLIDAIRE & TERRITORIALE
REVUE DE PRESSE
DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014
RETRO 2000 Le point de vue de PHILIPPE MOREAU
DEFARGES Le monde comme salle de classe
Manuel Valls au Royaume Uni : c’est too much
Europe/Etats-Unis : comment le vieux continent se
tire une balle dans le pied
Pourquoi les mauvaises politiques ne sont-elles
pas abandonnées ?
« L’imposture économique », puissante critique de
la théorie économique dominante (1)
« L’imposture économique » (2) : l’analyse de la
demande des consommateurs ne tient pas la route
« L’imposture économique » (3) : l’analyse de
l’offre des entreprises est inconsistante
« L’imposture économique » (fin) : l’idéologie de
l’équilibre des marchés comme optimum social
Avoir l’ambition d’une généralisation du dialogue
social
Le vote FN et la transformation de l’entreprise
Economie collaborative : entre promesses d'avenir
et fragilisation des modèles
Les quatre R de l'entreprise 2.0

Gerard CLEMENT Page 2 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017
2
RETRO 2000 Le point de vue de PHILIPPE MOREAU DEFARGES Le monde comme salle de classe
Le plus grand mérite de la mondialisation - mérite évidemment méconnu - pourrait être d'avoir transformé le monde en
salle de classe. Voici les Etats, ces monstres froids, insensibles à toute amitié, et prompts à en venir aux mains,
transformés en élèves studieux, se disputant la meilleure note, la première place. Etonnante et merveilleuse
métamorphose, qui ferait enfin sortir l'humanité du cauchemar de la guerre !
Que s'est-il passé ? Le facteur fondamental réside dans le passage d'un monde aux ressources finies à un monde aux
ressources infinies, la richesse n'étant plus ce que l'on possède mais ce que l'on crée. Dans un univers interdépendant,
régi par la théorie du chaos, le bonheur des uns ne vient plus du malheur des autres ; au contraire, le malheur de l'autre
annonce notre propre malheur. Les Etats-Unis l'ont compris les premiers à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et, de
ce fait, ont reconstruit ceux qu'ils venaient de vaincre. Aujourd'hui, l'Occident sait que sa prospérité sur la longue durée
dépend de son aptitude à attirer les pauvres (Europe orientale, Russie, Chine et autres) dans les circuits de la croissance.
Autrefois, la guerre faisait la vie ou la mort des Etats. Aujourd'hui, la compétition économique fixe leur destin. Ce qui a
détruit l'URSS, c'est son incapacité à rester dans la course technico-économique. Elle faisait des bombes et des fusées,
elle espionnait ; pourtant elle ne parvenait pas à intégrer la révolution de l'information. Les Etats, les sociétés de la
mondialisation sont placés sous une surveillance multiforme et permanente. Les notateurs de toutes sortes se multiplient.
Les agences de notation (rating) sont payées pour cela. Qui ne note pas ? Les opérateurs financiers notent en plaçant ou
en retirant leurs capitaux. Les diplômés notent en restant dans leur pays de naissance ou en le quittant. Les migrants
économiques évaluent les Etats intéressants : ainsi les informaticiens indiens, qu'envisage de faire venir l'Allemagne,
faisant savoir que, tout compte fait, ils préféreraient travailler aux Etats-Unis. Les organisations non gouvernementales
(ONG) consacrent, elles aussi, une grande partie de leur inépuisable énergie à noter : environnement, droits de l'homme,
protection des faibles... Quant aux organisations interétatiques, elles ne cessent de perfectionner l'articulation entre
notation et sanction : n'aura droit à des bonbons, plutôt à des crédits, que celui qui se conduit bien.
Dans le vocabulaire technocratique, cela s'appelle la « conditionnalité ». Ce frénétique et perpétuel travail de notation
entraîne des listes. Voici les meilleurs ou les plus mauvais dans tous les domaines possibles ! Etre noté, cela désacralise
beaucoup. L'Etat, cette majesté impressionnante, n'est finalement qu'un petit garçon anxieux, redoutant de ramasser une
sale note en gestion budgétaire ou en flexibilisation sociale. Les Etats ont, dans leur quasi-totalité, assimilé la leçon. Ils
bûchent les matières importantes : stabilité des prix ; rigueur financière ; rationalisation de la santé publique ; avenir des
retraites ; privatisation et déréglementation... Ils n'excluent pas les impasses, en particulier en matière d'endettement.
Les antisèches sont inutiles ; elles ne font que rappeler que la seule issue est d'être un bon élève. Il est essentiel de lever
le doigt, pour ne pas être oublié (c'est le pire), pour répondre plus vite que les autres
(regardez ma législation fiscale, ma flexibilité sociale, mon inventivité technologique), enfin pour poser sur un ton
respectueux les bonnes questions : ai-je entrepris les bonnes réformes ? suis-je assez transparent ? Il n'y a pas un seul
examinateur, mais des dizaines, tous plus exigeants les uns que les autres, car eux-mêmes, ces experts arrogants, sont
soumis à la pression constante de leurs clients, notamment des incontournables fonds de pension, ces nouveaux maîtres
du monde. Bref, on ne rigole pas sur cette planète, où l'argent est la seule affaire sérieuse.
Les Etats, devenus face au monde des élèves - tous bien peignés et bien élevés derrière leur pupitre - sont, de l'autre
côté, du côté de leur population, des professeurs. Désormais, la mission centrale d'un Etat, outre de se vendre auprès des
investisseurs internationaux, est d'enseigner la mondialisation, d'expliquer à son peuple qu'il n'y échappera pas, qu'il n'a
pas le choix. Le travail n'a rien de réjouissant, le responsable gouvernemental devant finalement avouer son impuissance
et reconnaître qu'il est comme ces personnages de Sempé, minuscules dans le coin droit du dessin, demeurant
convaincus de prononcer le plus important des discours. Ici aussi, quelle désacralisation ! Pour reformuler la belle formule
de Jean Cocteau, l'Etat ne peut même plus feindre d'être l'organisateur des mystères qui le dépassent. Impitoyable
mondialisation ! Le politique doit apprendre à rester à sa place. Il n'est là que pour faire accepter à un peuple
l'inéluctable. Etrange triomphe de la salle de classe planétaire, cette salle d'adultes, de commis-voyageurs en costume-
cravate, au moment même où l'autre salle de classe, celle des enfants, va mal ! Alors que des enfants revendiquent le
droit d'apprendre comme ils l'entendent, voici l'univers politique apprivoisé par la notation et le classement ! Serait-ce là,
pour les Etats dits souverains, l'ultime moyen de se rassurer ?
Nous voici enfin tous ensemble, ayant renoncé à se faire la guerre, ayant enfin trouvé le remède doux et efficace pour
apaiser l'angoisse et l'ennui des hommes : une compétition économique sans fin, dans laquelle chacun peut être tour à
tour premier. Mais comment ? Tout simplement en imitant celui qui, temporairement, occupe la première place. La classe
parfaite, celle où tous sont attentifs et sérieux, n'existe pas. Notre classe mondiale a ses cancres : Irak, Corée du Nord,
Cuba, pour ne citer que les plus célèbres. Ici surgit la question que se pose tout enseignant : tout élève est-il récupérable
? Y a-t-il des élèves irrécupérables ? Notre philosophie de la mondialisation, mixture d'héritage judéo-chrétien et de
rationalisme optimiste, veut que tous soient récupérables. Que l'un s'échappe (Etat délinquant, narco-Etat, paradis
fiscal...), tous seront tentés par l'évasion. La carotte de la prospérité économique est-elle suffisante pour tous les rallier ?
Ou faudra-t-il, comme dans plusieurs sociétés libérales (Etats-Unis, Royaume-Uni), envoyer en prison tous ceux qui se
refusent à jouer le jeu, l'explosion de la population carcérale devenant une perspective quasi certaine ?
Le monde n'est pas une salle de classe. A côté de toute salle de classe, il y a la cour de récréation, avec ses lois, et la
rue, avec d'autres lois encore. Alors, en ces temps de mondialisation où tout va vers l'intégration et l'organisation, où est
l'ailleurs ? La salle de récréation - les fameux loisirs – ressemble déjà beaucoup à la salle de classe, avec le tourisme
intelligent et les vacances instructives. Mais l'ailleurs, là où règnent la vie, la violence et l'absurde, où est-il ? Longtemps,
à l'ère des relations internationales « classiques », les Etats furent à la fois le rêve et la raison, la violence et la
tranquillité, la guerre et la paix. Désormais, les Etats sont sages. Au moins ceux qui ont choisi la mondialisation !
L'ailleurs - l'irrationnel, la folie - s'est retiré des Etats. Et c'est, malgré tout, un magnifique progrès, auquel la salle de
classe a beaucoup contribué. Mais l'ailleurs, qu'est-ce que vous en faites ? Où est-il ?
Ne risque-t-il pas, tel ces monstres des films d'horreur que l'on croit morts et qui se redressent soudainement, de surgir
de nulle part et renverser la mondialisation ?
Manuel Valls au Royaume Uni : c’est too much
Guillaume Duval

Gerard CLEMENT Page 3 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017
3
En visite à Londres, le premier Ministre Manuel Valls a relancé une nouvelle fois la polémique autour du contrôle des
chômeurs. Un diagnostic et des recettes erronées.
« En Grande-Bretagne et en Allemagne, le temps partiel a permis de préserver l’emploi et de repartir de manière plus forte quand la
croissance est revenue. Nous, en France, avons fait le choix d’un chômage très important et très bien indemnisé » avait déclaré Manuel
Valls à Londres au début de la semaine. Enclenchant ainsi une vive polémique au sujet du mode d’indemnisation des chômeurs en France.
Un diagnostic et des recettes erronées.
1) Du fait du temps partiel les Allemands travaillent moins que nous
Commençons d’abord par la question du temps partiel. Celui-ci est en effet plus répandu, et pour des temps de travail nettement plus
limités en moyenne, tant au Royaume Uni qu’en Allemagne. Dans ces deux pays les salariés à temps plein travaillent sensiblement plus
longtemps qu’en France : 1,3 heures par semaine pour l’Allemagne et 1,6 pour le Royaume Uni. Tandis qu’au contraire les salariés à
temps partiel y travaillent nettement moins, 3,6 heures de moins chaque semaine pour le Royaume Uni et 4,2 heures pour l’Allemagne. Si
bien qu’au final, le salarié moyen de chacun de ces trois pays travaille à peu près autant chaque semaine. Des trois ce sont cependant les
Allemands qui travaillent le moins longtemps. Dans ces trois pays comme partout dans le monde, le temps partiel est cependant presque
toujours du temps partiel féminin.
2) Les écarts de temps de travail et de rémunération entre hommes et femmes sont beaucoup plus importants au Royaume Uni
et en Allemagne
Ce temps partiel féminin généralisé admiré par notre premier ministre aboutit du coup à des écarts beaucoup plus importants qu'en France
entre le temps de travail moyen des hommes et des femmes (il ne s’agit bien entendu ici que du temps de travail rémunéré, s'y ajoute
évidemment le travail domestique assuré en France comme ailleurs surtout par les femmes). Cet écart hommes-femmes, qui est en
moyenne de 6,6 heures par semaine dans la zone euro, n’est « que » de 4,8 heures en France, alors qu’il est 8,7 heures en Allemagne et
de 8,8 heures au Royaume Uni, quasiment le double de la France.
Ce qui se traduit évidemment aussi par des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes beaucoup plus importants au
Royaume Uni (31 %) et en Allemagne (24 %) qu'en France, où il est pourtant déjà de 19 %. Il en est ainsi parce que les femmes françaises
ont résisté plus qu’ailleurs à la généralisation du temps partiel féminin et que du coup, la France a préféré la voie de la réduction du temps
de travail des hommes ET des femmes via le passage aux 35 heures, plutôt que les démarches discriminatoires adoptées de facto en
Allemagne et au Royaume Uni. Grâce aux 35 heures en effet, le temps de travail moyen des hommes et des femmes s’est rapproché en
France, alors qu’il s’éloignait au contraire, avec la montée du temps partiel en Allemagne et au Royaume Uni.

Gerard CLEMENT Page 4 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017
4
3) Bien qu’ils travaillent moins longtemps quand ils sont employés à temps plein, les Français sont plus productifs.
On reste très loin encore de l’égalité homme-femme sur le marché du travail en France, notamment à cause des inégalités persistantes en
matière de travail domestique. Il n’y a cependant aucune raison d’un point de vue sociétal, de suivre Manuel Valls et de souhaiter
rapprocher la France du « modèle » anglo-allemand, deux pays très proches en effet sur ce terrain. Mais est-ce que le choix français ne
serait pas très défavorable en revanche sur le plan économique ? Il n’y a guère de raisons de le penser. Certes, et c’est l’argument servi si
régulièrement, le fait que les salariés à temps plein travaillent moins longtemps qu’ailleurs peut présenter des inconvénients, mais a
contrario, le travail à temps très partiel est lui quasiment toujours un travail peu productif, qui pose des problèmes en matière de
coordination au sein des entreprises et d’engagement des salariés. Et au final, le temps de travail moyen des salariés français est très
proche de celui des salariés allemands et britanniques mais leur productivité est, elle, malgré les 35 heures, très supérieure : un salarié
français produit en moyenne 17 % de plus de richesses chaque année qu’un britannique et 19% de plus qu’un allemand. Et sur un plan
économique c’est cela qui compte surtout. Ce haut niveau de productivité n’est cependant pas la moindre des causes de notre chômage
élevé. Et d’une certaine façon, Manuel Valls a donc raison : pour limiter cet inconvénient, il faudrait aller plus loin dans le partage du travail
mais certainement pas par le biais du développement du travail à temps partiel féminin. Gageons, et souhaitons, que Manuel Valls ne
réussira pas de toute façon à renvoyer (partiellement) les femmes à la maison pour faire baisser le chômage…
4) les chômeurs français sont loin d’être les mieux indemnisés
Mais c’est surtout la partie du discours de Manuel Valls consacrée à l’indemnisation du chômage qui a déclenché la polémique. Il faut dire
qu’on se demande un peu quelle mouche a piqué le premier ministre pour choisir de s’exprimer à Londres sur de tels sujets en manifestant
son admiration pour l'action du gouvernement conservateur de David Cameron et pour le modèle britannique de gestion du marché du
travail. Tout en critiquant sévèrement l’assurance chômage française, alors que la nouvelle convention Unedic vient tout juste d'entrer en
vigueur au 1er octobre pour deux ans et que le sujet n'a jamais été évoqué en France par le gouvernement, et notamment pas pendant la
dernière grande "conférence sociale", censée fixer l’agenda des discussions dans ce domaine, qui ne remonte pourtant qu'à juillet dernier.
Cela ressemble un peu à un coup de tête d'adolescent impatient. Au risque d’apparaître comme une provocation non seulement vis à vis
des syndicats et des salariés français mais aussi de François Hollande qui a placé la négociation sociale au coeur de son projet. Son
premier ministre l'accuse en effet ainsi implicitement de ne pas en faire assez en refusant de passer en force pour libéraliser radicalement
le marché du travail comme avait su le faire "avec tant de succès" Margaret Thatcher et ses successeurs…
Sur le fond, les comparaisons sont difficiles entre systèmes d’assurance chômage compte tenu des multiples paramètres en jeu. Le
système français présente incontestablement un certain nombre de spécificités : son taux de remplacement se situe plutôt dans le haut de
la fourchette, sa durée d’indemnisation maximale est relativement longue et surtout le plafonnement des allocations est très élevé, au-delà
de 6000 euros par mois. C’est le point qui a été le plus critiqué. Ce plafond élevé reflète cependant le caractère assurantiel du système : on
cotise à X % de son salaire et en cas de chômage on en touche Y %. Remettre en cause les allocations les plus élevées est évidemment
possible mais l’enjeu économique est en réalité très limité : moins de 5 % des allocataires touchent plus de 2000 euros par mois. De plus le
système est déjà de facto redistributif : les cadres aux salaires élevés cotisent pour des montants importants alors qu’ils perçoivent

Gerard CLEMENT Page 5 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017
5
relativement peu de prestations car ils sont moins souvent au chômage que les salariés du bas de l’échelle. Si la remise en cause des
plafonds de prestation devait aboutir à un plafonnement des cotisations des cadres ou à leur retrait du système au profit d’assurances
privées, l’Unedic serait perdante.
Au global en tout cas, si on prend l’ensemble de ce que les différents pays consacrent à l’indemnisation du chômage et qu’on le rapporte à
leur taux de chômage, on constate que la France se situe certes dans le « haut du panier » et que nombre de pays européens sont moins
généreux avec leurs chômeurs. C’est le cas de la Grèce et de l’ensemble des pays ex communistes d’Europe centrale et orientale
(officiellement le chômage n’existait pas avant la chute du mur, ils n’avaient donc aucune institution pour y faire face), le Royaume Uni bien
sûr, mais aussi la Suède qui a véritablement sabré dans l’indemnisation du chômage au cours des dernières décennies. Cela n’empêche
pas cependant que de nombreux autres pays soient aussi plus généreux que la France. C’est le cas notamment de l’Allemagne tant
admiré, malgré les lois Hartz, ou encore de l’Irlande, malgré sa proximité avec le Royaume Uni. Mais c’est le cas surtout du Danemark,
avec sa fameuse flexisécurité, et des Pays Bas, le « modèle polder » : ces deux pays indemnisent leurs chômeurs à peu près deux fois
mieux que nous… Or on nous a régulièrement vanté leurs mérites en matière de gestion du marché du travail et invité à les copier au cours
des dernières décennies…
On peut bien sûr discuter chaque élément de l’indemnisation du chômage et remettre en cause le système français pour le rapprocher des
systèmes nettement moins généreux comme le britannique en particulier, mais cela ne fera qu’aggraver dans l’immédiat les difficultés de
l’économie française en appauvrissant encore les chômeurs et ne réglera absolument pas le fond de la question : si nous avons beaucoup
de chômeurs c’est d’abord parce qu’on crée trop peu d’emplois en France et pas parce que ces chômeurs se tournent les pouces en vivant
comme des nababs avec leurs grasses indemnités…
Guillaume Duval
Europe/Etats-Unis : comment le vieux continent se tire une balle dans le pied
Guillaume Duval
Les politiques de rigueur budgétaire menées en Europe sont moins efficaces pour réduire les déficits que la
politique américaine, plus pragmatique, et donc plus favorable à l’activité économique.
Le déficit fédéral américain s’est réduit d’un tiers au cours de l’année fiscale 2014 qui se terminait le 30 septembre
dernier et le surcroît d’endettement public américain devrait être cette année inférieur à ce qu’il sera en Europe. Mais en
réalité, c’est déjà le cas depuis 2012 malgré des déficits publics plus importants qu’en Europe grâce à la croissance et à
l’inflation plus élevées outre Atlantique.
La comparaison entre l’Europe et les Etats-Unis permet en effet de mesurer combien la politique économique menée sur
le vieux continent est contre-productive, non seulement en matière de lutte contre le chômage, mais aussi en matière de
désendettement public, qui est pourtant censé en être l'alpha et l'oméga. Jusqu’ici les déficits publics européens sont
restés très inférieurs aux déficits publics américains. Mais cette performance est atteinte au prix d'un tel étouffement de
l'activité économique et d’un niveau si faible d’inflation que, au bout du compte, l'endettement public, mesuré en % du
PIB, augmente plus vite en Europe qu'aux Etats Unis depuis 2012.
En effet si vous démarrez l’année avec 90 % du PIB de dette publique, que vous avez 3 % de déficit, 0 % d’inflation et –
1 % de croissance, vous terminez l’année avec 93 de dette pour 99 de PIB, autrement dit avec 94 % de dette rapportée
au PIB. Si vous démarrez toujours l’année avec 90 % de dette mais que vous avez 6 % de déficit et 2,5 de croissance
avec 2,5 % d’inflation, vous finissez l’année avec 96 de dette pour 105 de PIB, soit 91 % du PIB de dette…
Autrement dit, le dogme des 3 % protège moins en réalité l’Europe contre la montée de l'endettement que la politique
américaine, plus pragmatique, et donc plus favorable à l’activité économique….
Guillaume Duval
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%