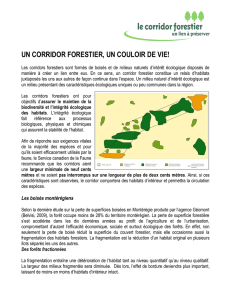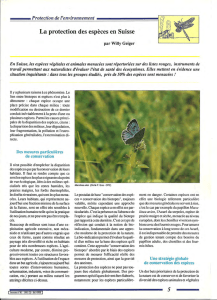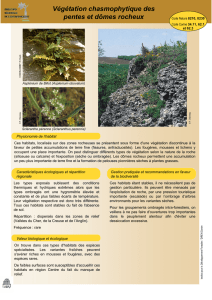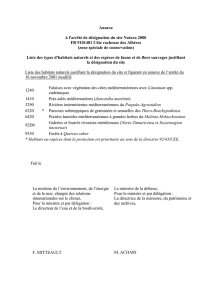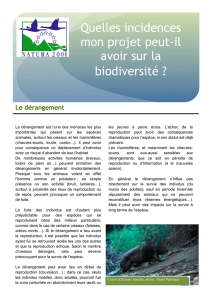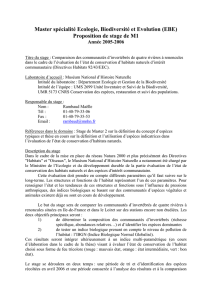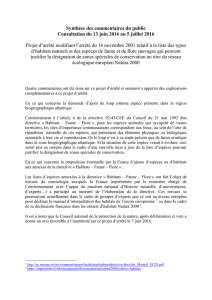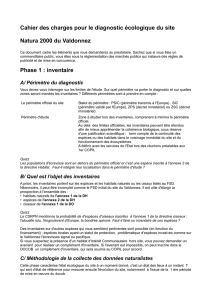Mention Ecologie, Biodiversité et Evolution

Spécialité Ecologie, Biodiversité et Evolution
Proposition de stage de M2
Année 2007/2008
Titre du stage : Impact de la fragmentation sur la structure des communautés végétales
d’Ile-de-France
Laboratoire ou structure d’accueil :
Intitulé du laboratoire ou de la structure : Muséum national d’Histoire naturelle
Intitulé de l’équipe : Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des
Populations / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
Responsable du stage :
Nom : Emmanuelle Porcher / Jacques Moret
Tél : 01 40 79 53 61
Fax : 01 40 79 35 53
Email : porcher AT mnhn.fr
Collaborations : Hélène Fréville (MNHN)
Références dans le domaine :
Fridley J.D., Vandermast D.B., Kuppinger D.M., Manthey M. and Peet R.K. 2007. Co-
occurrence based assessment of habitat generalists and specialists: a new approach for
the measurement of niche width. Journal of Ecology 95:707-722.
Julliard, J., Clavel, J., Devictor, V., Jiguet, F. & Couvet, D. 2006. Spatial segregation of
specialists and generalists in bird communities. Ecology Letters. 9:1237–1244.
Owens, I. P. F., & Bennett, P. M. 2000. Ecological basis of extinction risk in birds: habitat
loss versus human persecution and introduced predators. Proceeding of the National
Academy of Science 97:12144–12148.
Description du stage
La fragmentation et la dégradation croissantes des habitats semblent souvent entraîner
une homogénéisation biotique des communautés, ayant probablement des effets importants
sur le fonctionnement et la stabilité des écosystèmes. Dans les communautés animales par
exemple, on observe couramment l’installation d’espèces généralistes aux dépens des espèces
spécialisées sur un ou quelques types d’habitats (Owens & Bennett 2000). L’objectif de ce
stage est de vérifier si la même tendance se retrouve chez les plantes, en quantifiant l’impact
de la fragmentation des habitats sur la structure des communautés végétales, et
notamment sur leur degré de spécialisation. Nous nous focaliserons sur l’Ile de France, région
fortement anthropisée.
Pour cela, l’étudiant(e) s’appuiera sur des données de présence/absence d’espèces
végétales récoltées depuis les années 90 en Ile de France par le Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien. La relation entre fragmentation et structure des communautés
sera abordée à travers l’étude de différentes variables descriptives des communautés. Tout
d’abord, il sera intéressant d’étudier la richesse spécifique, un indice simple à obtenir et très
largement utilisé pour mesurer la biodiversité, mais qui peut fournir des indications parfois

trompeuses sur l’état de santé des écosystèmes. Ainsi, l’étudiant(e) se concentrera dans un
deuxième temps sur des indices décrivant le degré de spécialisation des espèces :
(1) L’indice de spécialisation des communautés (CSI, Julliard et al. 2006), qui est une
moyenne des indices de spécialisation des espèces, eux-mêmes définis comme des
coefficients de variation de l’abondance d’une espèce entre les différents habitats dans
lesquels l’espèce est rencontrée dans la zone d’étude. Une espèce spécialiste sera localement
abondante dans un ou quelques habitats, et aura donc un coefficient de variation d’abondance
élevé, alors qu’une espèce généraliste sera observée dans la plupart des habitats avec des
abondances équivalentes et aura donc un coefficient de variation d’abondance faible.
(2) Un indice estimant la dimension de la niche des espèces à partir des co-occurrences des
espèces (Fridley et al. 2007). Une espèce généraliste, parce qu’elle se retrouve dans de
nombreux habitats, devrait co-exister avec beaucoup d’espèces, alors qu‘une espèce
spécialiste co-habitera avec un nombre réduit d’espèces.
La mesure de la fragmentation des habitats prendra en compte à la fois la dimension
spatiale mais également temporelle en quantifiant la stabilité des habitats au cours du temps.
En utilisant une approche SIG, il sera possible de mesurer un degré de fragmentation de
l’habitat autour de chaque point d’observation, à différentes échelles spatiales, par exemple en
mesurant la longueur totale des frontières entre habitats dans une surface donnée. Nous
pourrons ainsi étudier l’impact de la fragmentation sur la richesse spécifique des
communautés, ainsi que sur leur degré de spécialisation, tout en prenant en compte d’autres
variables (en particulier le type d’habitat) dont le rôle sur la structure des communautés
végétales a déjà été démontré. En outre, afin d’étudier l’effet des caractéristiques biologiques
des espèces sur leur capacité de réponse aux changements environnementaux imposés par les
activités anthropiques, nous comparerons l’effet de la fragmentation des habitats entre des
espèces à faible capacité de dispersion et des espèces à forte capacité de dispersion.
Ces résultats nous permettront de tester l’hypothèse d’un appauvrissement des
communautés en réponse à la fragmentation des habitats. Dans une perspective appliquée,
cette étude pourrait également permettre de dégager des critères pour la mise en place ou le
maintien de corridors biologiques, en estimant à travers la comparaison de différentes échelles
spatiales la distance maximale qu’une espèce peut parcourir d’un habitat favorable à un autre.
Pour les stages de M2 UNIQUEMENT (effacez les phrases inutiles)
Ce stage est destiné aux étudiants EBE inscrits dans un parcours Recherche
o Ce stage peut se poursuivre par une thèse (ce sujet sera déposé dans une école
doctorale : Université Pierre et Marie Curie ou Muséum National d’Histoire
Naturelle)
1
/
2
100%