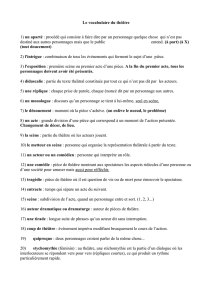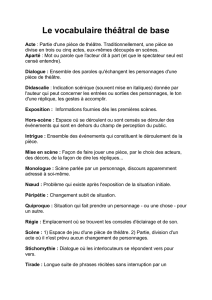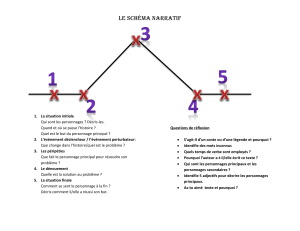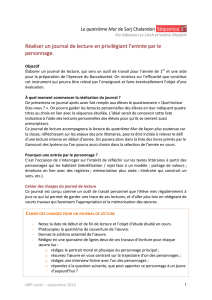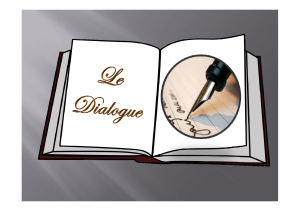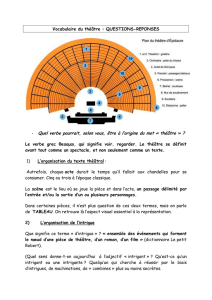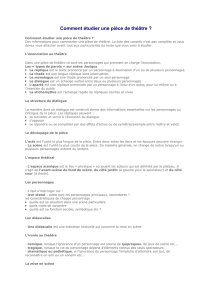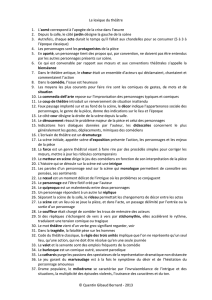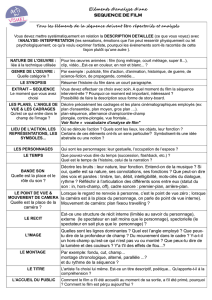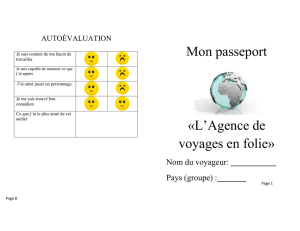Sujets Marque

MEMOIRE
POUR LE DIPLÔME D’ETUDES APPROFONDIES (D.E.A.)
EN SCIENCES DE GESTION
Les enjeux de la personnification de la marque :
le personnage de marque est-il source d’avantage
concurrentiel durable ?
Directeur de mémoire : Jacques Jaussaud – professeur à l’I.A.E. de Pau
Laurent LABORDE-TASTET
D.E.A. Sciences de Gestion
I.A.E. de Poitiers
Année 2002-2003

2
“La figurativité n’est jamais innocente”
Greimas
« A consumer survey taken in early 1985 showed that 93 percent of the people polled
remembered who Mr Clean was, although he hadn’t been on the air for years, but only 56
percent knew who Georges Bush was.»
Advertising characters : the pantheon of consumerism
Sonia Maasik and Jack Solomon
Boston Bedford books , 1994

3
Sommaire
Page
Préambule 6
Introduction 7
Chapitre 1 : Objet et opportunité de la recherche
1.1 Champs de la recherche 11
1.1.1 La marque et l’identité de marque 11
1.1.2 La communication de la marque : l’exemple du logo 15
1.2 Personnification de la marque et personnages de marque 25
1.2.1 Tradition de la personnification : anthropomorphisme, mythes et allégories 25
1.2.2 Historique des personnages de marque 27
1.2.3 Les études réalisées sur le sujet : apports 35
1.2.4 Limites et lacunes de ces études 43
1.3 Problématique de la recherche 45
1.3.1 Questions et objectifs de la recherche 46
1.3.2 Intérêts théoriques et pratiques de la recherche 47
Chapitre 2 : Le dispositif de recherche
2.1 Cadre épistémologique et méthodologique 51
2.1.1 Une démarche hypothético-inductive 51
2.1.2 Le recours à l’étude de cas 52
2.2 Fondements théoriques de la recherche 55
Chapitre 3 : Etude du cas Uncle Ben’s 61

4
Chapitre 4 : Apports et limites de la recherche
4.1 Confrontation théorie / empirie 71
4.1.1 Les enseignements du cas Uncle Ben’s 71
4.1.2 Vers une nouvelle typologie 74
4.1.3 Le personnage de marque : ressource stratégique ? 79
4.2 Limites et prolongements possibles de la recherche 84
Conclusion 86
Références bibliographiques 88
Annexes
1. Index des principaux personnages cités 92
2. Entretiens 93
3. Lexique 94
4. Mariage d’Uncle Ben’s 97

5
Introduction
Le présent projet de recherche s’inscrit dans le cadre des recherches en marketing et
communication, dans le domaine de la marque et a pour objet le personnage qui représente
cette marque. Plus d’un siècle après la naissance des premiers personnages de marque aux
Etats-Unis (Aunt Jemina) puis en France (La négrita, Le petit écolier LU), concomitamment à
l’apparition du packaging (Cochoy, 2002) et au développement de la publicité (Marc Martin
1993), l’utilisation du personnage de marque est aujourd’hui largement répandue et ce quels
que soient les produits, secteurs et publics concernés. Un examen rapide des linéaires de
produits alimentaires ou de produits à destination des enfants montrera même que ce
phénomène est devenu la règle suivie par une grande partie des fabricants. Plus de 650
personnages publicitaires ont ainsi été recensés à l’occasion de l’exposition “Un siècle de
personnages publicitaires” à la bibliothèque Forney (1999) tandis que l’étude de Callcott et
Lee (1995) porte, quant à elle, sur 700 personnages américains extraits des archives du Center
for Advertising History de Washington et de l’American Advertising Museum de Portland.
Ces chiffres, quoique modestes au regard du nombre de marques déposées sur la même durée,
sont néanmoins révélateurs de la force avec laquelle ces 700 personnages ont su marquer
notre mémoire alors que tant d’autres marques ont sombré dans l’oubli.
Présents sur les packagings, les personnages de marques viennent également chaque jour à
notre rencontre par l'intermédiaire de la publicité, des opérations de marketing ou d’internet.
Au même titre que la marque générique, certains ont atteint le nirvana du personnage de
marque en devenant parties intégrantes de notre langage quotidien (Bébé Cadum, Bibendum,
M. Propre…) et de notre manière de désigner le monde. Ils suscitent aujourd’hui un nouvel
engouement parmi les collectionneurs, en tant qu’objets de nostalgie des temps heureux de la
société de consommation de masse, dignes de figurer au panthéon du consumérisme (Maasik
et Solomon, 1994).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%