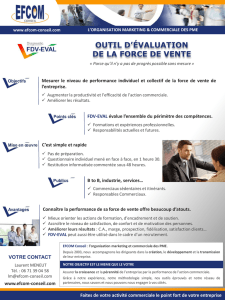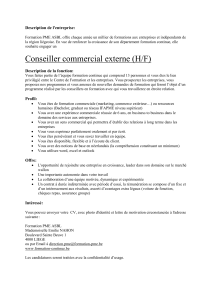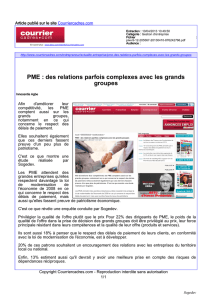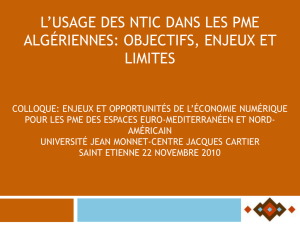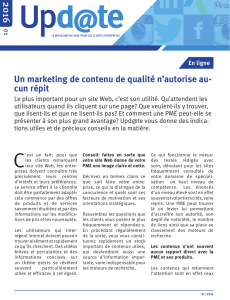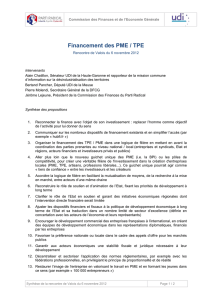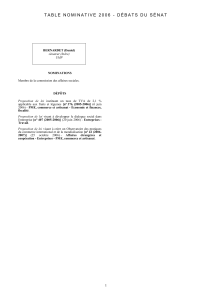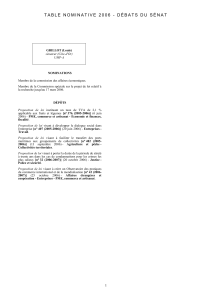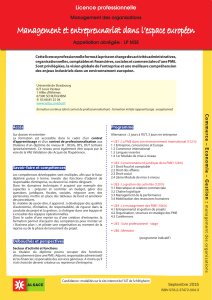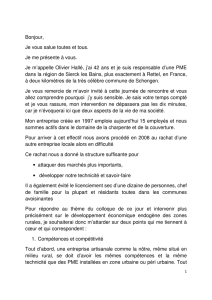Quel mode de financement pour les PME algériennes

1
Nom : Mme ABBAS-MERZOUK Octobre 2014
Prénom : FARIDA
Adresse professionnelle : Université de Bouira, Faculté de Droit et des Sciences
Economiques, Algérie
N° téléphone : 00 213 555 07 06 63
Numéro de fax : 00 213 26 93 09 24
Adresse E-Mail : [email protected]
Titre de la communication :
Quel mode de financement pour les PME algériennes ?
Résumé
Les PME par leurs investissements et par leursemplois jouent un rôle désormais
indiscutable dans le dynamisme et le développement économique d’une région (d’un pays).
(Torres, 1998 ; St-Pierre et al, 2004 ; OCDE, 2007). Les PME représentent en général, plus de
90 % de l’ensemble des entreprises. Elles génèrent plus de 55 % du PIB et plus de 65 % du
nombre total dans les pays développés. (OCDE, 2002, 2007).
A fin 2013, l’Algérie comptait plus de 700 000entreprises opérant dans
l’économie marchande. La quasi-totalité (99,8 %) était des petites et moyennes entreprises
1
.
Les entreprises privées notamment les très petites entreprises fournissent un emploi à plus
d’un million de personnes. Il revient aux pouvoirs publics algériens de veiller aux conditions
de développement de ces entreprises, notamment celle liées à leur financement, pour leur
permettre de se lancer, croître et contribuer au renforcement de l’économie nationale. Si les
débats sur l’accès aux ressources financières pour les PME sont déjà consommés dans les
pays industrialisés, ils restent d’actualité en Algérie, qui n’a pas encore achevé sa transition
vers une économie de marché.
Dans ce papier et à travers une enquête portant sur 414 PME, nous allons identifier le
mode de financement de la création de ces entreprises.
Le travail est divisé en quatre parties, la première analyse le cadre de l’enquête, la
deuxième porte sur les caractéristiques du chef de l’entreprise. La troisième est dédiée aux
caractéristiques des PME enquêtées et la dernière traite des modes de financement de la
création des PME.
1
Si on ajoute le secteur de l’artisanat.

2
Introduction
Le rôle de la PME dans le processus du développement économique n’a été reconnu que
récemment. Les pays développés voient dans la PME un complément important à la grande
entreprise et une source de création d’emploi. Les pays sous-développés y voient un outil
efficace de développent industriel taillé à leur mesure.
Les PME par leurs investissements et par leursemplois jouent un rôle désormais
indiscutable dans le dynamisme et le développement économique d’une région (d’un pays).
(Torres, 1998 ; St-Pierre et al, 2004 ; OCDE, 2007). Les PME représentent en général, plus de
90 % de l’ensemble des entreprises. Elles génèrent plus de 55 % du PIB et plus de 65 % du
nombre total dans les pays développés. (OCDE, 2002, 2007).
A fin2013, l’Algérie comptait plus de 700 000entreprises opérant dans l’économie
marchande. La quasi-totalité (99,8 %) était des petites et moyennes entreprises
2
. Les
entreprises privées notamment les très petites entreprises fournissent un emploi à plus d’un
million de personnes. Il revient aux pouvoirs publics algériens de veiller aux conditions de
développement de ces entreprises, notamment celle liée à leur financement, pour leur
permettre de se lancer, croître et contribuer au renforcement de l’économie nationale. Si les
débats sur l’accès aux ressources financières pour les PME sont déjà consommés dans les
pays industrialisés, ils restent d’actualité en Algérie, qui n’a pas encore achevé sa transition
vers une économie de marché. Dans ce papier et à travers une enquête portant sur 414 PME,
nous allons identifier le mode de financement de ces entreprises.
1. Cadrage de l’enquête
1.1. Structure du questionnaire d’enquête :
Le questionnaire comprend types de questions :
Questions générales sur l’entreprise ;
Questions sur la création de l’entreprise ;
Questions relatives à la technologie et l’innovation de l’entreprise ;
Questions relatives aux relations de l’entreprise avec les institutions
d’intermédiation au niveau local ;
Questions relatives aux caractéristiques du chef de l’entreprise.
1.2. L’échantillon d’enquête :
Les exigences de compétitivité et les besoins des entreprises en matière de mise à
niveau pour s’adapter aux standards internationaux ne peuvent être appréhendés qu’à travers
l’identification des entreprises qui disposent d’un potentiel concurrentiel appréciable. Dans ce
cas de figure, la population ciblée est les petites et les moyennes entreprises, compte tenu de
leur poids dans l’ensemble des entreprises (plus de 98 %). Le capital mobilisé, la technologie
utilisée et la nature du marché font que les petites et moyennes entreprises interviennent sur
des espaces fortement concurrentiels qui exigent des niveaux élevés de compétitivité.
L’enquêtea porté sur une population de 2000 PMEchoisies au hasard dans les zones
industrielles et les zones d’activités de 26 wilayas et l’échantillon réalisé est de 414
entreprises ce qui est exploitable.
2
Si on ajoute le secteur de l’artisanat.

3
L‘échantillon est constitué de 33,1% des moyennes entreprises, 50,3% des petites
entreprises et 16,6 % des TPE sur l’ensemble des PME.
Tableau 1 : Structure de l’échantillon selon la taille de l’entreprise
échantillon réalisé
%
TPE
61
16,6%
Petites entreprises
185
50,3%
Moyennes entreprises
123
33,1%
Total PME
368
100
Source : Etabli par l’auteurà partir de l’enquête CREAD 2013.
Le second degré dans l’élaboration de l’échantillon est l’espace. On a retenu à partir du
premier recensement économique 2011 effectué par l’ONS, de la répartition spatiale des PME
par Wilaya le poids desPME par 26 wilayas.
Tableau 2 : Structure des entreprises par wilaya
Wilaya
Effectifs
Pourcentage
Batna
40
9,6
Adrar
5
1,2
Alger
81
19,5
Annaba
5
1,2
Bordj Bou Arreridj
11
2,6
Bejaia
9
2,2
Biskra
3
0,7
Blida
31
7,5
Boumerdes
4
0,9
Constantine
9
2,2
el oued
7
1,7
El taref
1
0,2
Ghardaïa
22
5,3
Guelma
7
1,7

4
Jijel
11
2,7
Laghouat
10
2,4
M'sila
6
1,4
Mascara
24
5,8
Médéa
7
1,7
Mila
5
1,2
Oran
16
3,9
Sétif
51
12,3
Skikda
7
1,7
Tlemcen
7
1,7
Tipaza
2
,5
Tizi Ouzou
5
1,2
Total
414
100,0
Source : Etabli par l’auteur à partir de l’enquête CREAD 2013.
2. Présentation des entreprises
2.1. Profils des chefs d’entreprise
2.1.1. L’âge
Les chefs des entreprises de notre échantillon ont des âges s’étendant de 25 à 85 ans et
se répartissent en fonction de leurs âges comme le montre le tableau (3).
La moyenne d’âge de nos entrepreneurs est de 50 ans. La tranche d’âge la plus
entreprenante est la tranche de 50 ans et plus. A l’inverse les plus jeunes moins de 30 ans sont
les moins séduits par la création d’entreprises avec un taux de 4,1 % seulement. Les
entrepreneurs qui ont plus de 40 ans constituent 78 % des créateurs des entreprises. En effet,
cette tranche correspondà l’âge de la maturité, âge où on a accumulé assez d’expériences pour
avoir une plus grande confiance en soi et l’audace de changer son statut de salarié pour
lestatut prestigieux de patron d’entreprise.
Par ces résultats, l’hypothèse selon laquelle plus on avance dans l’âge, plus le désir
d’entreprendre s’estompe se trouve infirmer. Alors que quand on est très jeune, à moins de 30
ans, on est sujet à des doutes et on n’est pas encore fixé sur la direction à donner à sa vie. Pour
beaucoup c’est encore l’âge des études, pour d’autres le statut de salarié est plus recherché. En
effet, dans notre échantillon, l’entrepreneur le plus jeune a 25ans. A cet âge aussi, le manque
de ressources financières, d’expérience et de confiance en soi est plus patent qu’à l’âge de la
maturité.
Tableau 3 : Tranches d’âge des propriétaires des entreprises
Tranche d’âge
30 ans et moins
31 à 40 ans
41 à 50 ans
Supérieur à 50 ans
Pourcentage
4,1
17,9
34,4
43,6
Source : Etabli par l’auteur à partir de l’enquête CREAD 2013.
2.1.2. Le genre
Plus de 97 % des propriétaires des entreprises sont des hommes et seulement 2,8 % des
chefs d’entreprise sont des femmes.

5
Alors que la population algérienne se composede la moitié de femmes (ONS, 2014)
seuls 2,8 % des créateurs d’entreprises enquêtées sont des femmes. Il existe par conséquent,
un grand décalage entre la proportion des femmes dans la population générale et dans la
population des entrepreneurs. Par ce taux, l’Algérie est loin des 12 % des femmes
entrepreneurs en Tunisie (Banque Mondiale, 2008) ou les 32 % en France (APCE, 2014b).
En Algérie, ce décalage peut trouver son explication principale dans des considérations
socioculturelles. Dans les sociétés arabo- musulmanes, et bien que l’Islam n’a jamais interdit
à la femme d’entreprendre, il faut reconnaître que le rôle de la femme se conçoit,
prioritairement et peut-être plus qu’ailleurs, dans son foyer familial. Ainsi parmi la population
active, la femme ne représente que 19 %.(ONS, 2014a).
Tableau 4 : Le genre des chefs d’entreprises
Genre
Effectifs
Pourcentage
Masculin
378
97,2
Féminin
11
2,8
Total
389
100,0
Source : Etabli par l’auteur à partir de l’enquête CREAD 2013.
2.1.3. Formation et expérience professionnelle
La formation et l’expérience du chef de l’entreprise est un paramètre fondamental qui
prédétermine le domaine de ses investissements et par conséquent son importance
économique et sociale. Au niveau de notre échantillon, les niveaux de formation se
répartissent comme suit :
Le niveau de formation dominant de cette population semble être le niveau universitaire
puisqu’il représente 50,1 %. Les niveaux d’instruction cumulés secondaire et moyen
représentent 13,6 % et seulement 0,6 % des chefs d’entreprise ont un niveau d’instruction
primaire ou aucun niveau. Ainsi la création d’entreprise est une affaire surtout de gens de plus
en plus instruits. Ceci confirme les résultats des études précédentes telles que (Abdou, 2006,
Bouyakoub, 2003)
Tableau 5 : La formation des propriétaires des entreprises
Formation
Effectif
Pourcentage
Aucune
1
0,2
Primaire
2
0,4
Moyen et secondaire
56
13,6
Universitaire (graduation)
198
48
Universitaire (post graduation)
9
2.1
Sous total
266
64,3
Non réponse
148
35,7
Total
414
100
Source : Etabli par l’auteur à partir de l’enquête CREAD 2013.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%