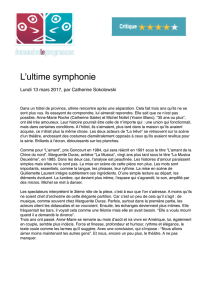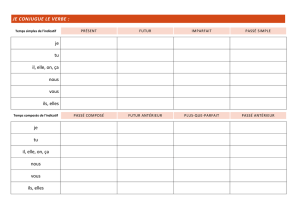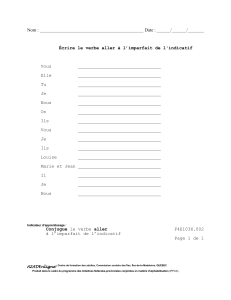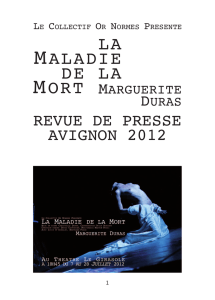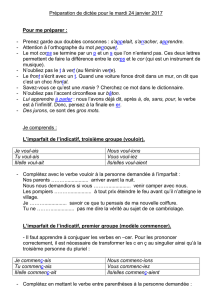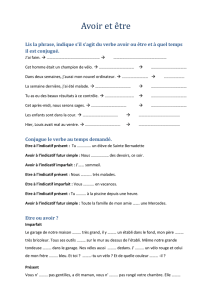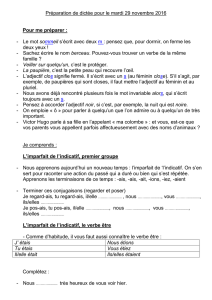Jurgita Zaicevaitė

UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE DE VILNIUS
FACULTÉ DE LANGUES ÉTRANGÈRES
DÉPARTEMENT DE PHILOLOGIE ET DIDACTIQUE FRANÇAISES
Étudiante de la II-ième année de magistère
Jurgita Zaicevaitė
LE TRANSFERT DE LA CONCORDANCE DES TEMPS DE
L'INDICATIF DU FRANÇAIS EN LITUANIEN
Mémoire
Directeur du travail :
Rasa Matonienė
Docteur en sciences humaines,
Maître de conférences
VILNIUS 2005

2
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS
UŽSIENIO KALBŲ FAKULTETAS
PRANCŪZŲ FILOLOGIJOS IR DIDAKTIKOS KATEDRA
Atliko: magistrantūros II k. studentė
Jurgita Zaicevaitė
PRANCŪZŲ KALBOS TIESIOGINĖS NUOSAKOS LAIKŲ
DERINIMO PERTEIKIMAS LIETUVIŲ KALBOJE
Magistro darbas
Darbo vadovas:
Doc. dr. Rasa Matonienė
VILNIUS 2005

3
TABLE DES MATIÈRES:
INTRODUCTION………………………………….…….…………....…………...………..4
LE MODE DE L’INDICATIF……….….………….….……...................…....…………….5
2.1. Le Présent………..………………….….…….…….…………….……………...……..6
2.2. Le Imparfait…….. …………………….…………….…………………………………8
2.3. Le Passé composé……………………….………….…………….. ………………...13
2.4. Le Passé simple………………….…………………………..……………………….14
2.5. Le Plus-que-parfait………….………………………………………………………...15
2.6. Le Passé antérieur…………………………………………………….………………17
2.7. Le Futur simple……………………………………………………………………….18
2.8. Le Futur antérieur…………………..…………………………………………………21
2.9. Le Futur dans le passé………………………. ………………………….…..……….23
2.10. Le Futur antérieur dans le passé……………...……….……………………….……23
2.11. Le Futur immédiat………………………….………………………………………..25
2.12. Le passé immédiat………………………………………………………….………..25
LES TRAITS PARTICULIERS DU SYSTÈME TEMPOREL DE L’INDICATIF DU
FRANÇAIS…………...………………………….………………………………...26
3.1. La concordance des temps de l’indicatif du français…………………………………28
3.1.1. Le plan du présent………………………………………………………………….28
3.1.2. Le plan du passé……………………………………………………………………30
IV. LE TRANSFERT DES NIVEAUX TEMPORELS DE L’INDICATIF DU FRANÇAIS
EN LITUANIEN................................…………………………………………………….32
4.1. La simultanéité………………………………………………………………………..32
4.2. L’antériorité………………………………………………………………………...…33
4.3. La postériorité………………………………………………………………………...35
V. CONCLUSION………………………………………………………………………...36
VI. BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………................37
VII. SOURCES…………………………………………………………………………....38

4
I. INTRODUCTION
L'objectif de notre mémoire est l’étude du système de l’indicatif du français et son
transfert en lituanien.
Pour donner des explications plus complètes sur le mode verbal nous avons
étudié les œuvres de plusieurs grammairiens français et étrangers contemporains. Au
début nous allons présenter leurs explications sur le sujet du mode surtout de l’indicatif.
Le mode est la catégorie du verbe qui sert à marquer le rapport de l’action,
exprimée par le verbe, à la réalité. Le fait, exprimé par le verbe, peut être présenté comme
réel, supposé, imposé, souhaité, etc.
Par tradition on distingue en français quatre modes: l’indicatif, le conditionnel,
l’impératif et le subjonctif. Cependant le conditionnel est considéré par la plupart des
grammairiens contemporains non comme un mode particulier, mais comme un temps de
l’indicatif (le futur dans le passé).
La catégorie du temps est étroitement liée à celle du mode. Toute forme temporelle
du verbe a une signification de mode. Aussi est-il nécessaire d’étudier simultanément les
valeurs modales et temporelles propres à tel ou tel mode verbal, sans les séparer.

5
II. MODE DE L’INDICATIF
Chaque mode français se distingue des autres, aussi bien par sa valeur modale que
par son système temporel. Chaque mode a son système temporel à lui.
Selon M. Grevisse (1993, p. 1161) l’indicatif est le mode des phrases énonciatives
et des phrases interrogatives. Il s’emploi aussi pour des verbes qui sont prédicats de
propositions (et non de phrases).
Les auteurs de « Grammaire française » E. K. Nikolskaïa et T. Y. Goldenberg
(1982, p.145) nous donnent une telle définition du système temporel de l’indicatif: le mode
temporel de l’indicatif est le mode de l’action réelle qui présente le fait comme certain ou
considéré comme tel:
Il a travaillé toute la nuit. Il est sérieusement malade.
Il ne soucie pas de son avenir.
Le mode de l’indicatif est très riche en formes temporelles. Il dispose de douze
formes: présent, imparfait, passé composé, passé simple, plus-que-parfait, passé antérieur,
passé immédiat, futur simple, futur proche, futur antérieur, futur antérieur dans le passé,
futur dans le passé et futur immédiat. Grâce à cette richesse de formes temporelles, on
arrive à localiser l’action à l’indicatif avec beaucoup de précision.
Une proposition à l’indicatif renferme l’affirmation d’un fait qui se réalise (ou ne se
réalise pas) au moment de la parole, d’un fait qui s’est déjà produit ( ou ne s’est pas
produit), d’un fait qui aura lieu ( ou n’aura pas lieu) dans l’avenir (E.K. Nikolskaïa, T.Y.
Goldenberg, 1982, p.148).
Nous allons présenter les théories des grammairiens des temps de l’indicatif du
français, les illustrer par nos exemples trouvés. Nous allons voir aussi comment le transfert
de la concordance de l’indicatif se fait-il en lituanien.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%