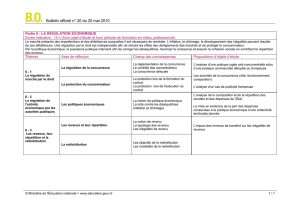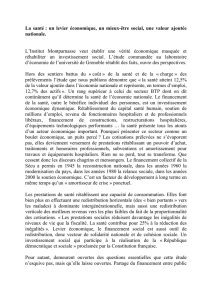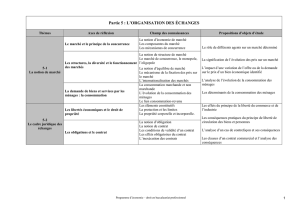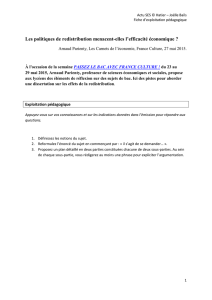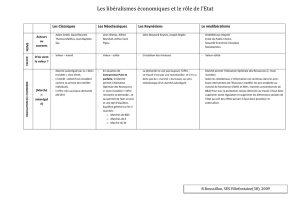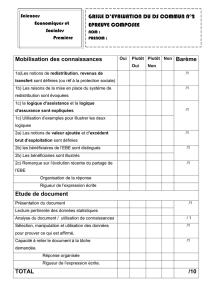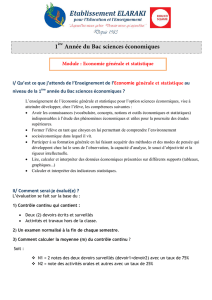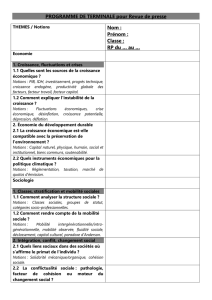Paragraphe 4 : Le développement historique des systèmes

JP BIASUTTI Colle Etat Social ECE 1 Année 2008 2009 1
Paragraphe 4 : Le développement historique des systèmes
nationaux de protection sociale: entre sécurité et insécurités
sociales
NB : Reprendre l’introduction générale du programme de colle «L’Etat et la dette sociale».
Avec Robert Castel
1
on peut distinguer analytiquement deux grands types de
protections.
Les protections civiles garantissent les libertés fondamentales et assurent la sécurité
des biens et des personnes dans le cadre d’un Etat de droit. Elles renvoient donc aux
fonctions régaliennes de l’Etat (police, justice).
Les protections sociales «couvrent» elles contre les principaux risques susceptibles
d’entraîner une dégradation de la situation des individus comme la maladie, l’accident, la
vieillesse impécunieuse, les aléas de l’existence pouvant aboutir à la limite à la déchéance
sociale.
Cependant, si les sociétés développées modernes sont, sur ces points, les formes
historiques les plus sûres des sociétés humaines, les préoccupations sécuritaires y
restent omniprésentes. Pour lever ce paradoxe, il faut admettre qu’insécurité et protections
ne sont pas deux registres contraires de l’expérience collective et que la recherche de
protections crée elle-même de l’insécurité.
Les sociétés modernes sont construites sur le terreau de l’insécurité car ce sont des
sociétés d’individus qui ne trouvent, ni en eux-mêmes ni dans leur entourage immédiat, la
capacité d’assurer leur protection. En créant ainsi de la vulnérabilité, elles engendrent une
recherche des protections qui leur est consubstantielle. De fait, le sentiment d’insécurité
n’est pas proportionnel aux dangers réels qui menacent une population mais l’effet d’un
décalage entre une attente socialement construite de protections, et les capacités
effectives d’une société à les mettre en œuvre.
On distinguera cependant les deux types de «couverture» qui tentent de juguler cette
insécurité.
La problématique des protections civiles et juridiques renvoie à la constitution d’un
Etat de droit et aux obstacles éprouvés à les incarner au plus près des exigences portées
par les individus dans leur vie quotidienne.
La problématique des protections sociales renvoie elle à la construction de l’Etat
social et aux difficultés rencontrées pour qu’il puisse assurer l’ensemble des individus contre
les principaux risques sociaux.
C’est cette dernière que l’on privilégiera ici même s’il est difficile de dissocier
fondamentalement ces deux questionnements dans une société moderne présentée de plus
en plus comme une «société du risque» (suivant l’expression proposée par le sociologue
allemand contemporain Ulrich Beck).
Il s’agit donc ici de retracer l’histoire de la mise en place de ces systèmes de
protection et de leur transformations jusqu’au moment (aujourd’hui) où leur efficacité paraît
mise en défaut par la complexification des risques qu’ils sont censés juguler, mais aussi par
l’apparition de nouveaux risques et de nouvelles sensibilités aux risques.
Pour ce faire, la notion d’«Etat providence » (censée correspondre à celle de welfare
state) n’est pas satisfaisante parce qu’elle reprend un terme utilisé péjorativement par les
penseurs libéraux opposés à toute législation sociale. Elle évoque une force supra-
humaine, arbitraire alors que la protection sociale moderne en est tout le contraire
puisqu’elle se construit sur la base de compromis entre de multiples acteurs sociaux
(partis politiques, hauts fonctionnaires, syndicats, associations familiales et de médecins).
1
Cette présentation reprend l’analyse de cet auteur, menée dans son livre L’insécurité sociale, 2003.

JP BIASUTTI Colle Etat Social ECE 1 Année 2008 2009 2
Elle laisse surtout entendre que la protection sociale relèverait uniquement des
interventions de l’Etat alors que nombre de ses institutions et organisations sont de droit
privé, a priori indépendantes de l’Etat et gérées par des partenaires sociaux. Réduire la
protection sociale à l’Etat-providence, c’est à la fois rejeter de son champ des institutions qui
renvoient à la sphère familiale ou à des communautés d’appartenance mutuelle et assimiler,
à l’inverse, à l’Etat des organisations qui en sont indépendantes et que certaines réformes
récentes ont eu pour but d’étatiser.
Ainsi la Sécurité Sociale, en France, coeur de la protection sociale, est constituée par
des organisations de droit privé placées sous la tutelle de l’Etat dans la mesure où celui-ci
leur a concédé le pouvoir de prélever des cotisations sociales obligatoires. Ce terme
de «sécurité sociale» est employé dès 1908 par Winston Churchill et passera en français via
le plan de Pierre Laroque en 1945. Ce dernier exprime justement la volonté «de réaliser la
sécurité sociale c-a-d garantir à tous les éléments de la population qu’en toutes
circonstances ils jouiront des revenus suffisants pour assurer leur subsistance familiale »
Si elle constitue le pilier du système français contemporain, elle ne se confond pas avec
celui-ci puisque l’assurance-chômage n’en fait pas partie. Aux Etats Unis, la «social
security» instituée en 1935 ne concerne que les retraités et les handicapés.
On a pu présenter la protection sociale comme la réponse, à toute époque, à la
«question sociale»
2
question née elle-même à la fin du XIXème. Ce choix revient
cependant à organiser la réflexion autour d’invariants historiques alors que les
développements actuels ne peuvent être réduits à des avatars de phénomènes éternels.
En vérité, le terme de «protection sociale», dans son sens moderne, n’a pris corps
qu’avec le passage au XX ème siècle. L’expression ne se développe en France que dans
la deuxième moitié du XXème et ce n’est qu’à partir des années 1990 que le terme «système
de protection sociale» est devenu courant. Comme le notent Jean-Claude Barbier et Bruno
Theret
3
, «dans la perspective polanyienne (de Karl Polanyi), la protection sociale renvoie à
un processus général qui a trait à la différenciation de la société en multiples sphères
de vie relativement autonomes les unes vis-à-vis des autres. Parmi ces sphères, outre
l’ordre économique marchand de l’entreprise capitaliste (avec son conflit interne entre capital
et travail), il faut compter l’ordre politique de l’Etat (structuré autour du conflit entre
gouvernants et gouvernés) et la sphère domestique de la famille (structurée, quant à elle,
autour de l’opposition homme/femme).
La prise en compte de cette différenciation sociale propre aux sociétés individualistes
permet de comprendre pourquoi on parle de protection sociale, et non pas simplement de
protection économique et de protection individuelle. Si l’on est en droit de le faire, c’ est que
la protection économique individuelle est aussi protection de la société contre elle-
même, protection contre le risque d’éclatement que le processus de différenciation fait peser
sur elle. Par rapport aux notions d’«Etat providence» et de «sécurité sociale» et, a fortiori, de
«question sociale», la notion de système national de protection sociale n’est donc pas
seulement la plus pertinente du point de vue de la description. Elle permet de souligner
l’articulation complexe des relations sociales qui sont au fondement d’ un tel système.
Tout d’ abord, la protection sociale ne protège pas seulement contre les effets négatifs de
la division sociale du travail, elle protège contre ceux de la division gouvernants/gouvernés
(en constituant des droits légitimes sur les ressources fiscales de l’Etat qui doivent être
honorées par les gouvernants) et ceux de la division sexuelle des tâches domestiques (en
assurant des droits sociaux spécifiques aux femmes).
Ce faisant, elle participe à la légitimation de l’Etat, ainsi qu’à la transformation des
formes de la vie familiale. Corrélativement, elle mobilise trois grandes modalités d’allocation
des ressources économiques en combinant assurance privée, redistribution fiscale et
solidarité familiale.
2
Le sociologue Robert Castel écrit en 1995 Les métamorphoses de la question sociale et l’historien
Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale la même année.
3
dans Le nouveau système de protection sociale, Repères, 2004, p 5 et 6.

JP BIASUTTI Colle Etat Social ECE 1 Année 2008 2009 3
Enfin, la protection sociale participe à la construction du lien social à l’échelle nationale,
dans la mesure où, au sein d’un même système institutionnel, elle relie les logiques
individuelles et collectives qui normalement s’excluent les unes les autres. Par-delà sa
différenciation (en proportion variable suivant les pays et les époques de l’assurance sociale,
l aide sociale et la mutualité), la protection sociale unifie la société »
La réflexion sur l’Etat social et la réduction des inégalités est donc obscurcie par des
problèmes terminologiques. La notion d’Etat social ne possède pas un sens univoque,
même si elle évoque clairement l’une des nouvelles fonctions de l’Etat moderne :
s’occuper du bien-être (welfare) social des citoyens et ne plus se limiter aux fonctions
régaliennes traditionnelles. En ce sens d’ailleurs, elle exprime la remise en cause la
matrice libérale de l’Etat même si l’on peut identifier un modèle libéral d’Etat social ( voir
infra la typologie du sociologue suédois Gøsta Esping Andersen et sa notion d’Eta
providence libéral/résiduel). Comme le fait François Xavier Merrien, nous définirons
provisoirement l’Etat social comme recouvrant les fonctions d’assurances sociales et
d’assistance sociale obligatoires régulées par l’Etat
4
.
On ne peut identifier politique sociale et Etat central et c’est une différence
importante avec la politique économique. Les organismes de Sécurité Sociale sont, en
France, très éclatés (régimes salariés et non salariés, régimes extra-légaux qui gèrent les
minima sociaux et l’aide sociale) ; l’Etat est fortement présent au niveau de la Sécurité
Sociale (fixation des taux de cotisations et de prestations) mais sans pouvoir sur l’UNEDIC
(qui gère l’assurance-chômage). Une partie de la politique sociale relève aussi des
entreprises ou d’associations caritatives financées par des capitaux essentiellement
privés. On doit se souvenir qu’historiquement sphère marchande et sphère sociale étaient
largement confondues (caisses ouvrières de secours mutuel, logement social réalisés à
l’initiative du patronat dans une logique paternaliste comme celle de Schneider au Creusot)
La difficulté à définir ce qui est spécifiquement social dans les interventions de l’Etat oblige à
en préciser les dimensions constitutives, au delà des particularités historiques et nationales.
Enfin, la connaissance de la construction historique des Etats sociaux s'avère
nécessaire si l’on veut comprendre l'architecture des systèmes de protection sociale
contemporains. En effet, si les Etats ont été souvent confrontés aux mêmes types de
problèmes, leur formulation et les voies suivies pour les traiter ont été différentes et pèsent
encore lourdement sur les configurations actuelles.
Pour permettre cetteconnaissance, l’histoire de l’Etat social et de la protection sociale peut
être «grossièrement» découpée en trois périodes comme le suggère François Xavier
Merrien (1997):
La première, qui débute à la fin du XIXe siècle, est une phase d'émergence et
d'édification, souvent conflictuelle: les pays européens adoptent des législations de
protection sociale, mais à des rythmes différents et selon des modalités diverses. Elle voit
émerger très progressivement des «Etats-providence» sur des bases peu affirmées. Dans
cette période, les oppositions sont nombreuses et parviennent parfois à faire échec aux
projets ou à les modifier profondément (France au XIXème et dans la première moitié du XX
ème). C’est dans cette période que les traits distinctifs des systèmes de protection sociale
nationaux se dessinent.
Une deuxième phase de maturation qui débute après la deuxième guerre mondiale.
Elle correspond à «l'âge d'or» des Etats-Providence: les controverses s'atténuent et la
protection sociale tend à se généraliser à toutes les couches de la population. La protection
sociale devient l’objet d’un consensus (le Welfare State devient l’Etat-providence pour tous)
4
La notion d’Etat social peut cependant dépasser celle de protection sociale lorsqu’elle intègre
la législation protégeant les travailleurs, le système redistributif passant par l’impôt et l’accès à
l’éducation.

JP BIASUTTI Colle Etat Social ECE 1 Année 2008 2009 4
et un élément essentiel de la civilisation (celle qui a vacillé à Auchwitz). Des convergences
apparaissent dans les systèmes européens (emprunts mutuels) sans effacer les profondes
différences historiques.
Une troisième s’ouvre avec la décennie 1980. Les systèmes de protection sociale sont
confrontés à la crise économique, source de difficultés financières, en même temps qu'à des
transformations de «la structure des risques et des besoins sociaux» (Esping-Andersen). Le
consensus s’effrite sous la critique du néo-libéralisme. Le nouveau débat n’est pas sans
rappeler celui d’avant-guerre et montre que l’Etat social est le fruit d’un compromis
institutionnalisé instable.
Une nouvelle configuration semble ainsi se dégager autour d’une nouvelle orthodoxie, née
aux Etats-Unis et au Royaume Uni, qui se caractérise par l’idée d’un passage d’un welfare
state à un worfare state. Ce message est désormais arrivé en Europe continentale, sous
une dénomination plus conceptuelle, celle d’Etat social actif (ESA).
Il s’agira donc d’ en identifier les traits essentiels, de mesurer jusqu’où les pratiques réelles
sont-elles devenues conformes à ce nouvel idéal-type et de savoir si ce modèle de l’ESA est
suffisamment puissant pour s’imposer à tous les pays, quelles que soient leurs
caractéristiques économiques et leur tradition en matière de couverture sociale.
I) La genèse de l’Etat national-social: un processus contradictoire
mais homogénéisant.
Comme on l’a dit, il existe des configurations historiques différentes de l’insécurité.
Les configurations «pré-modernes» reposent sur les «protections rapprochées» parce que la
sécurité est assurée essentiellement sur la base de l’appartenance directe à une
communauté et dépend de la force des attaches communautaires. Elle s’obtient au prix de
la dépendance par rapport au groupe d’appartenance mais les sociétés sont exposées à
une insécurité essentiellement externe (risques de guerre, d’épidémie et de disette).
L’insécurité interne est incarnée par la figure du vagabond et le vagabondage est la grande
question sociale de l’époque pré-industrielle puisqu’il opère en dehors de tout système de
régulations collectives (famille, village, corporations).
L’Etat social s'est fait de pièces et de morceaux et relève de la logique du «compromis
(de classe?) institutionnalisé». Mais, en même temps qu’il produit ses effets
homogénéisants et intégrateurs, il est «un puissant facteur d’individualisme»(Marcel
Gauchet).
Les protections sociales s'inscrivent d’abord dans les failles de la sociabilité primaire
(famille) et dans les lacunes de la «protection rapprochée» (charité, communauté) suivant
l’expression du sociologue Robert Castel. Mais l’Etat social finira par devenir la seule
protection dans une société d’individus (en raison de la dissolution de l’appartenance à
des collectivités concrètes) ce qui donne à sa remise en cause un poids particulier dans les
sociétés contemporaines.
Cette dette sociale (qui constitue l’Etat social à travers le droit social) est cependant celle
d’une société qui s’inscrit dans le cadre de l’Etat-nation. La rupture radicale qui se
produit pendant cette période ne consiste pas seulement en ce que l’Etat va peu à peu
supplanter les groupements privés dans la sphère de la reproduction sociale mais surtout,
que cette intervention législative et réglementaire va peu à peu être reconnue comme
appartenant au domaine légitime de l’Etat
5
.
5
On pourrait la rapprocher des trois fonctions de la typologie de Richard Abel Musgrave : la protection
sociale fournit un bien collectif, la cohésion sociale – fonction d’affectation ou d’ allocation-, elle a un
certain effet redistributif – fonction de distribution-, elle participe à la régulation de la conjoncture
en garantissant le revenu – fonction de stabilisation-.

JP BIASUTTI Colle Etat Social ECE 1 Année 2008 2009 5
A) Les limites de la protection sociale fondée sur la propriété privée
6
L’avènement de la modernité bouleverse le statut de l’individu : il est reconnu pour lui-
même mais il n’est pas assuré de son indépendance car la «société d’individus» porte un
risque interne de dissolution sociale et d’insécurité totale (c’est le spectre de l’état de nature
brandi par les philosophes du XVIIème, à commencer par Hobbes).
Seul l’Etat peut alors garantir une société de sécurité. Si le Léviathan peut faire peur, on
oublie de dire qu’il est aussi ce pouvoir tutélaire qui permet à l’individu d’exister comme il
l’entend en étant libéré de la peur dans la sphère privée. Hobbes va même jusqu’à
affirmer la nécessité d’une sécurité sociale : «Attendu que beaucoup d’hommes deviennent,
par la suite de circonstances inévitables, incapables de subvenir à leurs besoins par leur
travail, ils ne doivent pas être abandonnés à la charité privée. C’est aux lois de la
République d’y pourvoir, dans toute la mesure requise par les nécessités de la nature»
(Hobbes, Le Léviathan, ed 1971, p 369). Sans faire l’apologie de Hobbes, force est de
reconnaître avec Robert Castel, qu’il établit avec force l’idée qu’être protégé n’est pas un
état «naturel». C’est une situation construite, parce que l’insécurité est consubstantielle aux
sociétés d’individus modernes et qu’elle doit être combattue pour permettre de vivre
ensemble.
Si John Locke, trente ans après (1669), célèbre avec optimisme l’homme moderne qui
construit son indépendance par son travail et qui devient simultanément propriétaire de lui-
même et de ses biens, c’est en faisant de la propriété la source de la protection (plus de
dépendance, sécurité face aux aléas de l’existence, autonomie du citoyen) et en voyant que
cette souveraineté sociale du propriétaire ne se suffit pas à elle-même. C’est la défense de
la propriété qui justifie l’existence d’un Etat dont la fonction essentielle est alors de la
préserver. C’est donc à la fois un «Etat minimal» et un «Etat gendarme» car c’est un Etat de
droit qui se concentre sur ses fonctions essentielles de gardien de l’ordre public et garant
des droits et des biens des individus.
Dans cette configuration du rapport de l’Etat à la société, la protection des personnes est
inséparable de la protection de leurs biens. Si la propriété apparaît dans les droits
inaliénables des constitutions républicaines, ce n’est pas simplement comme propriété
bourgeoise, reproduisant les privilèges d’une classe. Au début de la modernité, la propriété
privée prend une signification anthropologique parce qu’elle apparaît comme le socle à
partir duquel l’individu peut s’affranchir des protections/sujétions traditionnelles et
trouver les conditions de son indépendance. Le rêve d’un Saint-Just est celui d’une
République de petits propriétaires… et non l’abolition de la propriété (qui reste un projet
minoritaire au XIXème, malgré le développement du marxisme et de l’anarchisme).
La propriété, dans la logique libérale du XIXème, est une institution sociale centrale
car elle rend inutile le «social» entendu comme l’ensemble des dispositifs qui seront mis en
place pour compenser le déficit de ressources nécessaires pour vivre en société par ses
propres moyens. Les individus propriétaires peuvent en effet se protéger eux-mêmes en
mobilisant leurs propres ressources, et ils peuvent le faire dans le cadre légal d’un Etat qui
protège cette propriété.
Il s’agit cependant d’un programme idéal (une utopie) car l’abolition de l’insécurité
implique en réalité un Etat totalitaire (comme le voit très tôt Hobbes). Comme la vertu n’est
pas spontanée et comme l’Etat démocratique refuse de l’inculquer par la force, il faut alors
admettre que la sécurité absolue des biens et des personnes ne sera jamais complètement
assurée dans un Etat de droit. On voit bien aujourd’hui que la «guerre contre le terrorisme»
ou la «tolérance zéro» induisent une demande d’Etat qui remet en cause les libertés
publiques et donc l’Etat de droit.
6
L’analyse de cette partie reprend celle développée par Robert Castel dans l’Insécurité sociale, Seuil,
2003. Malgré son fondement lointain, elle permet de mettre en perspective les déclarations de
George Bush (ou de Nicolas Sarkozy) sur l’instauration d’une «société de propriétaires» et les échos
de ce discours dans les pratiques et réformes de l’Etat social aujourd’hui.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
1
/
47
100%