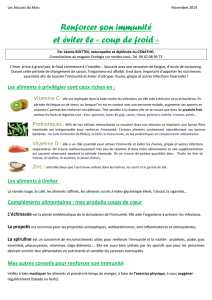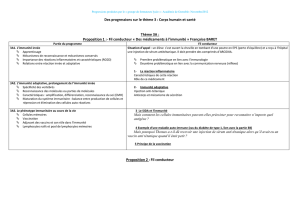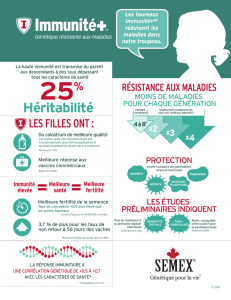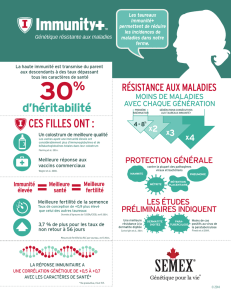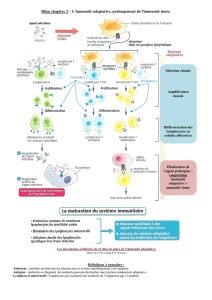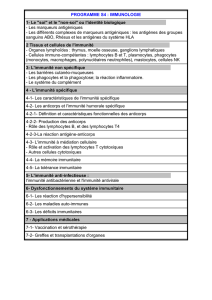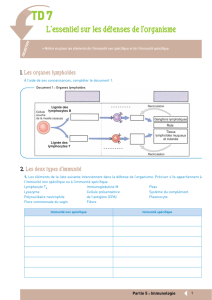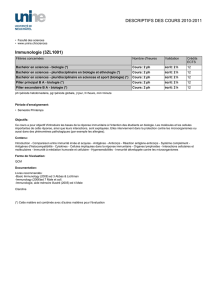L`immunité présidentielle en débat. La Magna Carta et la

1
L'immunité présidentielle en débat. La Magna Carta et la responsabilité juridique de
l'exécutif aux États-Unis
François Vergniolle de Chantal
1
22 décembre 2015
La Magna Carta de 1215 est un texte fondateur dans l’imaginaire constitutionnaliste
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne (valeur culturelle & symbolique) mais dans sa
version « reconstruite » des 17e et 18e siècles par les juristes britanniques désireux de
légitimer les pouvoirs du Parlement et des Whigs, notamment Edward Coke et William
Blackstone. Les coloniaux en particulier, lors de leur combat contre la Métropole,
l’invoquèrent contre le Roi George, tout comme les aristocrates britanniques s’en servirent
contre la Couronne lors de la guerre civile. Les Américains en particulier semblent s’être
appropriés la Magna Carta au point d’en faire un objet de révérence dont ils financent bien
volontiers la célébration et la préservation.
Mais depuis l’Indépendance qu’en est-il de la valeur juridique de la Magna Carta aux
États-Unis ?
Certains aspects de la Magna Carta, ceux développés par E. Coke et W. Blackstone
justement pour en faire cette « charte de la liberté » au cœur de l’Ancient Constitution
britannique, ont été inscrits dans la Constitution américaine. Au niveau constitutionnel, on
peut établir des parallèles avec l’Article 1, section 9, clause 2 sur l’Habeas Corpus (1789),
puis avec les Ve et VIe Amendements adoptés en 1791 et portant sur la « procédure régulière »
(Due Process)
2
, la protection des accusés dans les procédures criminelles (pas d’auto-
accusation, jury impartial) et celle du droit de propriété (eminent domain). On a ainsi
confirmation des travaux de J.G.A. Pocock et d’autres pour lesquels l’affrontement entre les
colonies américaines et la Métropole étaient une rupture idéologique entre les Whigs et les
Tories – puisque la constitution (et le Bill of Rights) reprend de nombreux principes Whigs, p.
ex. que la Chambre des Représentants, ait le pouvoir budgétaire, mais aussi des principes tirés
de la Magna Carta.
1
François Vergniolle de Chantal est professeur des Universités (Université Paris Diderot) et co-directeur de la
revue Politique Américaine (<http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=revue&no=881>). Ce texte est tiré d’une présentation effectuée à
l’Université d’Amiens le 9 décembre 2015 au colloque sur le 800e anniversaire de la Magna Carta. François de
Chantal remercie, pour leur aide dans la préparation de ce texte, Brian Kalt (Michigan State University),
Credence Sol (Université de Tours) et Geraldine George (Université Paris 2).
2
Plus tard, en 1868, le XIVe Amendement étendit la procédure régulière à tous les citoyens sur l’ensemble du
territoire américain.

2
Dans la jurisprudence fédérale, la Cour Suprême mentionne parfois la Magna Carta –
en 1819 pour la 1ère fois (Bank of Columbia v. Oakley) – mais les quelque 150 références
identifiées dans les U.S. Reports sont le plus souvent rhétoriques et manquent de substance – à
la différence peut-être des pays qui sont restés membres du Commonwealth britannique et qui
furent sous l’influence juridique du Privy Council pendant des décennies. Elles abordent aussi
une très grande variété de sujets et pas simplement, comme on pourrait le croire, la procédure
criminelle et la constitution du jury, mais aussi le droit des faillites, celui de la famille, le IInd
Amendment et les dédommagements en cas de confiscation publique de la propriété privée
(Takings Clause). Elles sont aussi souvent le fait de dissenters, comme Clarence Thomas,
dans certaines décisions récentes ; il est plus rare que la majorité y ait recours. Comme l’a dit
dernièrement le Chief Justice John Roberts « If you’re citing Magna Carta, you’re in bad
shape »
3
…
Dans ces conditions, la MC demeure bien entendu évanescente comme outil de droit
positif mais elle n’en constitue pas moins une norme symbolique puissante qui fait partie
intégrante du dialogue constitutionnel américain. Le travail interprétatif de la constitution par
les Juges ne s’est jamais résumé à un simple textualisme des quelque 4000 mots de la
constitution. Comme l’écrit Akhil Amar (2012, America’s Unwritten Constitution), le
dialogue entre la constitution écrite et ce qu’il appelle la « constitution non-écrite » est
essentiel dans l’élaboration & l’affinement de principes essentiels du droit constitutionnel
américain – comme checks and balances, séparation des pouvoirs, État de droit, égalité du
suffrage, qui ne sont pourtant nulle part mentionnés dans le texte fondateur. Ces deux
constitutions, écrites et non-écrites, fonctionnent en symbiose (ce qui se voit par exemple dans
l’Amendement IX, qui est un appel explicite de la constitution écrite à la non-écrite). Elles se
nourrissent & se limitent mutuellement, de sorte que l’opposition traditionnelle chez les
juristes entre textualisme & « constitution vivante » (living constitution) devient ici
secondaire. La Magna Carta intègre à ce titre le dialogue constitutionnel américain, en
particulier pour cette idée centrale dans nos démocraties que le gouvernement n’est pas au-
dessus de la Loi (c’est la fameuse clause 39
4
).
3
Library of Congress, « Magna Carta Legal Legacy », 19 novembre 2014 :
http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=6505 (consulté en décembre 2015). Une recherche sur
US Reports indique 14 décisions citant la MC, avec 6 pour la seule année 2015, du 1er janvier 2000 au 15
septembre 2015: Department of Transportation v. Association of American Railroads (2015) — Horne et Al. v.
Department of Agriculture (2015) — Obergefell et Al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health, et Al.
(2015) — Kerry, Secretary of State, et al. v. Din (2015) — Williams-Yulee v. Florida Bar (2015) — Wellness
International Network Ltd v. Sharif (2015) — Southern Union Co. v. United States (2012) — Hosanna-Tabor
Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC (2012)- Borough of Duryea v. Guarnieri (2011) - McDonald
v. Chicago (2010)- Stoneridge Investment Partners LLC v. Scientific-Atlanta, Inc (2008)- Lakhdar Boumediene
et Al. v. George W. Bush (2008)- Hamdi v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al. (2004) — State
Farm Mut. Automobile Ins. Co. v. Campbell (2003).
4
No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or
deprived of his standing in any way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except
by the lawful judgment of his equals or by the law of the land.

3
C’est ainsi que la Magna Carta a contribué à façonner la doctrine de l’immunité
souveraine (Sovereign Immunity) aux États-Unis. Toutes les nations démocratiques protègent
leurs représentants au sein des trois pouvoirs (Législatif, Exécutif, Judiciaire) d’actions en
justice contre leurs décisions dans le cadre de leurs fonctions afin d’éviter que leur activité ne
soit paralysée par des contestations juridiques. C’est tout particulièrement le cas pour le
titulaire de l’Exécutif. Ainsi en France la constitution dispose que le président de la
République jouit d'une irresponsabilité pour tous les actes qu'il a accomplis en cette qualité,
sauf en cas de haute trahison (articles 67 & 68). Cette disposition est héritée de la monarchie
et fut affirmée dans toutes les Constitutions françaises depuis celle de 1791. De plus, le chef
de l'État bénéficie d'une inviolabilité, qui empêche toute procédure administrative, civile ou
pénale à son encontre, pour des faits commis en dehors de ses fonctions présidentielles. Cette
inviolabilité prend fin un mois après la fin de son mandat
5
. Seule la constitution américaine
n’a pas une ligne là-dessus. L’immunité souveraine s’est construite assez lentement dans un
environnement constitutionnel républicain où les adages traditionnels du Vieux Continent –
« Le Roi ne peut mal faire » (the King Can Do No Wrong) ne s’appliquaient plus.
Le caractère tardif de l’immunité juridique du président américain, qui résulte
seulement de l’interprétation de la Cour Suprême et qui n’a pas de base constitutionnelle, est
ainsi un des principaux défauts de l’armure institutionnelle dont bénéficie par ailleurs
l’Exécutif aux EU. Ce texte se divisera donc en deux parties, l’une qui sera un rappel sur la
création de l’institution présidentielle, et l’autre sur la genèse constitutionnelle de l’immunité
souveraine aux États-Unis.
1/ La création de la présidence aux États-Unis.
L’absence de toute immunité dans la constitution américaine s’explique
simplement en référence au contexte politique et social de la fin du 18e , c’est-à-dire la
méfiance des Américains contre tout pouvoir personnel et retour de la Monarchie.
C’est donc un tour de force des fédéralistes, le mouvement nationaliste qui a permis la
ratification de la constitution entre 1787-88, d’avoir réussi à imposer un Exécutif
unique. Comme l’écrivait Harvey Mansfield, la création de l’institution présidentielle
en 1787 et son acceptation en 1789 ont « républicanisé » le Prince aux yeux de
5
En novembre 2012, la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, présidée par Lionel
Jospin ne remit pas en cause dans son rapport l'article 68, mais proposa que le caractère politique de la
destitution soit explicité. En revanche, en matière civile et pénale, la commission estima que le président de la
République devrait être responsable de ses actes commis avant son élection, ou au cours de son mandat en
dehors de ses fonctions devant une juridiction de droit commun, avec quelques aménagements pour que le
président de la République ne soit pas la cible d'actions judiciaires abusives. Un projet de loi constitutionnelle fut
présenté en Conseil des Ministres en mars 2013. Il prévoit uniquement la fin de l'inviolabilité en matière civile
du président de la République, mais toute action contre lui doit être autorisée par une « commission des
requêtes ».

4
l’opinion
6
. Le président n’était plus censé être une menace pour la république, mais au
contraire le garant de sa pérennité, un « républicain en chef » comme essaya de l’être
George Washington.
Comme en France, l’histoire de l’institution présidentielle fut de se renforcer
en se démocratisant. Andrew Jackson illustra brièvement le potentiel de pouvoir de
l’institution au 19e siècle, mais ce furent surtout les trois bâtisseurs de la présidence
moderne au 20e siècle, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson et Franklin Roosevelt
qui créèrent l’institution moderne. Après le New Deal et la Seconde Guerre mondiale,
les États-Unis vivent avec un régime présidentiel dont le rythme a été défini par
Franklin Roosevelt.
Dans ces conditions, la traditionnelle conception Whig de la présidence
(autolimitation de leurs propres pouvoirs par les présidents) perdura en gros pendant
un long 19e siècle. Le président est alors un « père de la nation » (qui reprend la vieille
doctrine britannique du patriot king) ou la « clé de voûte » des institutions
républicaines mais pas un pouvoir d’initiatives politiques. Ce modèle fut mis en
pratique par la « Dynastie de Virginie », c’est-à-dire les premiers présidents (jusqu’à
John Quincy Adams en 1828) et demeura l’habitus dominant chez les titulaires de la
charge jusqu’à la fin du 19e. Pendant cette période, et comme le diagnostiqua pour le
décrier Woodrow Wilson dans son ouvrage de 1885, le « gouvernement du Congrès »
(Congressional Government) était la norme.
Les premières décennies du 20e furent une rupture. Les présidents
progressistes, à commencer par Theodore Roosevelt, revendiquèrent avec succès la
légitimité populaire nationale afin de mettre en œuvre un programme personnel. Cette
nouvelle génération de présidents cultive un lien direct avec l’opinion publique, dont
ils peuvent se prévaloir afin de rallier les bonnes volontés autour de leurs idées,
notamment, dans ces premières décennies du 20e siècle, autour d’une exigence de
réformes sociales et économiques. Cette tendance fut le soubassement de l’évolution
présidentielle du régime politique américain. Le Président devient le « porte-parole »
du peuple, afin de se transformer en un acteur législatif à part entière, et non plus,
comme la constitution l’indique, le simple titulaire d’un pouvoir négatif, celui de
mettre son veto. Theodore Roosevelt concevait ainsi la présidence comme un « bully
pulpit », une chaire d’où le président doit prêcher, essayer de convaincre l’opinion
publique pour gagner le soutien nécessaire à ses mesures
7
.
Cette « démocratisation » de la présidence, c’est-à-dire cette construction d’un
lien politique entre le président et sa majorité, repose sur la revendication d’un
« mandat » présidentiel. Élu par le peuple, le président est « autorisé à gouverner » —
c’est le sens du mot anglais de mandate –, car il est le seul élu de la nation dans son
6
Harvey Mansfield, Taming the Prince, Free Press, 1989.
7
Dans l’argot de l’époque, « bully » signifiait « génial » ou « super » ; « pulpit » est la chaire d’où les prêtres
s’adressent aux fidèles. Dans ces conditions, le passage en français impose une adaptation, car une traduction
littérale serait maladroite.

5
ensemble. Le président se considère responsable d’abord et avant tout devant l’opinion
publique. Toute idée d’une responsabilité politique devant le Congrès est évacuée, car,
pour les présidents modernes, c’est le peuple qui est seul habilité à réclamer des
comptes au président au moment de l’élection, d’où l’importance de la communication
médiatique pour la présidence moderne.
Tout ceci ne constitue pourtant qu’une des deux facettes de la présidence
moderne. La seconde est sa transformation en institution, c’est-à-dire la constitution
d’un appareil bureaucratique et administratif
8
autour de la personne du président. Tout
comme le Congrès se dota dès le début du 19e siècle d’un maillage de commissions
pour développer une expertise indépendante, la présidence, plus d’un siècle après,
entama un processus similaire par l’institutionnalisation de différents services de
conseil, d’analyse et de gestion. Le président réussit à pérenniser son cercle de
conseillers au point d’en faire une caractéristique permanente de l’Exécutif. Franklin
Roosevelt fut sans conteste le plus innovant de tous et c’est à lui que revient d’avoir
créé le « noyau » du pouvoir administratif de la présidence en 1939, l’Executive Office
of the President. Cette fonction publique exécutive devient une ressource
supplémentaire de pouvoir pour la présidence. Elle s’insère naturellement dans la
démocratisation de l’institution qui s’est opérée dans les décennies précédentes. Le
président devient effectivement capable de gouverner selon les attentes de la majorité
qui s’est construite autour de son nom propre, sans faire de détour par le Congrès afin
de se construire une légitimité : c’est ce qu’Arthur Schlesinger, dans son ouvrage
éponyme, désigne comme la « présidence impériale » (1973).
Cette évolution, finalisée après la Seconde Guerre Mondiale, est tout à la fois
une solution et une source de problèmes, car elle a un coût. Comme l’a expliqué
Theodore Lowi dans The Personal President (1995), la « présidence plébiscitaire » qui
joue la carte de la popularité – transitoire – pour affaiblir les contraintes
constitutionnelles est en permanence en danger de franchir la ligne rouge. C’est une
évolution aggravée par l’institutionnalisation de la présidence, comme l’a souligné
Sidney Milkis en 1993 avec The President and Parties. En coupant, au moins de
manière momentanée et/ou partielle, la présidence des autres acteurs politiques que
sont le parti présidentiel et le Congrès, l’institutionnalisation isole la présidence. La
conquête d’une certaine autonomie par le président signifie qu’il est constamment en
danger d’utiliser son pouvoir sans tenir compte des mises en garde éventuelles
provenant du Législatif ou de son parti. Au sein de l’exécutif, rares sont les conseillers
qui oseront contredire un président auquel ils doivent tout, à commencer par leur
poste. Toutes les décisions remontent donc vers le président et lui seul. Il décide en
dernier ressort et doit être prêt à en assurer les conséquences. À l’inverse, le régime
parlementaire et la solidarité gouvernementale qu’il implique tempèrent ce risque de
solitude, car les décisions sont collectives. La solitude inhérente à la fonction
présidentielle a donc été accrue par son institutionnalisation. La « démocratisation » &
8
L’anglais utilise l’expression de « presidential bureaucracy » pour désigner cette structure.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%