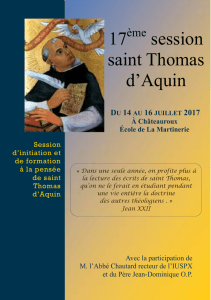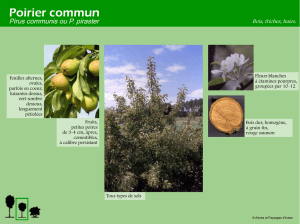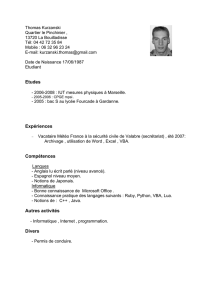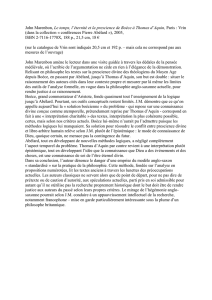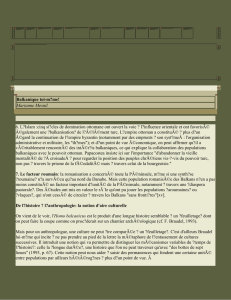Bien commun et bien(s) commun(s)

Bien commun et bien(s) commun(s)
1 mai 2004
par Alain Giffard
C'est à Thomas d'Aquin que l'on doit la notion philosophie de bien commun (bonum
communis). Un nécessaire rappel historique - et philosophique - pour mieux comprendre la
nécessaire distinction entre "Bien commun" et "biens communs".
Voici quelques remarques, écrites trop rapidement. J'ai pensé que cette fiche pouvait être utile
s'agissant d'une notion extrêmement ancienne, et même chargée historiquement, mais qui n'est
utilisée que depuis peu dans notre secteur. La note tourne autour de la distinction nécessaire
entre « Bien commun » et « biens communs ».
1/ Un peu d'étymologie
Non seulement les notions, mais le vocabulaire lui même proviennent des romains.
Bien vient de bene, adverbe, avec lequel on fabrique : bene dico = dire du bien (bénédiction),
bene facio = faire du bien (bienfait, mais aussi bénéfice), benevolentia = bon vouloir
(bienveillance, bénévole), benignus, opposé à malignus = malin, avare, (bénin, Bénines).
Bonus, adj = bon, de bonne qualité. Bonum, subs = un bien, un avantage. Au pluriel, bona =
les choses bonnes, opposées aux maux, et les biens, les avoirs. Peu de constructions à partir de
bonus et elles apparaissent à la période chrétienne (bonifacies, boniloquus).
Commun vient de communis, adj = commun, accessible. D'où dérivent : communio, subs =
mise en commun, caractère commun, communion au sens religieux ; communitas =
communauté, état, instinct social ; communicare = partager, recevoir en commun,
communiquer.
Les romains connaissent le(s) bien(s) public(s) : bonum publicum. Mais c'est Thomas d'Aquin
(XIIIe )qui créera la notion philosophique de bonum communis = bien commun.
2/ le(s) bien(s) commun(s)
On utilise ici les notions de base du droit romain, telles qu'elles ont rebondi avec le Code civil
(Napoléon).
Les romains distinguent deux catégories majeures du droit : les personnes et les choses (res).
Un bien c'est une chose qu'on peut s'approprier, ou dont l'appropriation fait question. Les
Institutes (Justinien) distinguent : les choses sacrées, propriété des dieux ; les choses
publiques, qui appartiennent à l'état ou à la cité ; les choses communes, comme la mer ; les
choses privées, propriété des personnes, qui sont précisément organisées par le droit privé.
La théorie classique du droit (Domat) distinguera outre la chose publique (res publica) : la
chose qui appartient à tous et ne peut appartenir à personne en particulier, ou res communis =
chose commune ; et la chose qui n'appartient à personne en particulier, mais pourrait

appartenir à quelqu'un, ou res nullius = chose de personne. Soit la mer, chose commune, et les
poissons, chose de personne.
Au XIXe siècle, en droit français, on peut évoquer deux aspects. D'une part, certains juristes
vont essayer de distinguer le domaine public, ou les biens du public « être moral et collectif »
du patrimoine des états particuliers.
D'autre part, s'appuyant sur les caractéristiques du monde des idées, le créateur du droit
d'auteur « français », Renouard posera que « les idées sont de libre parcours » et que, si on
doit reconnaître le droit d'auteur, y compris moral, on ne peut parler de propriété des idées.
Un arrêt de 1887 consacre l'abandon de la « propriété littéraire ».
Dans la période récente, les notions de bien public, bien commun, bien public mondial ou
local sont utilisées à nouveau, dans une approche fondamentalement économique, pour les
questions de développement, ou de régulation de la « mondialisation ».
Les biens publics bénéficient à tous ; personne ne peut en être exclu ; la consommation par
l'un n'empêche pas la consommation par l'autre. Dans ce contexte, les biens communs sont
une notion utilisée par les environnementalistes, dans un sens proche des res communis et res
nullius des romains.
Une sorte de théorie économique des biens publics mondiaux a été publié par le PNUD en
1999 (« Global Public Goods », Kaul, Grunberg et Stern, cf. références données par Renaud
Francou).
Parmi les intervenants français, Quéau a proposé un approche du « bien commun mondial »,
intégrant la propriété intellectuelle (« Libres enfants du savoir numérique » et « Du bien
commun mondial à l'age de l'information »). Aigrain a proposé une « coalition des biens
communs ».
A l'origine de la notion se situe l'œuvre de Thomas d'Aquin : Thomas relit La Politique
d'Aristote et s'en démarque sur un point important.
La cité suppose « l'existence d'un bien commun... Tout comme le tout est plus important que
la partie et lui est antérieur...la cité est antérieure à l'individu... et son bien est d'une dignité
plus élevée... que celui de chaque individu pris en lui même... Par la connaissance de la loi
naturelle l'homme accède directement à l'ordre commun de la raison, avant et au dessus de
l'ordre politique auquel il appartient en tant que citoyen d'une société particulière. » (cité par
Léo Strauss).
Là où Aristote pose que la qualité de la vie individuelle est suspendue à celle du régime
politique, Thomas pose que l'homme peut obéir au bien commun, indépendamment du
système politique.
Cette œuvre eût une portée considérable, avant d'être critiquée par les politiques modernes
(Machiavel). Elle connait un rebondissement au XXe siècle avec les thomistes (Maritain).
Gaston Fessard, dans Autorité et bien commun, 1944, décompose le bien commun en trois
sous ensembles : 1/ le bien de la communauté : les biens publics ou autres mis en commun, 2/
la communauté du bien : le caractère effectif de l'accès de chacun aux biens communs, 3/ le

bien du bien commun : la nature et l'équilibre de la relation entre l'individu et la communauté.
(cité par Claude Rochet).
Récemment, cette notion a été réactivée par des courants assez divers : certains libéraux,
comme Popper (The abdication of philosophy : Philosophy and the public good, 1994, non
traduit), ou Leo Strauss (Histoire de la philosophie politique), mais aussi les courants
« républicaniste » (Quentin Skinner) voire « populiste » (Christopher Lasch), aux Etats Unis.
En Europe, citons Ricardo Petrella (Groupe de Lisbonne, altermondialiste, Le bien commun,
1996), Claude Rochet ( républicain souverainiste, Gouverner par le bien commun 2001). Le
texte de Jacques-François Marchandise qui introduit l'université adopte ce type de définition
du bien commun.
Il me semble que deux thèmes illustrent assez bien cette orientation en faveur du bien
commun.
a/ La critique du « relativisme » moral, intellectuel et culturel, du refus des normes et de
l'autorité, du culte de l'individu et du narcissisme. On condamne particulièrement l'abdication
des parents devant les enfants, et la judiciarisation de la vie publique ou privée. (Voir le site
américain http://www.commongood.org). La critique de l'économie - et de l'idéologie
libéraliste - par ce courant tient essentiellement au fait que l'économie est par excellence le
domaine où règnent le relativisme et l'individualisme, et où, par conséquent, le respect, ou
même la reconnaissance ou la discussion du bien commun sont refusés.
b/ La méfiance à l'égard de l'état et de la bureaucratie, et, en tout cas, la nécessité de ne pas
confondre bien commun et intérêt général. L'intérêt général serait le bien du prince, dans le
sens où il est de sa responsabilité, et vise les biens publics et les règles générales de la cité.
C'est l'exemple classique du service public à la française dont la mission d'intérêt général est
définie par la loi. Le bien commun, lui, implique plus que le respect de la loi, comme
exprimant l'intérêt général. Il nécessite un engagement de chacun comme condition de
fonctionnement de la règle. Le bien commun n'est pas une norme ; il n'est pas défini par
convention ; mais il existe cependant comme objet d'une discussion entre personnes
responsables.
4/ Bien commun, bien(s) commun(s) et internet
Il y a donc un certain nombre de difficultés dans l'utilisation de ces notions. La même formule
désigne des choses et un état d'esprit, voire une philosophie. Les choses elles même sont très
diverses et composent un catalogue éclectique : l'eau, l'air, la couche d'ozone, le patrimoine
génétique, les idées. J'ai lu récemment que le syndicalisme européen et la fonction publique
européenne devaient être considérés comme des biens communs.
Cet éclectisme, et ce passage du plus matériel au plus spirituel sont substantiels à la théorie
même du bien commun. Thomas partait de la constatation que parmi les biens auxquels
aspirent les hommes, certains, parmi les plus importants, sont partagés dans une jouissance
commune. De cette base, qui est celle de la communauté humaine, il remontait jusqu'à un
ordre supérieur, celui du bien commun.

Je n'insiste pas sur une autre difficulté : la grande diversité des courants, soit politiques, soit
disciplinaires, soit professionnels qui utilisent ces notions. Il faudra vérifier régulièrement que
nous parlons bien de la même chose.
Ce qui est certainement frappant, c'est le caractère apparemment adapté à l'internet de cette
philosophie, alors que nombre d'autres théories ont fait long feu.
J'en vois trois raisons :
1/ les limites évidentes de la logique du marché et de celle des états pour construire le
cadre commun de l'internet
2/ le rôle de ces choses ou biens dont l'appropriation ne peut être pensée dans les
termes habituels : les protocoles (TCP/IP, WWW), les idées techniques génériques
(l'hypertexte), les logiciels libres, les contenus ouverts. Prenons le cas des textes
classiques numérisés. Lorsqu'il s'agit de Gallica, nous sommes devant un bien public
dont l'égalité d'accès est correctement garantie. Pourtant les textes eux même
« appartiennent à toute l'humanité » ; ils s'apparentent à un bien commun.
3/ l'importance des nouvelles formes collectives sur le net, mais aussi des nouveaux
comportements individuels : logiciels et contenus libres, wiki, blogs d'information.
Je trouve que l'exemple donné par Michel Briand est parfait. Si un professeur diffuse certains
résultats de son travail plus largement, on ne peut pas soutenir a priori qu'il le fait par intérêt
individuel. Mais on ne peut pas non plus ranger cette initiative dans la notion d'intérêt public,
puisque l'intérêt public, défini par la loi, n'impose au professeur que d'enseigner.
Personnellement, je ne sais pas encore quoi penser du bien commun comme théorie générale.
L'université sera bienvenue pour éclairer la lanterne !
1
/
4
100%