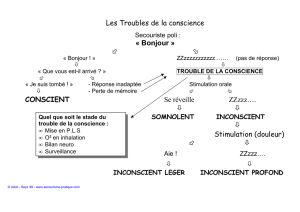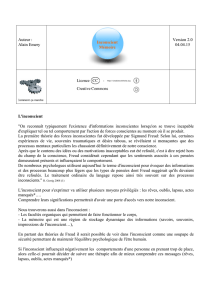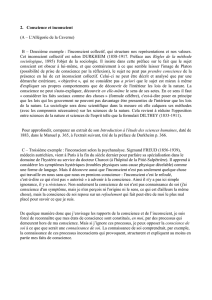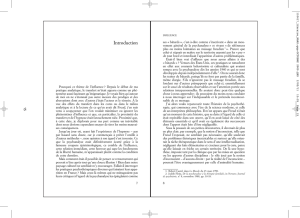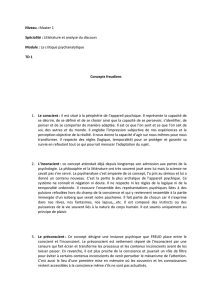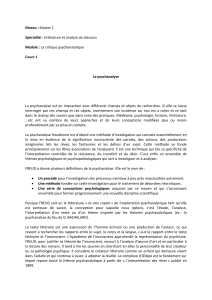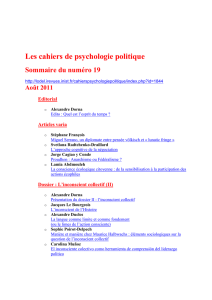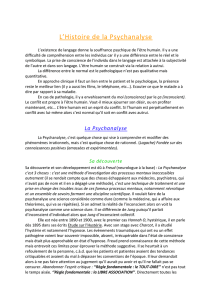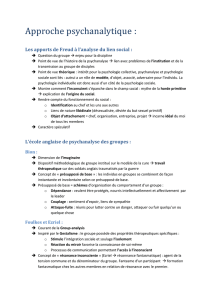Farge 2011-2012 Damien 18 Octobre 2011 CAPES Notions 1

Farge 2011-2012
Damien 18 Octobre 2011
LMPHI185, D. Forest CAPES Notions 1
1
CAPES Notions 1
Second cours sur l’hallucination :
Rappel des textes distribués :
Thomas Reid (1710-1796), Essais sur les pouvoirs intellectuels de l’homme, 1785. II
Malebranche, Recherche de la vérité : Livre I, chap. XI, section VI : Quatre choses que
l’on confond dans chaque sensation (Pléiade, I, p. 96)
Philosophie et psychologie, La connaissance tacite. Illusion de Ponzo.
G. Kunizsa/Kanizsa, Seeing and thinking.
Cours sur l’inconscient.
Première chose, il faut savoir de quoi on parle.
Il faut résister à la philosophie freudienne : il faut déborder ce que dit Freud et ce que l’on peut en faire. Il ne faut
pas foncer sur la psychanalyse : l’inconscient ne tient pas d’abord d’un concept psychanalytique.
Il faut garder la bonne distance avec Freud : il ne faut pas l’éviter ni même le citer comme une évidence.
Il faut faire en sorte que tout le monde comprenne.
Point de départ du cours : Stuart Mill, qui examine la philosophie de Sir W. Hamilton. Un chap. qui s’intitule :
les modifications mentales inconscientes, milieu du 19e.
Hamilton défend cette thèse des modifications mentales inconscientes, sous trois formes.
Inconscient - latent : est-ce que tout ce qui est latent est inconscient ?
1er sens de latent : Quelque chose que je sais, mais à quoi, présentement, je ne pense pas. Si on pose une
question de culture générale, et que je connais la réponse, la question actualise une connaissance de mon
encoprésie mentale (ce que l’on sait sans y penser) ? C’est l’objet d’une thématisassions philosophique ancienne
et topique : Aristote, Le traité de l’âme, II, 5 : distinction entre être savant et exercer la science. Il y a donc deux
sens d’être capable d’écrire : on sait écrire parce qu’on appartient à l’espèce humaine (il suffit d’apprendre), ou
bien on sait écrire parce qu’on le peut (si on veut, on peut puisqu’on le sait déjà). Il y a donc acquisition d’une
disposition.
Qui dit encyclopédie mentale ne dit pas nécessairement activité mentale inconsciente. Une connaissance peut
devenir consciente, mais l’expression connaissance inconsciente renvoie à quelque chose de clair ou de
constatable.
Il y a bien une distinction : la virtualité de la marche n’est pas un processus inconscient ; ce n’est pas quelque
chose qui serait et qu’on ne repèrerait pas.
La suggestion que fait Mill est que cet état latent, ce premier type d’état latent, l’existence de l’encyclopédie
mentale, ne fait pas quelque chose comme une activité mentale inconsciente : il manque quelque chose
d’essentiel, à savoir la notion de dynamique.
2e sens de latent : Ce que je sais ou ce dont je me souviens sans le savoir. Je crois avoir tout oublié d’une langue
apprise il y a 20 ans, mais elle me revient.
Selon Mill, ce second cas tombe exactement sous la même objection, à savoir que la mémoire latente, la latence
de souvenir, ne mérite pas le nom de modification mentale. C’est plutôt des dispositions inconnues.
3e sens de latent : Des modifications inconscientes qui se manifestent par des effets dont nous sommes
conscients. « Ce dont nous sommes conscient est construit à partir de ce dont nous ne sommes pas conscients. »
Le premier type d’exemple tient de la perception : on retrouve l’exemple Leibnizien de la Préface des nouveaux
essais, à savoir le bruit de la mer : ce bruit en tant qu’il est sensible dérive du bruit des vagues dont aucune n’est
véritablement et directement perceptible à elle seule. Il y aura, selon Leibniz, des petites perceptions de
phénomènes eux-mêmes perceptibles, dont l’agrégat est quelque chose que je peux percevoir.
Peut devenir conscient le résultat d’un processus, une pensée qui a l’air incidente ; dont elle serait
l’aboutissement. Ca se retrouve au 18e siècle chez Carpenter,
« L’esprit peut connaitre des modifications, parfois d’une importance considérable sans être conscient des
processus, jusqu’à ce que ces résultats se présentent eux-mêmes à la conscience sous la forme de nouvelles idées,
de nouvelles combinaisons d’idées que le processus a engendré. »
L’exemple du mot qui nous vient soudainement à l’esprit alors que nous avons cessé de le rechercher. L’idée est

Farge 2011-2012
Damien 18 Octobre 2011
LMPHI185, D. Forest CAPES Notions 1
2
donc que la recherche qui abouti, est donc une recherche faite en nous, et donc d’une certaine manière sans nous.
On n’est donc pas simplement dans la latence, mais dans un processus : on a donc un processus dont la
conscience constate les effets sans y avoir un accès direct.
Quel est le statut de ce processus qui échappe à la conscience ? Mérite t-il d’être appelé mental ? Ne faut-il pas
tout simplement déclarer que le processus inconscient n’est non pas seulement donné à la conscience, mais est
un processus physique (cérébral) ? Mill sympathise avec cette version.
La non réduction de la question d’inconscient à la question de la psychanalyse :
L’idée d’une pensée inconsciente est-elle contradictoire ?
Comment l’inconscient peut-il se manifester ?
Comment connaître l’inconscient ?
Il y a deux sortes de sujets : en amont et en aval.
En amont, on a un sujet sur la possibilité ou l’existence de l’inconscient, qui aura donc essentiellement deux
formes : est-ce que l’inconscient est possible, au sens de non contradictoire ? Et pourquoi admettre un
inconscient ? L’hypothèse à l’inconscient est-elle justifiée ?
En aval, sujet sur la détermination de l’inconscient : pourquoi accepter qu’il y a telle pensée de l’inconscient
plutôt que telle autre ? Les sujets en amont ont tout particulièrement besoin d’une conceptualisation
philosophique. Question du caractère arbitraire ou non des hypothèses psychanalytiques.
-------------------------------------------
La défense de l’impossibilité de l’inconscient, il en existerait trois types : Leibniz, Bergson et les variantes sur
l’inconscient cognitif.
Leibniz : défense qui part de l’idée qu’il faut admettre qu’il y a une continuité, admettre la réalité du continu. Si
on définit l’activité de l’âme comme l’activité de percevoir, alors l’absence d’aperception, c’est-à-dire l’absence
de perception consciente, ne signifie pas l’absence de l’activité. Voir l’article 14 de la Monadologie.
Bergson : Matière et mémoire, III, p. 156-165 éd. courante. Analyse du préjugé de l’existence des états
psychologiques inconscients. Cesser d’être conscient, pour un état psychologique, ce serait cesser d’exister, ce
qui revient à dire que l’état psychologique passé est inexistant, ou bien s’il survit, il survit en autre chose (genre
trace cérébrale du souvenir). Il y a donc dissymétrie ou asymétrie entre d’une part les choses matérielles que l’on
ne perçoit pas actuellement, et puis d’autre part, les états psychologiques qui, en dehors de la conscience,
cesseraient d’exister par eux-mêmes.
Le véritable rôle de la conscience est d’être lié à l’action et au réquisit de l’action. Par conséquent, la question
d’être conscient ou pas, c’est la question d’être lié au besoin immédiat de la question, et non pas la différence
entre exister ou ne pas exister.
Réflexion sur ce qu’on entend par exister : on considère comme existante les choses hors de nous en tant qu’elles
peuvent déterminer notre futur : on peut avoir à en tenir compte. Deuxièmement, quand les choses sont
ensembles, elles sont liées entre elles par des irrégularités du type : un ordre spatial du tableau qui est
indépendant, peut importe le sens utilisé pour le regardé. Il y a donc comme critère, celui d’obéir à certaines
formes d’ordre. Ainsi, les états psychologiques existent parce qu’ils jouent les deux rôles en question en tant que
la synthèse des états psychologiques passés est le caractère de l’individu. Par caractère de l’individu, c’est le
fait que l’on ne renaissait pas à nous même en chaque instant et nos décision futures nous ressemblent et
s’inscrivent dans une histoire. Il y a donc une relation de détermination au moins partielle de nos états futurs sans
avoir besoin de se rappeler consciemment ces états psychologiques passés. Ce que soutient à sa manière Bergson
est que des représentations inconscientes, ça existe, c’est-à-dire que l’on en constate l’efficace en permanence du
fait de la manière dont les individus se déterminent à faire ce qu’il font. En étant nous-mêmes, nous touchons la
réalité de l’inconscient, c’est-à-dire la présence et la réalité des états psychologiques passés.
Helmholtz : il distingue la perception visuelle et la perception de l’espace. On passe de l’élémentaire au construit
via une inférence inconsciente. C’est donc un élément de l’analyse de nos capacités. Ce que nous faisons obéit
à des principes que nous n’avons pas à nous représenter : c’est là l’une des meilleures défense, à savoir la
connaissance cognitive de l’inconscient.
Linguistique cartésienne : les principes universels de la grammaire sont innés dans l’esprit. Ca implique donc
que les différences entre les langues sont superficielles et non profondes. Ensuite, l’enfant apprend bien entendu

Farge 2011-2012
Damien 18 Octobre 2011
LMPHI185, D. Forest CAPES Notions 1
3
à parler, mais il faut comprendre l’apprentissage au sens faible, et non au sens fort. Il n’apprend pas à construire
les principes de la langue de l’expérience linguistiques puisque ces derniers sont déjà en lui. C’est l’argument de
la pauvreté du stimulus : dans l’apprentissage, l’enfant applique des règles qui n’ont pas à lui être inculquées. Il y
a plus de connaissances linguistique dans ce qu’il va dire. Les régularités auxquelles ce qu’il dit vont obéir ne
sont pas réductibles à des régularités qu’il peut tirer son expérience.
Les interrogatifs polaires : L’homme est grand. L’homme est-il grand ?
L’homme qui est venu hier est grand.
Chomsky soutient l’idée que sur le dernier exemple, on ne trouvera jamais une erreur du type : L’homme qui
est-il venu hier est grand ? Le il sera nécessairement placé dans la principale, et on a pas besoin de l’inculquer
aux enfants : ils le savent et on a pas besoin d’expliciter cette connaissance pour s’en servir. On peut donc
considérer qu’une des meilleures défenses possibles de la notion d’inconscience est celle-là : on peut obéir à
des principes qu’on a pas besoin d’expliciter pour qu’ils deviennent la règle de nos décisions ou de nos
comportement linguistiques.
Deux passages de Freud sur la défense de la notion d’inconscient :
- Notre expérience quotidienne nous fait faire la connaissance d’idées incidentes dont nous ne connaissons pas la
provenance, et de résultats de pensées dont l’élaboration nous est cachée (pas sûr de la fin)
- Un gain de sens et de cohérence est un motif pleinement justifié pour aller au-delà de l’expérience immédiate.
Selon Freud, la première chose à constater sur la première citation, c’est exactement ce que disait Carpenter plus
tôt. La justification de l’inconscient est que, premièrement, les phénomènes conscients ne portent pas en eux les
principes de leur explication. Deuxièmement, cette hypothèse augmente nos capacités à rendre compte de la
cohérence de la vie psychique. Ca se ramène donc à un point de la théorie de la connaissance générale : pourquoi
admettre quelque chose qui est complètement inobservable, notre conscience dans l’existence de x est fonction
de la valeur explicative d’une théorie d’analyse qui admet x.
Le deuxième élément de l’hypothèse est une défense pragmatique : si on peut édifier sur une hypothèse de
l’inconscient élaborer une pratique couronnée de succès, alors on aura une preuve de son existence.
Comment l’inconscient peut-il se manifester ? Comment connaître l’inconscient ?
Pour le premier, le Moi et le ça, texte de 1920, avec une première section nommée Conscience et inconscience. Il
fait une distinction de deux forme d’inconscient : l’inconscient traditionnel, c’est celui de la représentation
latente. Se pose alors la question : ce qui est latent est-il vraiment représenté ? Est-il psychique en un sens
intéressant ? Le débat est-il purement terminologique ? Il y a donc ce qu’il appelle le point de vue dynamique, à
savoir un processus ou représentation qui ne peuvent pas devenir conscient parce qu’il existe ce que Freud
appelle une force opposante qui résiste alors à leur apparition à la conscience. Donc, l’état des représentations
inconscientes est lié au refoulement. Il y a donc une forme de résistance. Le prototype de l’inconscient version
Freud, c’est le refoulé car dans ce cas là, la différence n’est pas simplement une différence de degré (ex. moindre
conscience), ni même une différence de moment (latence temporaire ou l’encyclopédie mentale). Qui dit
inconscient dit symptôme et résistance à l’analyse.
Voir Politzer, qui a publié en 1928 chez Puf, la critique des fondements de la psychologie. Freud selon lui n’a
pas complètement rompu avec la psychologie traditionnelle puisque celle-ci postulait des stratégies
traditionnelles. Freud aussi substitue à la vie psychologique réelle un conflit entre des entités postulées, comme
l’inconscient.
Politzer critique aussi l’inférence du symptôme à l’inconscient en donnant pour idée que si on décrypte le rêve à
la Freud, ça ne marque que selon un certain postulat : le contenu explicite du rêve, c’est le travestissement d’un
contenu latent. Il y a donc une forme de pensée derrière la pensée, qui existe et à laquelle on a un accès indirect :
une pensée qu’on aurait toujours eu sans le savoir. Ce que soutient Politzer, est que l’on pourrait faire une
psychanalyse sans inconscient (ce qu’a tenté Sartre dans sa psychanalyse existentielle) : on interprète ce que
Politzer appelle le drame, ou conflit de l’existence, mais on ne postule pas que ça rejoigne une pensée latente qui
existerait déjà. On ne pourrait pas révéler une pensée inconsciente : on est pas convaincu par le fait qu’il faille
mettre une pensée latente sous la pensée explicite du rêve sous le symptôme.
Sur la manifestation de l’inconscient, la connaissance de l’inconscient, le livre de référence est de Grünbaum, les
fondements de la psychanalyse. Grünbaum est avant tout un philosophe des sciences. Mais son problème est
d’examiner en détail la thèse d’inflexibilité des hypothèses psychanalytiques, par ex. conjecture et réfutation de
1962 : il n’y a pas de comportement humain qui puisse contredire une thèse de Freud. Il n’y aura jamais de mise
à l’épreuve. Si le patient accepte l’interprétation proposé, alors c’est un élément de confirmation, mais s’il
refuse, c’est une résistance énergique à la vérité.
La psychanalyse, c’est bien une connaissance empirique, jusqu’à un certain point. Chez Grünbaum, il provoque

Farge 2011-2012
Damien 18 Octobre 2011
LMPHI185, D. Forest CAPES Notions 1
4
en disant que Freud tombe sur des falsificateurs de ses hypothèses : p est causalement nécessaire pour n sera
falsifié à chaque fois qu’une victime de n n’est pas sujet à p. (p n’est pas une condition nécessaire, sauf si on a
une cause étiologique forte : p implique nécessairement n. Cependant, si un cas n’est pas valable, alors
l‘hypothèse tombe.) Freud est donc dans une démarche scientifique tout à fait standard. Mais beaucoup
d’hypothèse de la psychanalyse ne sont pas justement des hypothèses étiologiques fortes. Très souvent, p ne
cause pas inconditionnellement n, mais p dispose à n. Le retour de l’Oedipe féminin à la puberté peut conduire à
la déception car la mère de la jeune fille est enceinte, et entrainerait une orientation homosexuelle de la fille. On
a donc identifié ici un facteur de risque : quelque chose qui augmente la probabilité de. On est donc dans une
démarche scientifique tout a fait canonique.
Il reste selon lui un problème central, à savoir celui du sort réservé aux interprétations du psychanalyste par le
patient. Du fait du transfert, le patient est dans un état d’extrême perceptibilité. Comment faire un partage entre
un assentiment subjectif d’un patient et une confirmation objective ? Comment valider une certaine
interprétation ou hypothèse s’il y a une sorte de disposition inconditionnelle à accepter ce qui vient de
l’analysant ?
Grünbaum est persuadé que Freud connait le problème et écrit un texte qui date de la première guerre :
conférence sur la thérapie analytique de 1917. On tombe donc sur the Tally Agument (argument dit de la
concordance).
Le patient est influençable, mais « ceci n’affecte que son intelligence non sa maladie. » Il existe une source
subjective de confirmation de l’hypothèse : l’incidence que l’interprétation a ou n’a pas, sur le cours ultérieur de
la maladie. Après tout, ces conflits seront seulement résolus, et ces résistances surmontées, si les suggestions
qu’on lui fait s’accordent avec ce qui est réel en lui. Tout ne se passe pas dans un dialogue entre la conscience du
patient et les suggestion de l’analyste car ce qu’ils disent ou ce qu’ils pensent se rapporte à quelque chose
d’extérieur à la conscience. La différence importante est que les énoncés faux peuvent convaincre
intellectuellement comme témoin de la maladie, mais ils ne peuvent pas modifier l’état de ce sujet si
l’interprétation est erronée. Si on dit vrai, on a le moyen de transformer ce dont on parle, et c’est ainsi que l’on
aura un critère de la véracité des hypothèses. La connaissance de l’inconscient est attestée par l’efficace de ??? et
ceci n’a rien à voir avec l’assentiment suggestive du patient.
Il y a donc comparaison des traitements, entre l’efficace des psychothérapies.
Problème de la rémission spontanée. Ce que tend à montrer Grünbaum est que le temps de la concordance est la
meilleure défense de la psychanalyse en terme de validation par les conséquences positives. Mais, il est de
validation par les conséquences positives, et même tout à fait problématique, qu’il est douteux que ça suffise à
établir la vérité des thèses psychanalytiques.
Rappel : Argument de Popper revient à l’idée le concept analytique est tellement lâche qu’il est réconciliable
avec n’importe quelle situation.
La prochaine fois : la conscience de soi.
1
/
4
100%