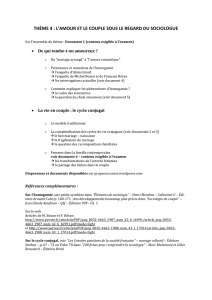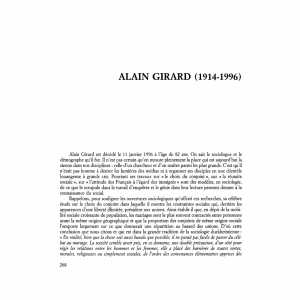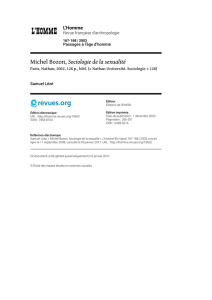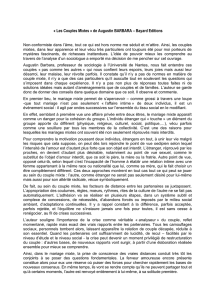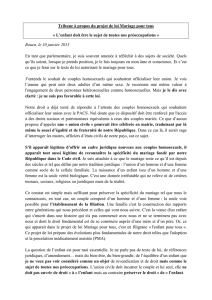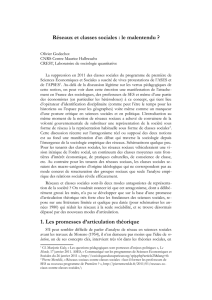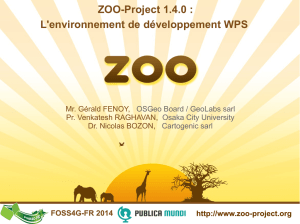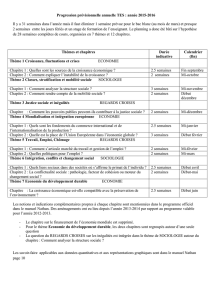Hugo Bouvard. 17/01/2012 Fiche de lecture de l`ouvrage : Michel

Hugo Bouvard. 17/01/2012
Fiche de lecture de l’ouvrage : Michel Bozon, François Héran, La formation du couple. Textes essentiels
pour la sociologie de la famille, La Découverte, coll. « Grands Repères », 2006, 267 p.
____________________________________________________________________________________________________________
Si la sociologie s’attache à expliquer les comportements des agents sociaux en public, au
travail, au sein d’institutions, elle s’est aussi attelée à rendre compte de leurs comportements dans
les pans plus intimes de leur existence. Ainsi, la sociologie de la famille, à la suite de l’anthropologie,
s’est intéressée aux relations de parentés, aux recompositions familiales, etc. C’est bien dans cette
optique, mais en allant un cran plu loin, que Michel Bozon et François Héran s’inscrivent en
coécrivant La formation du couple : c’est sur le noyau de la famille, c’est à dire le couple, que leurs
analyses se concentrent, et plus précisément sur les moments de cristallisation de ce noyau, la
rencontre, puis la mise en couple. Quels sont les déterminants sociaux qui y président ? Qui “choisit”
qui et pour quelle raison ? Comment s’institutionnalise ce rapprochement et quelles conséquences
sociales entrainent-ils ? Autant de questions que les différents chapitres traitent, en dessinant de
grandes tendances qui ne négligent pour autant pas l’analyse de détail. Il convient tout d’abord de
s’intéresser à l’économie de l’ouvrage.
En effet, ce volume se distingue en premier lieu par sa composition : si l’introduction et les
différentes présentations de chapitres, ainsi que les questionnaires en annexe, ont été conçus pour le
présent ouvrage, ou sont inédits, les chapitres ont été publiés séparément, sous forme d’articles,
entre 1987 et 1991, principalement, par Michel Bozon, dans la revue Populations (INED). On peut
légitimement s’interroger alors sur la nature de ce conglomérat d’articles, et sur la dimension
fabriquée de l’unité de l’ouvrage. Cette interrogation est levée dès l’introduction. Ainsi, tous ces
articles reposent en fait sur une même enquête, menée entre 1983 et 1984 par les deux auteurs, et
qui fait suite à l’enquête conduite par Alain Girard, pour le compte de l’INED, en 1959 : Le choix du
conjoint. Seuls deux tiers des articles qu’ils ont tirés de cet enquête figurent dans La formation du
couple.
Après avoir retracé la filiation de l’étude de Girard dans le contexte universitaire de l’époque, Bozon
et Héran battent en brèche l’idée du caractère monopolistique d’un ancrage disciplinaire de type
“sociologie de la famille” dans leur propre enquête : ils l’inscrivent plutôt dans la tradition des
travaux de sociologie de la sociabilité, voire du travail (dressant le parallèle entre le “recrutement”
du conjoint et le recrutement salarial). Ils prennent également leurs distances avec la sociologie
historique, malgré les affinités évidentes de leur travail avec celle-ci, dans le chapitre 1, en raillant la
recherche d’une “rupture” ou d’une “inflexion” dans l’évolution des modes de rencontre.

Chaque chapitre est ouvert par une présentation inédite, de quelques paragraphes, dans lequel les
auteurs mettent en perspective l’héritage de l’article, ce qu’il a apporté et les points sur lesquels il
était évasif. Ainsi, l’écart de ton entre l’introduction de l’ouvrage, paru en 2006, et le texte des
chapitres est perçu par les auteurs.
Les trois premiers chapitres montrent avec brio comment s’effectue le processus de mise en couple,
depuis la “découverte du conjoint”, allant jusqu’à s’attacher à l’influence des caractéristiques
physiques (corpulence, âge, etc.) dans l’appariement. Les deux chapitres suivants délaissent les
“cohabitants” (ainsi sont nommés les couples non mariés) pour établir une sociologie du rituel du
mariage et les mobilités qui lui affèrent. Enfin, les questionnaires en annexe nous sont retranscrits, et
surtout commentés, ce qui ajoutent à la pertinence de ce choix éditorial.
Après avoir montré en quoi la référence à Girard et à son enquête imprègne durablement la
démarche des auteurs, sans pour autant réduire leur filiation théorique à ce seul confrère, nous
essayerons de dégager les principaux apports de chacun des chapitres, en portant une attention
toute particulière aux types de raisonnement engagés, afin de porter un regard critique sur certains
des choix méthodologiques et théoriques de Bozon et Héran.
L’enquête d’Alain Girard est le terminus a quo auquel se réfèrent Bozon et Héran
systématiquement tout au long de l’article : à la fois modèle et repoussoir, l’ouvrage d’Alain Girard
est continuellement cité, critiqué, et les deux auteurs semblent ne se situer, sinon essentiellement, du
moins principalement par rapport à lui. C’est pour cela que nous nous attardons longuement sur
l’introduction, essentielle pour comprendre le positionnement méthodologique et théorique de
Bozon et Héran.
Ils se livrent à une analyse critique du Choix du conjoint (1964) et dégagent des idées-forces
concernant ce qu’il appelle la “philosophie” de Girard :
Si cela ne tenait qu’aux individus, le choix du conjoint serait libre (inspiration libérale), mais ce n’est
pas le cas, en raison des ‹‹ circonstances extérieures ›› (la distance géographique, sociale…) ce que
vient appuyer la pression de normes sociales implicites ou explicites. Héran et Bozon mettent en
lumière le fait que pour éviter de donner une trop grande place au déterminisme sociologique,
Girard en accorde une non moins grande au ‹‹ hasard ››, sans s’interroger sur les déterminants
sociaux de celui-ci, et sans se demander si cette référence n’est pas davantage une interprétation du
sociologue qu’une information donnée par l’enquêté.
Leur filiation/opposition à Girard s’exprime également par leur volonté affichée de ‹‹ rendre la
priorité au travail de terrain ››. En effet, ils affirment leur intention d’administrer eux-mêmes les

questionnaires, et de rencontrer et de former les enquêteurs auxquels ils ne délègueraient pas le
travail, mais qu’ils associeraient à celui-ci. Ils insistent également sur le fait que des enquêtrices ont
été recrutées. Cette précision prend sens dans la mesure où leur détermination à étudier dès le
départ les différences entre hommes et femmes, y compris du point de vue des représentations
mutuelles, est affirmée. Ainsi, ils écrivent que ‹‹ la formation des couples reste toujours porteuse d’un
enjeu social plus important pour les femmes ››, chez qui la “force de rappel” (Claude Thélot) des
origines joue à plein.
S’ils justifient d’entrée la nécessité de mener une nouvelle enquête par le fait que celle de Girard ne
prenait pas en compte les couples non mariés, ils récusent d’emblée l’idée selon laquelle la
cohabitation prénuptiale changerait fondamentalement la donne : elle préoccupait les sociologues
conservateurs, mais Bozon et Héran estiment que l’ “homogamie sociale” n’en a pas été affectée. Pour
autant, elle a selon eux une influence importante dans les changements que connait le rituel du
mariage. Un autre de leurs choix méthodologiques est de n’enquêter que sur les couples âgés de
moins de 45 ans, afin de toucher un autre échantillon que celui de Girard.
L’autre patronage sous lequel ils se placent est celui de Pierre Bourdieu, à qui ils rendent
hommage en introduction, et dont il vont utiliser les concepts (habitus dans le chapitre 1, objets
symboliques dans le chapitre 2) dans leur analyse des déterminants sociaux des unions. Il ne faut pas
non plus sous-estimer l’influence philosophique, notamment kantienne, dans leurs schèmes de
pensée : ainsi parlent-ils de ‹‹ jugements synthétiques spontanés ››, au chapitre deux. Leur parcours
universitaire (normaliens, agrégés de philo, confer Bourdieu), n’y est sans doute pas étranger.
En exergue du premier chapitre sont placés parallèlement une citation de Marcel Proust, dans
Albertine disparue, et un témoignage d’un anonyme commerçant, tous deux au sujet de l’unicité de
l’être aimé : Bozon et Héran veulent-ils signifier la justesse du “sens commun” sur la dimension
chimérique du concept d’âme sœur ? Ce parallèle introduit plutôt de façon habile le sentiment que
l’identité de la personne avec qui l’on va se mettre en couple est imprévisible, mais qu’en même
temps, il n’y a point de “hasard”. Ce sont bien les caractéristiques sociales des membres des couples
que les auteurs s’attachent ici à rapprocher, à comparer.
Et c’est bien là que Bozon et Héran se révèlent être les plus convaincants : lorsqu’ils s’attaquent aux
concepts indigènes de “hasard” et de “coup de foudre”, ils montrent à quel point les déterminismes
sociaux sont profondément impliqués dans la perception de ces phénomènes. Ils battent également
en brèche l’idée commune selon laquelle on se marierait volontiers avec les personnes qui ont un
domicile proche du nôtre : au contraire, ils insistent sur l’importance des renouvellements (vacances,
rentrée scolaire) dans la mise en couple, grâce à ce ces moments de ‹‹ parenthèse sociale ›› qui

permettent une ‹‹ rotation des publics ››. De plus, leur prise en compte de la ventilation des
rencontres en fonction des saisons est une nouvelle fois un signe de leur attention extrême à tous les
facteurs qui pourraient influer sur la formation du couple.
Ils s’inscrivent dans une perspective économiste en insistant sur la différence de ‹‹ rendement
matrimonial ›› des différents lieux de rencontre : ces analyses leur permettent de souligner
l’importance majeure de la danse (bal, discothèques, rallyes mondains) dans l’appariement, prétexte
à une véritable hypotypose, qui, si elle égaie la lecture, pourrait se voir reprocher de diluer l’analyse.
D’autres “arrêts sur image”, surtout dans le chapitre 2, ponctuent l’exposé des résultats : ainsi un
tableau et une analyse au titre semi provocateur ‹‹ les lunettes donnent-elles l’air intelligent ? ›› (p.
111) exploitent de façon fructueuse la minutie du questionnaire, et le paragraphe au sujet de la barbe
et de la moustache montrent que ce ne sont pas des “détails”, en terme de jugements esthétiques (et
donc sociaux).
Dans le premier chapitre, mais c’est vrai pour l’ensemble de l’ouvrage, il faut cependant leur savoir
gré de ne pas chercher la surinterprétation, et d’être conscients de leurs limites, évitant de faire de ce
postulat une simple posture rhétorique.
Le second chapitre traite de la différenciation sociale des goûts, du jeu de regards croisés, et genrés,
des conjoints, et la référence au titre de l’ouvrage de Jean-Claude Kaufmann, Corps de femmes,
Regards d’hommes
1
est éloquente de ce point de vue. Le classement social n’échappe en effet pas aux
jugements amoureux, comme le montrent Bozon et Héran de façon convaincante dans ce chapitre. Ils
mettent également au jour l’intériorisation des normes de féminité et de masculinité par les
enquêtés, les hommes exprimant plus facilement leurs préférences car l’idée que l’on peut agir sur sa
silhouette s’applique davantage aux femmes qu’à ceux-ci. Ils ne sous-estiment pas le côté
“dichotomisant” du jeu des stéréotypes (l’opposition brune/blonde masque le fait que 40% des
personnes interrogées ‹‹ ont des cheveux châtains, soit une teinte intermédiaire ›› p. 103). Ainsi, les
yeux bleus seraient un idéal pour les hommes, associés à la blondeur des cheveux, encore plus
importantes. Les femmes, elles, rêveraient d’hommes bruns à qui elles associent ‹‹ une idée de
maturité, de virilité, et même de domination ›› (p. 103). Ils montrent comment les femmes anticipent
bien les possibles : celles qui rêvent d’hommes grands et minces se retrouvent être les mêmes dont la
chance d’épouser de tels hommes est la plus grande, c’est à dire les cadres, intermédiaires, et
employées de bureau. Ainsi, le réalisme social des femmes qui interprètent l’apparence des hommes
comme un indicateur de leur statut social est mis en lumière.
1
Kaufmann, J.-C., Corps de femmes, regards d'hommes. Sociologie des seins nus, Éditions Nathan, Paris,
1995

L’on peut néanmoins reprocher à l’article-chapitre, et peut-être est-ce le manque de place qu’il faut
blâmer, certains raccourcis tels que : ‹‹ à la blondeur est traditionnellement associée une image de
féminité et de personnalité modérée et sans excès ›› (p. 103) fait par exemple l’objet d’une assertion
décontextualisée. De même, certaines catégories ne sont pas questionnées : ainsi de la dichotomie
cheveux courts/cheveux longs, que Bozon et Héran n’estiment pas nécessaire de ventiler selon
l’époque et le milieu social (un ouvrier et un militaire auront-ils nécessairement la même conception
du volume capillaire d’un ‹‹ homme aux cheveux longs ›› ?). Ce manque de rigueur est également
décelable dans certaines formulations généralisantes : ‹‹ à toutes les époques et dans toutes les
cultures (…) la femme est presque toujours la cadette ›› (p. 125), assertion qu’aucune étude ou
référence ne vient étayer dans l’économie de l’article. Néanmoins, la nuance est toujours de mise
lorsqu’il s’agit d’accorder à des qualités présumées à des caractéristiques physiques : si la blondeur
des femmes est associée à l’idée de douceur et de soumission, elle est aussi un support de fantasme
sexuel en tant qu’objet symbolique idéal (p. 116). Il n’y a donc pas de hiérarchisation simple des
stéréotypes.
Les paradoxes ne sont ainsi pas passés sous silence : si les femmes portent davantage attention à la
tenue vestimentaire des hommes que l’inverse, elles accordent moins d’importance ‹‹ en théorie et
en pratique ›› à l’attirance physique pour le partenaire. La ventilation sociale des réponses aux
questions sur le physique est analysée : les agricultrices et les ouvrières, par exemple, répondent
moins à la question portant sur “le conjoint idéal”. Cela ne signifie pas qu’elles sont indifférentes à
l’apparence physique, mais cela révèle leur acceptation des ‹‹ aléas et milites du marché matrimonial
›› (p. 108). Elles-mêmes sont moins marquées physiquement par leur appartenance sociale : les
auteurs observent une ‹‹ relative neutralité des corps féminins à 20 ans ››.
En fin de chapitre, les auteurs s’intéressent aux catégories du jugement amoureux. Parmi les adjectifs
cités par les enquêtées, certains sont en effet inséparables de leur dimension sociale, comme
“sérieux” et “sécurisant” : pour une femme, le sérieux signifie que l’homme a un emploi stable, alors
qu’inversement, l’homme y voit un gage de moralité ‹‹ qui préfigure une vertu domestique ›› (p. 164).
Le troisième chapitre s’intéresse à l’écart d’âge entre les conjoints, et s’interroge sur la dimension de
consentement d’une telle domination. Selon Bozon et Héran, la théorie de l’échange des capitaux
(argent et statut social masculins contre jeunesse et physique féminins) n’est pas suffisamment
heuristique. Ils s’interrogent sur les préférences intériorisées, notamment en terme d’âge : en
gardant à l’esprit les différences entre mariage et cohabitation (pp. 132-133), ils montrent comment
l’écart d’âge, en faveur de l’homme, est encore plus marqué lors de la deuxième ‹‹ mise en couple ››,
que lors de la première, notamment dans les cas de remariage.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%