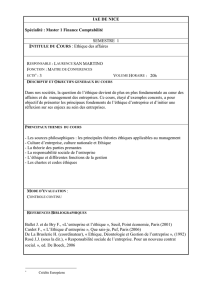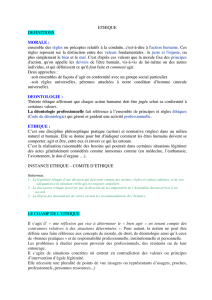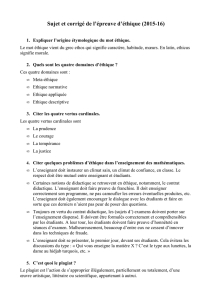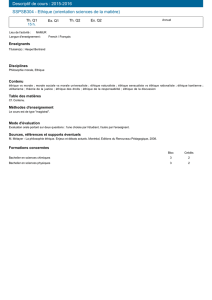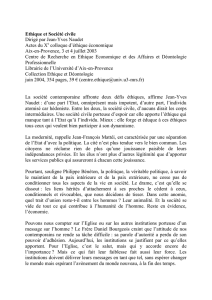Ethique et Responsabilité professionnelle - Cergors

ARNAUD PELLISSIER-TANON
1
Ethique et Responsabilité professionnelle ?
2
Article paru dans la
Revue française de gestion
n° spécial « De nouvelles règles pour l’entreprise »
n° 136 – Novembre-Décembre 2001, pp 109-115
*
Dans la société contemporaine, l'exigence "éthique" qui pèse sur les entreprises prend un tour
paradoxal : alors que le consensus sur les devoirs que chacun doit accomplir se dissout peu à peu,
comment penser qu'elles puissent compatir aux souffrances de leurs parties prenantes sans
hypocrisie ? Aussi les dirigeants d'entreprises sont ils en quête d'une éthique qui leur permettent de
concilier efficacité et légitimité. Ils recherchent précisément la règle dont le respect conduira les
membres de leur personnel à proportionner la vivacité de leurs désirs aux nécessités de l'action qu'ils
mènent, sous leur égide, collectivement. Le principe juridique de la responsabilité civile
professionnelle indique sans doute la voie à suivre lorsqu'il exige des justiciables réparation des
dommages qu'ils n'ont pas sus éviter : loin de promulguer les valeurs de leurs choix ou de se
défausser de leurs propres responsabilités, les dirigeants joueront du professionnalisme que les
membres de leurs entreprises revendiquent pour les inciter à passer au crible leurs propres valeurs et
examiner leur comportement au travers de leurs conséquences ; en bref, ils feront appel à leur soif de
responsabilité.
Rien de l'action humaine n'échappant à son emprise, l'éthique se veut une
règle pour l'entreprise. Elle rencontre pourtant une opposition qui semble tenir à la
nature même des choses : sans appas du gain ni goût du pouvoir, qui assumerait les
veilles et les fatigues nécessaires à la bonne marche de nos entreprises ? Dans un tel
contexte, d'aucuns se demandent s'il est possible de mettre sa pratique professionnelle
en harmonie avec les exigences de sa conscience et les valeurs de notre société.
D'aucuns se demandent si les entreprises peuvent vraiment adopter une attitude
socialement responsable, notamment compatir aux malheurs des plus faibles de leurs
parties prenantes, tant interne qu'externe. Pour eux, l'éthique s'oppose aux affaires
comme la candeur au cynisme si bien qu'ils craignent que les démarches éthiques mises
en oeuvre par les entreprises relève d'un souci quelque peu hypocrite : on flatterait les
exigences sociétales pour mieux donner un verni de légitimité au souci d'efficacité qui
seul prévaudrait dans les affaires.
1
Maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Cergor, mène des recherches sur le
professionnalisme, notamment l'influence des pratiques courantes de management des entreprises sur le
professionnalisme de leurs salariés.
2
L'auteur remercie les Professeurs Laurent Bibard et Raymond-Alain Thiétart et Messieurs Renaud Müller et
Renaud de Rochebrune, sans qui cet article n'aurait pas vu le jour. Il revendique l'entière responsabilité de sa
thèse.

2
Un tel pessimisme n'est pas pour nous satisfaire : pourquoi opposer des
valeurs, qu'on suppose évidentes, à des désirs, qu'on suppose source de violence ? Bien
au contraire, et de tout temps, les moralistes ont souligné que les valeurs ne s'opposent
pas aux désirs mais que chacun valorise le bonheur que lui procure la satisfaction des
désirs qui l'animent : les différentes éthiques hiérarchisent les différents bonheurs
possibles de façon à aider chacun à ne pas se tromper sur la valeur de ses désirs.
Mieux : elles invitent chacun à examiner sa conduite, notamment à vérifier s'il tire bien
de la satisfaction de ses désirs le bonheur qu'il en attend. En bref, elles apprennent à ne
s'engager dans ses entreprises qu'en proportion des véritables enjeux de sa vie. Et
comme satisfaire mutuellement ses désirs n'a, en soi, rien d'immoral, ni servir
mutuellement ses intérêts, l'entreprise et, d'une façon générale, toutes formes
d'organisation ont non plus, en elles-mêmes, rien d'immoral.
Le fait est que la morale, qui faisait il y a encore une génération le ciment de
notre société, s'effrite manifestement et le choc des cultures consécutif à la
mondialisation relativise la portée qu'elle pourrait conserver. Parallèlement, la
médiatisation des émotions avive la pression de l'opinion publique et l'entreprise se
voit, de plus en plus, sommée de répondre de son comportement. Les entreprises sont
donc, plus que jamais, prises entre deux feux, d'une part, les insuffisances de leurs
mandants et, d'autre part, les exigences de leurs parties prenantes -c'est là peut-être la
signification véritable de l'hypocrisie apparente de leurs démarches éthiques-. Aussi
leurs dirigeants se demandent-ils, aujourd'hui, plus que jamais, comment mobiliser les
uns et satisfaire les autres. Il s'agit, pour eux, de formuler, à nouveau frais, une éthique
qui satisfasse, dans la mesure du besoin, et l'exigence d'efficacité, qui demeure de
rigueur dans les affaires, et celle de légitimité, que personne ne saurait éluder sans se
mettre au ban de la société.
Les dirigeants recherchent précisément la règle dont le respect conduira les
membres de leurs entreprises à proportionner la vivacité de leurs désirs aux nécessités
de l'action qu'ils mènent, sous leur égide, collectivement. Le principe juridique de la
responsabilité civile professionnelle indique, nous semble-t-il, une voie à suivre
lorsqu'il exige des justiciables réparation des dommages qu'ils n'ont pas sus éviter : loin
de promulguer les valeurs de leurs choix ou de se défausser de leurs propres
responsabilités, les dirigeants joueront du professionnalisme que les membres de leurs
entreprises revendiquent pour les inciter à passer au crible leurs propres valeurs et
examiner leur comportement au travers de leurs conséquences ; en bref, ils feront appel
à leur soif de responsabilité.
Mettre en oeuvre une démarche éthique
Il est tentant, pour les dirigeants, de proclamer des valeurs en harmonie avec
les exigences que la société fait peser sur leur entreprise et d'y insuffler cette
"éthique" : la rédaction participative d'une charte ou, si leur responsabilité risque d'être
mise en cause devant les tribunaux, la promulgation d'un code rendu exécutoire par
leur pouvoir de discipline, rehausserait la moralité de leur personnel. Et il leur resterait
à témoigner d'une conduite exemplaire pour que ces valeurs ne restent pas lettres

3
mortes ni que leur proclamation génère les comportements hypocrites que nous avons
évoqués. Une telle démarche, si elle est réellement participative, présente, en effet,
l'avantage de "rendre explicite la forme sociale contractuelle de l'entreprise" (p. 89),
comme Jean-Gustave Padioleau (1989) s'en réjouit, d'une manière générale, pour "la
morale des affaires" : résultant de l'arrangement réciproque des acteurs, l'entreprise et
son éthique reposent sur l'engagement qu'ils prennent, après négociation et
délibération, de respecter les valeurs qui rendront leurs décisions légitimes. Et Jean-
Gustave Padioleau (1989) de définir la morale des affaires comme l'ensemble "des
règles définissant les rapports perçus comme efficaces et légitimes entre les partenaires
immédiats ou éloignés d'une interaction marchande ou gestionnaire" (p. 86).
Comme toute contrainte, la morale des affaires donne aux entreprises de
nouvelles occasions d'agir. En effet, cette morale ne s'impose pas tant aux entreprise
qu'elle ne leur est utile : elle donne une légitimité aux rapports qu'elles entretiennent
avec leurs parties prenantes, autrement dit, elle les habilite à les entretenir, si bien que
c'est en posant des actes légitimes qu'une entreprise agit efficacement ou, en d'autres
termes, compatir à l'infortune du monde est une bonne façon de faire des affaires,
comme en témoignent la médiatisation du commerce équitable et le développement des
fonds éthiques. A ce niveau d'analyse, purement sociologique, la morale des affaires ne
diffère pas du consensus qui fixe les rapports, tenus pour légitimes et efficaces, que
l'entreprise entretient avec ses parties prenantes. Les dirigeants y trouveront, certes,
une règle conduisant les membres de leurs entreprises à proportionner la vivacité de
leurs désirs aux nécessités de l'action qu'ils mènent ensemble. Mais cette règle, de par
sa nature consensuelle, n'a rien de stable ni de définitif et ils peuvent souhaiter lui
donner des fondements plus assurés, au minimum mettre en lumière la hiérarchie des
bonheurs déterminant la valeur des désirs que chacun satisfait, dans l'entreprise,
lorsqu'il entretient une relation marchande ou gestionnaire.
Pour ce faire, il faut dépasser le constat sociologique des valeurs d'efficacité
et de légitimité dominantes dans notre société et chercher à les fonder en philosophie.
C'est ce que fait Jean Moussé (1992) lorsque, pour répondre à Jean-Gustave Padioleau,
il définit l'éthique d'entreprise comme un "chemin" : l'homme se donnant librement ses
raisons d'agir, "il devient nécessaire, à partir de l'expérience des affaires, d'élaborer des
conceptions susceptibles d'éclairer [ses] décisions" (p. 66). Reste à savoir comment élaborer
de telles conceptions à partir de l'expérience. Il constate qu' "un chef d'entreprise est certes
responsable pour ce qu'il décide de ses propres affaires, mais [qu'] il est aussi
responsable, pour sa part, des lointaines conséquences de ses actes." Il relève qu' "une
telle exigence n'est pas étrangère à la sociologie en ce sens qu'on peut en comprendre
la signification en étudiant le fonctionnement des affaires. Il y a peu de chances
toutefois qu'elle apparaisse clairement à travers des enquêtes et des sondages." Et il
conclut aussitôt que la philosophie, en général, et l'éthique des affaires, en particulier,
"consiste en une réflexion critique (...) s'appuyant sur l'expérience" (p. 63). Reste à
savoir en quoi consiste cette réflexion critique et quelle part le chef d'entreprise peut y
prendre.
Tout corps de valeurs ou toute hiérarchie des bonheurs devient une morale
si un consensus se dégage en sa faveur dans tel ou tel groupe humain. Mais cette

4
morale peut être vécue comme une éthique, par chacun des membres de ce groupe,
dans la mesure où la légitimité des valeurs qu'elle promulgue ne découle pas du
consensus qu'elles reçoivent mais du bien fondé de la hiérarchie des bonheurs en
laquelle elle consiste : c'est cette hiérarchie qui fonde le primat de telle valeur sur telle
autre, que cette morale consacre, partant la légitimité de telle interaction marchande ou
gestionnaire, qui fait prévaloir telle valeur sur telle autre. En d'autres termes, ce n'est
pas pour suivre le consensus mais parce qu'on est convaincu du bien fondé de telle
éthique qu'on régule ses désirs en fonction des bonheurs dont elle indique la valeur. La
règle éthique diffère ainsi de l'exigence sociologique de respecter les valeurs faisant
l'objet d'un consensus. Elle consiste en la discipline intérieure de ne se permettre de
satisfaire ses désirs que dans la proportion du bonheur qu'on attend de la vie : c'est
sincèrement alors que chacun, dans l'entreprise, règle son engagement professionnel
sur la valeur des bonheurs que lui-même et ses parties prenantes retirent de son
activité.
Faire jouer un levier d'éthique
Si donc chaque éthique consiste en une hiérarchie des bonheurs, toute
démarche éthique se résume en la discipline qui mesure la satisfaction de ses désirs à
cette hiérarchie, si bien que la hiérarchie des bonheurs que chacun se donne est la règle
de l'éthique que chacun pratique. Les dirigeants soucieux d'éviter à leur entreprise de
sombrer dans une quelconque hypocrisie se garderont donc de promulguer le respect
de valeurs quelconques, même les plus consensuelles. Ils se garderont, précisément, de
fixer aux membres de leurs entreprises une hiérarchie des bonheurs, mais renverront
chacun d'entre eux, en un effort de sincérité, à ses propres valeurs, à sa propre
hiérarchie des bonheurs. Renvoyer chacun à ses valeurs ou à sa hiérarchie des
bonheurs, ce n'est pas sombrer dans un subjectivisme moral qui ne trouverait de
solution que dans un consensus fluctuant au gré des circonstances. C'est dépasser les
consensus prévalant dans notre société et mettre à l'épreuve les convictions de nos
contemporains. C'est s'appuyer sur la réalité des bonheurs et de leur hiérarchie sans
laquelle toute éthique se fige en un discours idéologique et toute exigence sociologique
se crispe en un totalitarisme "éthique".
Les dirigeants en quête d'une éthique pour leur entreprise interrogeront donc
les membres de leur personnel sur le respect des valeurs dont ils témoignent, in fine sur
la règle que leurs hiérarchies des bonheurs donnent à la satisfaction de leurs désirs -ce
respect, cette règle apportent-elles bien le bonheur que chacun d'entre eux attend, ainsi
que leurs parties prenantes, de son engagement dans l'entreprise ?-. La tâche est
d'autant plus ardue que le sens même des termes de cette question sont en train de se
perdre. Le mot bonheur semble désuet. Qui l'entend encore comme le sentiment de
plénitude qui accompagne l'achèvement ou la perfection de tout acte, aussi bien celui
des sens -on parle aujourd'hui de plaisir-, que de l'action elle-même -on parlera
précisément de bonheur- ? Aristote explicite ce point dans l'Ethique à Nicomaque
lorsque, discutant de l'origine du plaisir des sens, il constate que "l'acte le meilleur est

5
celui du sens le mieux disposé par rapport au plus excellent de ses objets ; et l'acte
répondant à ses conditions ne saurait être que le plus parfait comme le plus agréable".
Il élargit aussitôt cette analyse en relevant que "pour chacun des sens il y a un plaisir
qui lui correspond, et il en est de même pour la pensée discursive et la contemplation"
(1974 b 20). Et Aristote de relever que "le plaisir achève l'acte comme une sorte de fin
survenue par surcroît" (1974 b 35). Le plaisir, le bonheur recouvrent donc le sentiment
de plénitude qui marque l'achèvement de l'action.
Les valeurs sont de moins en moins perçues en terme d'accomplissement de
soi mais de plus en plus en terme de jouissance de la vie : liberté, égalité, fraternité, par
exemple, ne signifient plus l'immunité de contrainte, l'absence de privilège et l'unité du
corps politique chers au XVIIIe siècle mais désormais les moyens de vivre,
l'égalisation des avoirs et le partage des ressources auxquels aspirent nos
contemporains. Il semble ainsi que cette évolution des valeurs consacre un déclin du
droit mais non de la législation, pour reprendre la formule chère à Friedrich Hayek
(1959/1994 et 1976/1982) : les obligations sont de moins en moins conçues comme les
précautions à prendre pour ne pas nuire à autrui, tel que la pratique judiciaire les
dégage de l'expérience de la vie en commun, mais, de plus en plus, comme les
contributions ou les prestations à offrir à des ayant droits, qu'un pouvoir apte à en
sanctionner l'inexécution impose à ses ressortissants.
On pourrait croire que cette évolution s'est accompagnée d'un affinement de
la conscience morale des hommes d'entreprise : ils compatiraient de plus en plus aux
souffrances de leurs parties prenantes. Il semble plutôt que la société habilite de plus
en plus les clients à exiger de leurs fournisseurs des produits sans risque et des
prestations sans faille : le déclin du droit que nous avons relevé s'accompagne d'une
judiciarisation de la société, précisément d'une mise en oeuvre de plus en plus
fréquente de la responsabilité civile professionnelle. C'est que, comme l'a relevé Max
Weber (1919/1959/1963/1997), "nous savons ou nous croyons qu'à chaque instant nous
pourrions, pourvu seulement que nous le voulions, nous prouver qu'il n'existe en
principe aucune puissance mystérieuse et imprévisible qui interfère dans le cours de la
vie ; bref que nous pouvons maîtriser toute chose par la prévision" (p. 90). Partant, il
semble inadmissible qu'un produit présente un risque quelconque ou qu'une prestation
ne procure pas le service attendu.
Ce savoir ou cette foi en la maîtrise du monde imprègne, semble-t-il, les
morales contemporaines et Hans Jonas (1979/1990/1998) en a explicité l'éthique dans
son Principe responsabilité : de la disproportion du pouvoir dont l'homme s'est doté de
contrôler "le destin et la nature" (p. 241) d'avec sa fragilité, pour ne pas dire son
caractère vulnérable, découle l'obligation de "préserver pour l'homme l'intégrité de son
monde et de son essence" (p. 18). La faillite des utopies a fait pâlir la figure de
l'ingénieur social qui, imbu de sa science, se faisait fort d'organiser la société. S'y
substitue celle du professionnel qui, par sa prévision, maîtrise son monde et livre à ses
clients des produits sans risque ou leur sert des prestations sans faille : il s'en porte
garant et en assume la responsabilité. Aussi prétend-il en répondre, si bien que
l'entreprise en quête d'éthique peut sans doute jouer de cet état d'esprit pour interroger
ses membres sur leurs valeurs et leurs hiérarchies des bonheurs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%