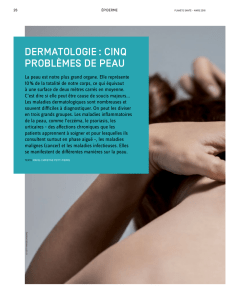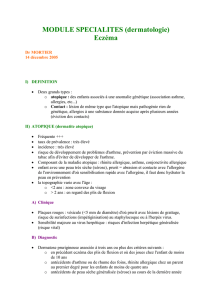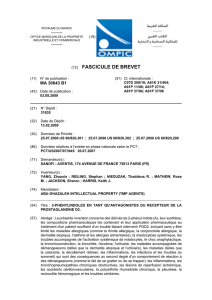Chapitre XI Maladies cutanées allergiques : urticaires, eczémas

Chapitre XI
Maladies cutanées allergiques : urticaires, eczémas, prurigos
Les urticaires
Les urticaires sont produites tant par mécanismes allergiques que par des
mécanismes non allergiques, ce qui est d’ailleurs plus fréquent, mais elles ont en
commun l’aspect relativement uniforme de l’éruption clinique sous la forme de plaques
d’urticaire (voir la sémiologie cutanée) et le facteur pathogénétique commun, la libération
d’histamine des mastocytes dermiques. Le nom provient du latin urtica, ortie, la plaque
de l’urticaire étant analogue à l’éruption qui apparaît après la piqûre de l’ortie, à la
différence qu’elle est prurigineuse et non pas douloureuse.
Etiopathogénie
Environ 20% des urticaires sont produites par un mécanisme allergique, et le reste
de 80% sont non allergiques.
Dans le cas des urticaires allergiques intervient l’un des mécanismes suivants :
-la réaction d’hypersensibilité de type I (anaphylactique) entraînée par les IgE
fixées avec le bout Fc sur les mastocytes. Les allergènes reconnus par le bout Fab
peuvent être des allergènes inhalés, des allergènes alimentaires, médicamenteux,
parasitaires, rarement viraux ou bactériens. La fixation de l’un de ces allergènes sur le
bout Fab de la IgE induit le signal de dégranulation du mastocyte avec libération
d’histamine, sérotonine, héparine, diverses quinines pro inflammatoires, le rôle de base
étant celui de l’histamine dans la production d’une réaction inflammatoire aiguë avec
vasodilatation, la croissance de la perméabilité capillaire et l’œdème.
-la réaction d’hypersensibilité de type III par des complexes immuns circulantes
qui activent le complément avec la production de grandes quantités de fractions C3a et
C5a, appelées anaphylatoxines grâce à leur capacité d’induire directement la libération
d’histamine mastocytaire.
Dans le cas des urticaires non allergiques peuvent intervenir plusieurs facteurs.
Ainsi dans la plupart des cas, il s’agit de substances directement libératrices d’histamine
comme : le iode de tous les produits radiologiques de contraste iodés, certains
médicaments (la morphine et les morphinoïdes, la codéine, la vitamine B1, la
vancomycine, l’aspirine, l’atropine, la papavérine etc.), des venins d’insectes, des
produits alimentaires marins (crustacées, fruits de mer etc), tous les fruits rouges des bois
(framboises, fraises, etc) et probablement d’autres pas encore identifiés.
Dans le cas des urticaires « physiques » (au froid, à la chaleur, à la pression aux
vibrations) intervient plus probablement l’acétylcholine (il paraît que ces malades ont un
relatif déficit de cholinestérase tissulaire), qui favorise la libération d’histamine
mastocytaire.
Dans le cas de l’œdème Quincke héréditaire (qui peut associer également des
plaques d’urticaire) intervient un déficit congénital de l’inhibiteur de C1 – estérase qui ne
freine plus l’activation apparemment spontanée du complément.

Manifestations cliniques
L’éruption de n’importe quel type d’urticaire est relativement uniforme : une
plaque érythémateuse nettement délimitée, avec le centre temporairement blanc (par la
vasoconstriction mécanique due à l’œdème brusquement constitué), installée rapidement,
prurigineuse et qui persiste à partir de quelques minutes jusqu’à quelques heures (on
accepte un maximum de 24 heures pour les urticaires proprement dites). Le nombre des
plaques peut varier de quelques unes a des centaines, plus ou moins disséminées sur le
corps. Selon la dimension des plaques, on décrit des formes d’urticaire pseudopapuleuse
(des plaques petites de la dimension des papules) ou l’urticaire gigantesque avec des
plaques d’un diamètre de dizaines de centimètres.
Rarement apparaissent des formes d’urticaire bulleuse (avec des bulles séro-
citrines à la surface des plaques) ou hémorragiques (des bulles à contenu hémorragique).
L’éruption de l’urticaire typique en plaques est parfois accompagnée de l’œdème
Quincke, l’équivalent d’une plaque d’urticaire dans laquelle est impliqué le plexus
vasculaire dermique profond avec la constitution de l’œdème inflammatoire à la jonction
dermo-hypodermique. L’œdème Quincke est localisé dans des zones avec du tissu cutané
lâche, respectivement aux lèvres, paupières, langue, pharynx, glotte, la zone génitale et de
manière particulière il n’est pas accompagnée du prurit. L’urgence majeure est constituée
par la localisation glottique qui produit de l’asphyxie mécanique et impose le traitement
d’urgence.
La plus importante classification est celle évolutive : on parle d’urticaire aiguë
dans le cas d’un épisode unique ou avec des récidives qui disparaissent spontanément
avant 6 semaines et d’urticaire chronique dans laquelle les éruptions récidivent après 6
semaines, d’habitude le long des années.
D’habitude l’état général des malades avec urticaire est bon mais dans les formes
étendues peuvent être associés : de la fièvre, céphalée, des arthralgies aux doigts des
mains, éventuellement de la diarrhée.
La complication majeure est représentée par le choc anaphylactique, qui peut être
lui aussi allergique ou non allergique, dans le cas duquel par déversement massif
d’histamine apparaît une vasodilatation cutanée généralisée avec la séquestration du sang
dans les plexus cutanés et choc hypovolémique consécutif. Le malade, avec ou sans
œdème Quincke, devient rapidement érythrodermique, tachycardique et avec TA en
diminution dramatique.
Formes particulières d’urticaire
Les urticaires physiques :
-l’urticaire factice (dermographisme) est une forme d’urticaire à la pression dans
laquelle à l’endroit d’un grattage cutané occasionnel se développent des plaques
d’urticaire linéaires, ayant la forme de la ligne de grattage prurigineuse et qui persiste
environ 1-2 heures ;
-l’urticaire au froid (a frigore) qui peut être congénitale, mais plus fréquemment
elle est due aux cryoglobulines sériques. Comme très fréquemment les cryoglobulines

sont un marqueur indirect de la présence du virus de l’hépatite C (avec hépatite active ou
seulement comme porteur sain) cette forme d’urticaire impose la détermination des
anticorps anti-HCV ;
-l’urticaire solaire est encadrée dans le groupe plus étendu des éruptions
polymorphes à la lumière, mais elle est rare ;
-l’urticaire aquagénique apparaît au contact avec l’eau, même pure, quelle que
soit la température de celle-ci, et elle est également rare ;
-l’urticaire de contact au chaud est possible, mais extrêmement rare ;
-l’urticaire cholinergique est relativement fréquente et apparaît dans les conditions
dans lesquelles la température du corps augmente temporairement (des bains brûlants,
l’effort physique, la fièvre, parfois le stress ).
Explorations de laboratoire dans les urticaires
Dans les urticaires allergiques sont utiles les tests allergologiques du type patch-
test aux allergènes aériens (pollens, poussière de la maison, extrait de Dermatophagoides,
un microacarien commensal dans toutes les habitations humaines), alimentaires (œufs,
viandes, lait), médicamenteux en fonction de l’anamnèse, investigations bactériologiques,
mycologiques et spécialement parasitologiques.
Le traitement dans les urticaires et le choc anaphylactique
Le traitement pathogénétique de base dans toutes les formes d’urticaire est
constitué par les antihistaminiques anti-H1, des médicaments qui bloquent
compétitivement les récepteurs tissulaires H1 d’histamine.
Les antihistaminiques de la première génération ont des effets sédatifs marqués,
car ils transpercent la barrière hémato- encéphalique et agissent sur les récepteurs H1 de
l’encéphale. À cause de l’effet sédatif, ils ne sont pas administrés de manière ambulatoire
chez les chauffeurs, les personnes avec une activité physique complexe ou avec de
l’activité intellectuelle. De tels histaminiques sont : romergane, ciproheptadine,
difenhydramine, nilfane, clorfeniramine, clorfenoxamine, hydroxisine, doxépine. Les
antihistaminiques de la deuxième génération ne transpercent pas la barrière hémato-
encéphalique et ils sont non sédatifs. Ce sont : loratadine, desloratadine, cetirizine,
terfénadine, l’astémizole et l’ébastine. La terfénadine et l’astémizole peuvent provoquer
chez les malades avec des affections cardiaques des troubles de rythme, avec
l’augmentation de l’intervalle QT jusqu’à la « torsade des bouts », risque accru en
association avec kétoconazole, macrolides ou hypopotassémie.
Dans les urticaires aiguës les antihistaminiques sont administrés per os 1-6
semaines, jusqu’à la disparition complète des éruptions. Dans les urticaires chroniques les
traitements de longue durée, de 3-12 mois, peuvent mener à la guérison. Alternativement
on administre des traitements de manière intermittente à l’occasion des récidives. La
corticothérapie générale ou locale n’est pas indiquée.
Dans le cas du choc anaphylactique ou de l’œdème Quincke, particulièrement sa
forme glottique, on administre d’urgence : intramusculaire 2 ml Adrénaline 1 : 1000,
dissolue dans 10 ml sérum physiologique, puis intraveineux 100 mg hémisuccinate de
hydrocortisone toutes les 10 minutes jusqu’à un maximum de 1000 mg, en suivant la

disparition de l’œdème Quincke et respectivement le retour des valeurs TA et une
ampoule intramusculaire d’un antihistaminique injectable (Romergan ou Tavegyl). La
trachéostomie d’urgence est une alternative en cas d’absence de la médication adéquate.
Les eczémas
Les eczémas sont des éruptions cutanées en plaques érythémateuses squameuses
toujours délimitées de manière diffuse, et avec une surface sèche, rugueuse, d’habitude
prurigineuses, et qui peuvent présenter ou non des phases d’aiguisement marquées de
l’apparition de vésicules à leur surface.
Selon leur pathogenèse et leur aspect clinique on distingue quatre grandes
catégories d’eczémas :
-les eczémas de contact : impliquent clairement un mécanisme de sensibilisation
de type IV transmis cellulairement par les lymphocytes T aux allergènes ou aux haptènes
du milieu externe ;
-l’eczéma atopique : apparaît sur un fond génétique prédisposant qui implique des
disfonctionnements de l’appareil immunitaire cellulaire et humoral, avec l’apparition
d’une réponse immunitaire excessive aux allergènes habituels du milieu externe ;
-les eczémas vulgaires : leur mécanisme pathogénétique est inconnu, il est
possible qu’interviennent parfois des sensibilisations aux foyers infectieux chroniques
internes, et d’autres fois une perte transcutanée excessive d’eau ;
-l’eczéma séborrhéique : apparaît sur un terrain séborrhéique prédisposé par la
sensibilisation à une levure saprophyte, Pityrosporon ovale.
L’eczéma (la dermatite) de contact allergique
Fréquemment cet eczéma est de nature professionnelle (l’allergène causal est
l’une des substances du lieu de travail et l’eczéma apparaît en relation directe avec
l’exercice d’une certaine profession), mais il peut être également accidentel, par la
sensibilisation aux allergènes ménagers ou de l’environnement. La liste des allergènes de
contact mis en évidence compte environ 4000 substances diverses et elle est en continue
croissance. Il y a par exemple le caoutchouc synthétique (avec environ 300 sensibilisants),
les matières plastiques, les colorants des matériaux textiles, les résines époxydiques, tous
les détergents ménagers, presque tout produit cosmétique, de nombreux médicaments
d’usage général ou local. Les haptènes jouent également un rôle important et le plus
fréquemment impliqués haptènes sont les ions de chrome, nickel et cobalt (présents dans
le ciment des constructions mais aussi dans de nombreux objets d’usage esthétique
(bracelets, anneaux, boucles d’oreille etc).
L’eczéma de contact, professionnel ou accidentel, est caractérisé par le fait qu’il
apparaît seulement chez certaines personnes qui viennent en contact avec l’allergène
causal, nécessite une période de « latence immunologique » de minimum trois semaines
(mais qui peut arriver jusqu’à plusieurs années), dépasse la zone de contact direct et tend
à s’auto- entretenir même après la disparition de l’agent causal. La sensibilité en cause ne
disparaît plus jamais, de sorte que l’eczéma récidive à toute réexposition ultérieure, toute
tardive qu’elle soit.

L’aspect clinique est celui d’un eczéma vulgaire qui parcourt toutes ses étapes
d’évolution : la phase aiguë avec un placard érythémateux avec des vésicules, la phase
subaiguë avec un placard érythémateux et la formation de squamo-croûtes, la phase
chronique de placard érythémateux diffus, couvert d’un dépôt abondant de squames
sèches, blanches, à plusieurs couches et adhérentes, qui se perdent progressivement dans
le tégument normal d’autour et la phase hyperchronique du lichenification, dans laquelle
le quadrillage physiologique de la peau devient évident à l’œil nu.
Le caractère professionnel d’un eczéma est certifié par des tests épicutanés
positifs, réalisées avec ce qu’on appelle les « batteries d’allergènes professionnels »,
standardisées selon le type de la profession.
L’eczéma (la dermatite) de contact orthoergique
Dans ce cas il ne s’agit pas d’allergisation mais d’une dermatite produite par des
irritants premiers (obligatoires) comme les acides et les bases forts, les sels caustiques ou
les récurrents abrasifs. Comme aspect clinique, il imite parfaitement les phases aiguë,
subaiguë ou chronique de l’eczéma de contact, mais l’éruption apparaît chez toutes les
personnes qui entrent en contact avec l’agent causal (par exemple l’acide sulfurique), elle
apparaît rapidement pendant quelques heures, disparaît pendant quelques jours et est
limitée au lieu du contact direct avec l’agent causal.
Le traitement des eczémas de contact allergiques et orthoergiques consiste dans
l’évitement du contact direct avec l’agent causal et l’application de dermatocorticoïdes de
classe II ou III jusqu’à la disparition de l’éruption.
L’eczéma (la dermatite) séborrhéique
Il est relativement fréquent, (1-3% de la population), atteint les deux sexes, peut
apparaître à tout âge après la puberté, après quoi il récidive de manière chronique
indéfiniment et il a quelques particularités.
Dans l’étiologie sont impliqués la sensibilité à Pityrosporon ovale et le terrain
séborrhéique, ce qui explique sa récurrence hyperchronique : même après la plus efficace
thérapie antimycosique le tégument sera recolonisé avec cette levure saprophyte et
l’eczéma récidivera. Un facteur important d’aggravation est le stress psychique et parfois
les formes extensives et résistantes à la corticothérapie locale apparaissent en corrélation
avec des cancers pulmonaires.
L’eczéma séborrhéique se manifeste par des plaques érythémateuses squameuses,
discrètement prurigineuses à localisation typique : sur le cuir chevelu, sur les sourcils, sur
le front (la zone entre les sourcils), dans les fossés nasolabiaux, dans le conduit auditif
externe et rarement sur le thorax antérieur, où il prend un aspect de plaques rondes « en
médaillon ». À la différence d’autres eczémas, il ne traverse jamais la phase aiguë avec
vésiculation.
Le traitement est en deux phases : d’attaque avec un dermatocorticoïde de
puissance moyenne ou faible pendant une semaine, et le deuxième phase d’entretien avec
un antimycosique topique (Kétoconazole, bifonazole etc) encore trois semaines pour
l’élimination de la levure, de sorte que la période de rémission soit de longue durée.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%