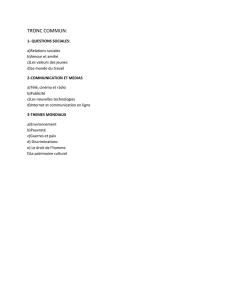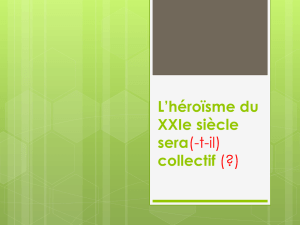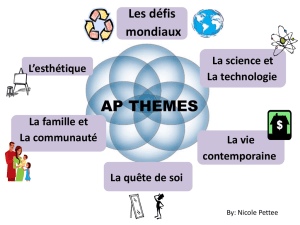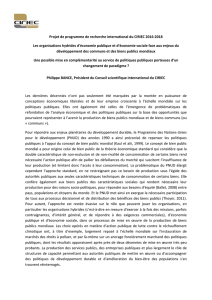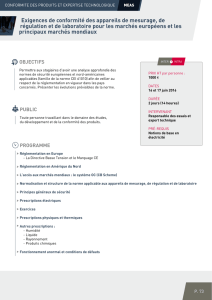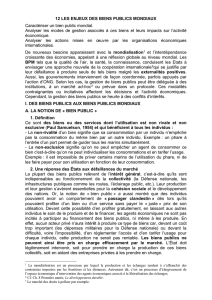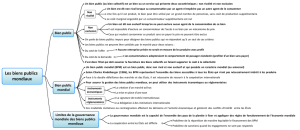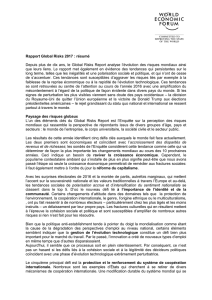Géographie : Les acteurs mondiaux

Géographie : Les acteurs mondiaux
Introduction :
Defarges et Moreau définissent la mondialisation comme « l’ensemble des processus
multipliant les réseaux, les interdépendances entre toutes les parties de la terre, créant
progressivement un espace mondial unifié d’échanges et appelant des réglementations,
des coopérations planétaires » Cette mondialisation n’est pas un processus qui
s’accomplit tout seul mais bien un mouvement mené par des acteurs mondiaux c'est-à-dire
si l’on reprend le texte de GEMDEV : Un acteur qui mène une action construite par un
processus d’interaction des différents acteurs et qui suppose une intentionnalité.
Le développement des échanges et de la communication à l’échelle non plus nationale
mais mondiale a fait apparaître des acteurs mondiaux qui jouent un rôle de plus en plus
important que ce soit sur le plan économique, politique ou culturel. Cet accroissement des
échanges tend vers une multiplication des réseaux qui lient entre eux les acteurs
mondiaux. Cependant, cette organisation du monde en réseaux qui est considéré par J.
Lévy, ……….comme le 3ème modèle du monde semble de plus en plus fortement
transcender par la constitution d’une « société monde" . En effet, les acteurs mondiaux de
par leur importance croissante entraînent le monde et les sociétés vers la définition d’une
nouvelle géographie et d’une nouvelle manière de concevoir l’espace.
Mais l’hétérogénéité de ces acteurs mondiaux les poussent à poursuivre des stratégies
mondiales différentes. On peut donc se demander Qui sont ces acteurs mondiaux ?
Quelles relations entretiennent-ils dans la gestion des enjeux mondiaux ? En quoi
peut-on dire qu’ils entraînent le monde dans une dynamique qui les porte vers la
réalisation du 4ème modèle décrit par Jacques Lévy à savoir la réalisation d’une
société monde ?

Ces 3 questions que nous nous poserons tout au long de cet exposé nous ont conduit à
organiser un plan autour des 3 axes suivants :
Typologie des acteurs
Relations : coopération et confits
Les acteurs ont –ils une intention du monde, le porte-t-il vers une société civile
internationale
I. Qui sont les acteurs ? Typologie
A. Les acteurs mondiaux étatiques en perte de leur souveraineté
Etats
G7-Forum de Davos ?
Les organisations régionales : une solution à la perte de la souveraineté ?
Mercosur
Alena
UE
B. Les acteurs mondiaux : institutions à caractère gouvernemental, du principe de
souveraineté (multilatéralisme) à une légitimité fondée sur le principe de responsabilité
ONU
OMC-FMI-Banque mondiale
Cour pénale internationale

C.Les acteurs mondiaux non institutionnels
Des acteurs économiques apatrides ?
FMN
Les réseaux d’informations et d’influence
médias
Eglises
diaspora
Les acteurs sociaux organisés autour d’enjeux mondiaux
ONG
écologistes et alter mondialistes
II. Des acteurs mondiaux organisés pour répondre à des enjeux mondiaux mais qui
n’ont pas tous les mêmes objectifs
A. Organisation autour d’enjeux communs : la coopération
Les acteurs mondiaux établissent entre eux une coopération de plus en plus exacerbée qui est
rendu nécessaire par la multiplication d’enjeux communs.
Le meilleur exemple de cette coopération est bien sûr la coopération économique qui n’a
cesse de croître depuis les années 1950.
Entre les Etats : s’organisent des coopérations régionales qui tendent à jouer un rôle sur le
plan mondial. On constate comme le souligne Gemdev dans Mondialisation : les mots et les
choses « une tendance à la réunion des Etats dans des ensembles plus vastes » : les acteurs
étatiques se regroupent pour prendre plus de poids à l’échelle du monde.
Ainsi la forme la plus aboutie de cette coopération régionale est l’Union européenne qui
partant d’une collaboration économique (la CEE) a connu une évolution vers une coopération
plus politique. Ainsi chaque Etat abandonne une partie de sa souveraineté en compensation
d’une coopération qui lui permet de représenter un poids à l’échelle internationale. On peut
donc ici apporter une nuance à l’analyse de GEMDEV qui date de 1999 en mettant en exergue
le fait que même si pour lui « il n’existe pas d’espaces politiques à une échelle supérieure de

celle de l’Etat-nation » on tend de plus en plus vers une construction et une collaboration des
acteurs étatiques sur le plan politique pour preuve l’UE tend de plus en plus à prendre des
décisions à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité ce qui romps avec une simple
organisation internationale et manifeste l’effort des gouvernements pour construire un espace
politique et plus seulement économique.
Le fait d’organiser l’espace de telle façon qu’on supprime les barrières douanières entre les
Etats qui coopèrent dans ce type d’organisation à conduit à définir le monde comme un vaste
marché où capitaux et biens circulent parfaitement.
C’est donc une vaste économie de flux qui s’est mis en place rendant nécessaire des
connexions nombreuses entre les acteurs et donc la mise en place des réseaux de transport et
de communication très dense.
CARTE DES FLUX.
Cependant comme nous pouvons le voir sur cette carte tous les acteurs étatiques ne sont pas
des acteurs mondiaux et certains ne pèsent pas grand-chose sur le plan du commerce
international. Mais les prises de décision des grands acteurs mondiaux pris lors des sommets
du G7, dans des instances supra- nationales comme l’OMC, ou en coopération avec des
acteurs non gouvernementaux comme les FMN lors du Forum de Davos ont une influence sur
tous ces pays et établissent une interdépendance des économies. Face à ce mouvement il est
indéniablement nécessaire de coopérer économiquement pour garantir la bonne santé de
l’économie mondiale. Les économies n’étant plus nationales les intérêts des acteurs étatiques
sont globaux et ils sont contraints de prendre en compte l’échelle mondiale lors de la prise de
décision à l’échelle nationale s’ils souhaitent que celle-ci soit une certaine efficacité.
Ex : le problème des délocalisations
Ainsi des instances comme la Banque Mondiale, le FMI et l’OMC veillent au bon
fonctionnement de cette coopération et tentent d’aider au développement des pays les moins
intégrés à cette économie monde. Ils sont d’ailleurs aidés en cela par des ONG collaborant
avec ces organisations institutionnelles autour de projet d’aide au développement
économique.
Ex : commerce équitable
Mais il semble également intéressant de se pencher sur la coopération politique des acteurs
car elle constitue réellement aujourd’hui une donnée essentielle dans la compréhension du
fonctionnement du monde et dans l’analyse des enjeux mondiaux.
En effet, la gestion de ce que J. Lévy nomme les biens communs publics Cad ce qui
« renvoie à l’idée de bien systémique, auquel on ne peut assigner une valeur monétaire
isolable dans la mesure où sa production et /ou sa consommation sont le fait de toute la
société », nécessite une coopération entre les acteurs qu’ils soient étatiques, instances
internationales ou acteurs non institutionnels !
Comment pourrait-on par exemple régler le problème écologique à une échelle nationale cela
n’aurait aucun sens, car dans la gestion de pbs commun à tous il faut une solution commune à
tous : coordonner les actions des acteurs pour pouvoir obtenir une solution globale à des
enjeux comme celui-ci.

Quand la consommation et la production ce fait à l’échelle mondiale il semble logique que
l’échelle pertinente pour résoudre le problème soit également mondiale.
De plus, face à de problèmes comme l’économie souterraine, le trafic de drogue ou d’arme
des décisions purement étatique ne peuvent suffire seule une volonté globale de résolution et
une coopération judiciaire et policière peut être efficace.
Il ne faudrait pas oublier de prendre en compte la coopération qui s’effectue sur le plan
politique entre des acteurs appartenant des catégories différentes dans notre tableau. Ainsi
dans de nombreux domaines la coopération est bien plus efficace lorsque acteurs
institutionnels et non institutionnels, implantés sur un territoire ou ayant un fonctionnement
en réseaux se joignent les uns aux autres et œuvre de concert pour la résolution d’un problème
donné.
Prenons ainsi comme exemple la coopération entre les ONG et l’ONU qui s’est de plus en
plus accrue au fil du temps : l’importance des ONG est précisée dans l’article 71 de la Charte
de l’ONU. Presque 2 100 ONG qui s’occupent de développement économique et social sont
dotés du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, principale instance où se
décident les politiques économiques et sociales de l’ONU. Les représentants des ONG sont
d’ailleurs invités à s’exprimer lors des séances du Conseil et certains de ses représentants
officient même au siège de l’Organisation. En outre 16700 ONG sont reconnus et accrédités
auprès du Département de l’information des Nations Unis. La coopération entre ces acteurs
recoupe des sujets aussi vastes que les droits de la femme ou la sécurité alimentaire.
Les ONG profitent ainsi d’un label de respectabilité qui leur confère une légitimité d’action.
L’ONU peut quant à elle déléguer l’application de certaines de ses politiques à des ONG plus
efficaces et mieux implantées sur le terrain en ce qui concerne des actions humanitaires ou
sanitaires ainsi que dans la gestion des conflits d’urgence.
Ex : l’action de Médecins sans frontière lors de conflits armés.
Cette collaboration des acteurs permet la gestion des enjeux mondiaux à différentes échelles.
En effet, une prise de conscience mondiale des enjeux permet aux acteurs de s’organiser sur
l’action à mener, chaque acteur agissant dans l’enceinte où son action est la plus efficace. On
peut rapprocher cette idée du principe de subsidiarité, chaque acteur après décision d’une
coopération mondiale va agir à l’échelon où il est le plus efficient.
Les acteurs établissent ainsi entre eux des relations transnationales qui sont définit par
Michel Duquette et Chalmers Larose comme « toute relation ou interaction qui implique au
moins deux acteurs appartenant à des unités territoriales distinctes qui se rencontrent dans
un espace plus vaste ». Pour ces auteurs pour mériter ce qualitatif les relations entre les
acteurs doivent être le fruit de contact régulier et non passagères. On peut également souligner
le fait que les acteurs sociaux tendent de plus en plus à élaborer des stratégies
transnationales cad « toute action ou tout ensemble d’initiatives et de décisions qui viennent
d’1 ou plusieurs acteurs sociaux vivant sur un territoire défini et qui visent à élaborer et à
coordonner avec un ou plusieurs acteurs relevant d’autres unités territoriales, des
mobilisations et des protestations. »(Duquette et Larose). Ainsi les acteurs sociaux ONG,
Associations, mouvements alter mondialiste utilisent (paradoxalement peut-être ) des
stratégies transnationales dans le but d’élargir la portée de leur action. Les médias quant à eux
diffusent l’information à l’échelle mondiale impliquant ainsi davantage le citoyen sur les
enjeux mondiaux.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%