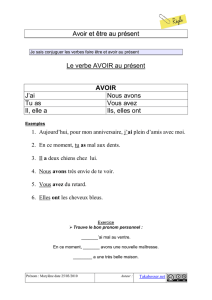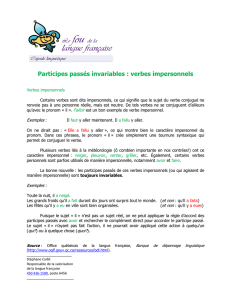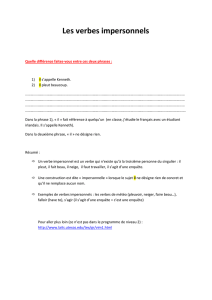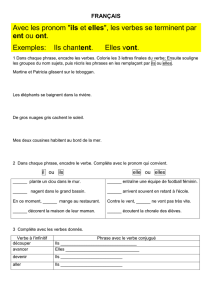Forme Impersonnelle

Fiche de français moderne :
Forme Impersonnelle
On réserve le nom de forme impersonnelle (ou encore unipersonnelle pour les
distinguer des modes dépourvus de marques personnelles : infinitif, participe et gérondif,
également dits impersonnels) à un type de construction verbale particulière.
A côté des phrases où le verbe, variable en personne, reçoit un sujet pourvu de sens et
renvoyant à une entité précise : exp : Pierre travaille , on posera l’exemple suivant :
exp : Il faut que tu travailles , où le verbe reçoit comme seul sujet possible un pronom
invariable (il), ne renvoyant à aucune « personne » et ne représentant aucun élément : le verbe
falloir sera dit impersonnel.
La forme impersonnelle s’oppose ainsi à la construction personnelle, soit que le verbe
n’existe que sous l’une des deux formes (verbes impersonnels au sens strict : exp : Il neige),
soit que l’on puisse observer, avec des verbes normalement personnels, une construction
impersonnelles (exp : Trois livres restent sur la table./ Il reste trois livres sur la table.).
I) Description formelle
A- Présence du pronom « il » invariable
-Le pronom « il » est obligatoire devant le verbe impersonnel
-On ne peut le remplacer par aucun autre pronom : il est donc invariable
- A la différence du pronom personnel « il », le pronom de la forme impersonnelle ne possède
aucun contenu de sens et ne désigne rien. On n’y verra donc pas, à strictement parler, un
pronom personnel : il n’est qu’un mot grammatical.
B- Conjugaison incomplète
Les verbes impersonnels possèdent en outre la propriété de ne pouvoir être employés qu’à
l’indicatif et au subjonctif (exp : Je crois qu’il faut y aller./ Je ne crois pas qu’il faille y
aller.). L’infinitif cependant leur est également possible, mais uniquement en périphrase
verbale, le pronom « il » se reportant alors sur le verbe conjugué (exp : Il va falloir y aller./ Il
ne cesse de pleuvoir.).
II) Verbes impersonnels et constructions impersonnelles
On peut opposer 2 modes d’apparition de la forme impersonnelle :
- tantôt elle constitue le seul emploi normalement possible du verbe ou de la
locution verbes impersonnels (exp : Il neige)
- tantôt au contraire on opposera, d’un point de vue non plus lexical, mais
syntaxique, 2 constructions possibles pour le même verbe, pouvant être mises en
parallèles.

A- Les verbes impersonnels
- Les verbes sans complément : verbes météorologiques (verbes, exp : Il vente ; et locutions
verbales composées de « faire + adjectif ou substantif sans déterminant, exp : Il fait beau, il
fait soleil).
- Verbes et locutions à complément obligatoire : ils servent à présenter un événement, à en
poser l’existence ( Il y a…) ou bien ils font intervenir des jugements de pensée ( exp : il s’agit
de, il paraît que…).
B- Les constructions impersonnelles
Elles se définissent, à la différence de la catégorie précédente, en référence à une construction
personnelle, dont elles constituent une variante possible. On parlera donc de construction
impersonnelle dés lors que l’on pourra reconnaître le mécanisme de transformation suivant :
Il est arrivé un terrible accident. < Un terrible accident est arrivé.
Il y a alors modification de la hiérarchie dans la phrase :
Un accident (thème) est arrivé (prédicat)
Le rôle prédicatif est confié au complément du verbe dans la construction impersonnelle :
Il est arrivé (thème) un accident (prédicat).
Le sujet de la construction personnelle devient régime (complément) de la construction
impersonnelle. De ce fait il passe à droite de la forme verbale. Le verbe s’accorde alors à la
P3 quels que soient les éléments qui le suivent.
III) Le complément des verbes impersonnels : forme et fonction
Nature : groupes nominaux ou leurs substituts (pronom, infinitif en emploi niminal,
proposition subordonnée complétive).
Exp : Il se dit ici des choses curieuses. / Il entre quelqu’un. / Il est nécessaire de
travailler. / Il est douteux que Pierre vienne.
Fonction syntaxique : on ne confondra pas ces éléments avec le complément d’objet
dans la mesure où :
-seuls les verbes excluant la présence de ce complément peuvent entrer dans cette
construction ;
-et où les éléments qui suivent le verbe impersonnel ne peuvent être pronominalisés, à
la différence du complément d’objet.
On ne parlera pas non plus de sujet réel, puisque ces éléments ne peuvent pas toujours
fonctionner comme sujet.
Quelle fonction reconnaître alors à ces termes ?
Pour bien marquer la spécificité de ce fonctionnement syntaxique, propre à cette stucture
(ainsi qu ‘aux présentatifs), on conviendra, comme l’ont déjà proposé plusieurs grammairiens,
de nommer régime cette fonction particulière. Ainsi dans le tour : Il s’est produit une chose
étrange. Le GN une chose étrange sera analysé comme régime de la construction
impersonnelle.
1
/
2
100%