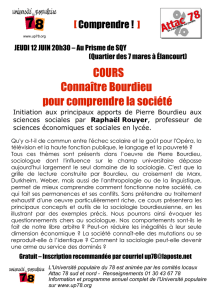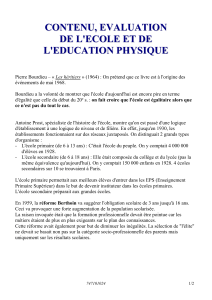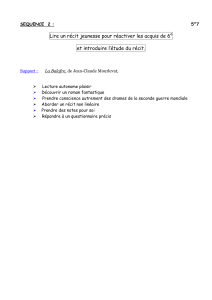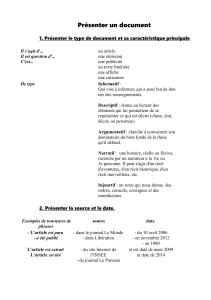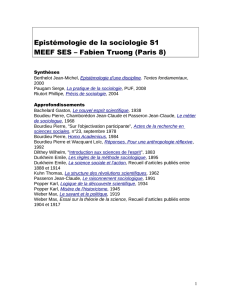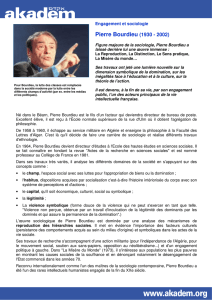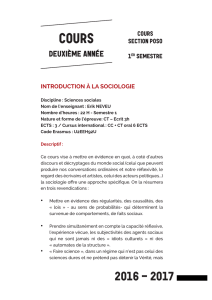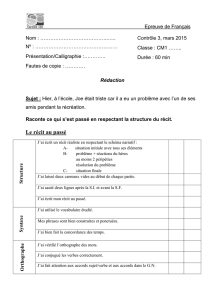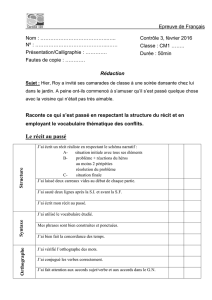methodes_qualitatives

METHODES QUALITATIVES
1-
L’histoire commence en 1989 lorsque Venkatesh, fraîchement diplômé d’un master en Mathématiques, décide de
préparer un doctorat de sociologie à l’université de Chicago. Recueillir des données sur le terrain, cet aspect ingrat du
travail du sociologue, n’intéressait pas Venkatesh, qui se passionnait à l’époque pour la façon dont les jeunes cons-
truisaient leur identité. Il venait de passer les trois derniers mois à suivre la tournée américaine du Grateful Dead...
Mais son directeur de thèse, Julius Wilson, ne l’entendait pas de cette oreille. Il l’envoya derechef dans l’une des cités
les plus pauvres de Chicago, avec un questionnaire à choix multiples qui débutait ainsi : Comment ressentez-vous le fait
d’être noir et pauvre ? Très mal, Mal, Ni mal ni bien, Plutôt bien, Très bien…
Un jour, Venkatesh visitait un immeuble particulièrement délabré, sans ascenseur, où quelques familles misérables
s'agglutinaient dans les premiers étages. Par acquis de conscience, il alla prospecter les étages supérieurs, et tomba
inopinément sur le QG des Black Gangster Disciple Nation.
Après avoir joué quelque temps avec ses nerfs, les membres du gang comprirent qu’il n’était ni un espion, ni un flic,
et finirent par l'intégrer à leur beer-party. Pour tuer le temps, ils demandèrent même à être interviewés. Venkatesh
confiera plus tard à ses collègues que le questionnaire était mal libellé. En particulier, la question à choix multiples «
Comment ressentez-vous le fait d’être noir et pauvre ? » n'avait pas prévu la réponse : Fuck you !
A peine libéré, Venkatesh sentit qu’il tenait là un sujet. Le temps de prendre une douche, il revint sur les lieux pour
proposer à J.T., le boss local, d'être incorporé dans le gang -- comme observateur s'entend. J.T. lui dit d’abord qu’il
était fou, mais, lui-même diplômé d’un MBA, il finit par accepter. Moyennant quoi, Venkatesh passera les six années
suivantes avec les membres du gang, dormira dans leur famille, les suivra dans leur vie quotidienne, gagnant au fil du
temps la confiance de chacun. Au point qu'un jour, Bootie, le trésorier local, lui remis la comptabilité complète du
gang depuis quatre ans ! L'homme se savait menacé (il sera tué peu après), et souhaitait mettre en ordre sa cons-
cience...
Claude Bordes – antisophiste.blogspot.fr
2-
La trajectoire de vie peut être définie comme « un entrecroisement de multiples lignes biographiques plus ou moins autonomes ou
dépendantes les unes des autres : le parcours scolaire, le rapport au travail et à l’emploi, la vie familiale, la vie sociale, la santé, la trajec-
toire résidentielle, l’itinéraire politique, etc. » (Hélardot, 2006 : 3). Chacun de ces domaines correspond à un ensemble de
pratiques, de rôles et d’identités sociales se déployant sur trois axes : lieux, temps et temporalités, réseaux et cadres
structurels. La trajectoire dans sa globalité est ainsi constituée par une succession de situations vécues par les indivi-
dus dans différentes sphères et par l’histoire des diverses configurations successives ou « formes identitaires » structu-
rant l’articulation entre ces sphères de la vie sociale. Par ailleurs, la trajectoire d’un individu n’est pas linéaire mais
composée d’étapes ou phases, ponctuées par des ruptures et des « bifurcations » dont le moment et l’issue étaient im-
prévisibles. Cette définition de la bifurcation se rapproche de la notion de « turning-points » utilisée pour l’analyse des
carrières professionnelles, marquées par des phases successives de transition, plus ou moins prévisibles, plus ou
moins brèves, plus ou moins ritualisées ou institutionnalisées. Un moment de doute, d’incertitude, marque souvent le
début d’une bifurcation. Celle-ci diffère de la « transition » biographique dont la venue est prévisible (par exemple : la
fin des études) ou du « carrefour » dont les issues restent limitées et structurées (comme l’orientation scolaire où il est
obligatoire de faire un choix ; Grossetti, 2006 : 13-14).
Le récit de vie, comme expérience narrative (Ricœur, 1990) permet de retracer une trajectoire singulière. L’individu
met en scène à travers lui une multiplicité de sphères, dont certaines ont parfois permis une bifurcation ou un chan-
gement, d’autres ayant été touchées ensuite par ces changements. Par exemple, le récit d’un processus d’installation
en agriculture se limite rarement à l’évocation de la seule sphère professionnelle. Il évoque d’autres sphères : la
sphère amoureuse ou familiale, la sphère économique ou plus subjectif encore, un ’projet de vie’ dans sa globalité,
qui ont eu une influence décisive pour décider de s’installer en agriculture ou qui ont été affectées par ce choix pro-
fessionnel parfois lourd de conséquences. Un récit de vie met donc en lumière les différents ’ingrédients’ mobilisés
pour prendre une décision, inscrits dans des temporalités hétérogènes : le temps long de l’histoire des cadres socié-
taux, le temps générationnel de la famille et des héritages, le temps plus court de l’individu dans ses interactions
quotidiennes et dans divers réseaux. Interviennent également l’instant de l’événement et le temps prospectif (Bidart,
2006 : 23). Une bifurcation n’est plus seulement le résultat d’une accumulation d’événements : leur simultanéité cons-
titue aussi un facteur décisif.
Récits de vie ou méthode biographique
Le recueil de récits de vie (ou méthode biographique) est une méthode initiée par les sociologues américains de
l’École de Chicago dans les années 1920 et développée notamment lors de l’enquête de Thomas et Znaniecki sur les
paysans polonais (Thomas et Znaniecki, 1998). La méthode s’inscrit clairement dans l’interactionnisme symbolique :
elle repose sur une approche compréhensive des phénomènes et considère l’acteur social enquêté comme « un véri-
table observatoire du social, à partir duquel se font et se défont les interactions et actions de tous » (Le Breton, 2004 : 20). Partant de
là, il importe de saisir les raisons qui motivent les actions du point de vue de chacun des acteurs. Cela n’est possible
qu’en leur donnant la parole. Les récits de vie constituent alors des occasions de mettre à jour dans le détail les ma-

nières dont chacun a réagi au fil des circonstances, les connaissances et registres de justifications qui ont permis
d’affronter des événements, les leçons tirées de l’action, les facultés revendiquées d’adaptation (Le Breton, 2004 : 28).
La méthode de recueil des récits de vie fut tout d’abord mobilisée en France par l’anthropologie et la psychologie
sociale avant d’être partiellement oubliée au cours des années 1940 et 1950 au profit de méthodes quantitatives et
statistiques. Elle sera réhabilitée par la sociologie française des années 1970 avec les travaux de Daniel Bertaux, pour
qui « le récit de vie résulte d’une forme particulière d’entretien, l’entretien narratif, au cours duquel un chercheur (…) demande à une
personne ci-après dénommée « sujet », de lui raconter tout ou une partie de son expérience vécue » (Bertaux, 2005 : 6). Mais l’une des
limites opposable au procédé narratif, c’est qu’il tend « à unifier le parcours, à lui donner une forme de trajectoire, à le rendre
cohérent » (Bidart, 2006 : 3), car il s’agit souvent pour le narrateur de ne pas « perdre la face » (Goffman, 1973 : 742). Le
récit articule et mobilise ainsi des arguments de justification aux étapes vécues. C’est ce que Bourdieu appelle « se faire
l’idéologie de sa propre vie » (Bourdieu, 1986 : 2). Passeron souligne quant à lui que « l’excès de sens et de cohérence » inhérent
aux récits biographiques peut conduire le sociologue à « l’indigestion » ou aboutir à la situation extrême d’un « tout
pertinent » où « chaque biographie contient Tout » (Passeron, 1989 : 4). L’une des difficultés propre à l’étude des trajec-
toires basées sur le récit de vie consiste donc à trouver des solutions méthodologiques aptes à rendre compte de
l’intelligibilité des ordres biographiques tout en minimisant les « effets de reconstruction » (Grossetti, 2006 : 19).
Chaxel Sophie, Fiorelli Cécile, Moity-Maïzi Pascale, Les récits de vie : outils pour la compréhension et catalyseurs
pour l’action, Revue Interrogations – n° 18 - janvier 2014
3 - L'illusion biographique
L'histoire de vie est une de ces notions du sens commun qui sont entrées en contrebande dans l'univers savant;
d'abord, sans tambour ni trompette, chez les ethnologues, puis, plus récemment, et non sans fracas, chez les socio-
logues. Parler d'histoire de vie, c'est présupposer au moins, et ce n'est pas rien, que la vie est une histoire et qu'une
vie est inséparablement l'ensemble des événements d'une existence individuelle conçue comme une histoire et le récit
de cette histoire. C'est bien ce que dit le sens commun, c'est-à-dire le langage ordinaire, qui décrit la vie comme un
chemin, une route, une carrière, avec ses carrefours (Hercule entre le vice et la vertu), ou comme un cheminement,
c'est-à-dire un trajet, une course, un cursus, un passage, un voyage, un parcours orienté, un déplacement linéaire,
unidirectionnel (la « mobilité » ), comportant un commencement (« un début dans la vie »), des étapes, et une fin, au
double sens, de terme et de but (« il fera son chemin » signifie il réussira, il fera une belle carrière), une fin de l'his-
toire. C'est accepter tacitement la philosophie de l'histoire au sens de succession d'événements historiques, qui est
impliquée dans une philosophie de l'histoire au sens de récit historique, bref, dans une théorie du récit, récit d'histo-
rien ou de romancier, sous ce rapport indiscernables, biographie ou autobiographie notamment.
Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut tenter de dégager quelques-uns des présupposés de cette théorie. D'abord le
fait que « la vie » constitue un tout, un ensemble cohérent et orienté, qui peut et doit être appréhendé comme expres-
sion unitaire d'une « intention » subjective et objective, d'un projet : la notion sartrienne de « projet originel » ne fait
que poser explicitement ce qui est impliqué dans les « déjà », « dès lors », « depuis son plus jeune âge », etc., des bio-
graphies ordinaires, ou dans les « toujours » (« j'ai toujours aimé la musique ») des « histoires de vie ». Cette vie orga-
nisée comme une histoire (au sens de récit) se déroule, selon un ordre chronologique qui est aussi un ordre logique,
depuis un commencement, une origine, au double sens de point de départ, de début, mais aussi de principe, de raison
d'être, de cause première jusqu'à son terme qui est aussi un but, un accomplissement (telos). Le récit, qu'il soit bio-
graphique ou autobiographique, comme celui de l'enquêté qui « se livre » à un enquêteur, propose des événements
qui sans être tous et toujours déroulés dans leur stricte succession chronologique (quiconque a recueilli des histoires
de vie sait que les enquêtés perdent constamment le fil de la stricte succession calendaire), tendent ou prétendent à
s'organiser en séquences ordonnées selon des relations intelligibles. Le sujet et l'objet de la biographie (l'enquêteur et
l'enquêté) ont en quelque sorte le même intérêt à accepter le postulat du sens de l'existence racontée (et, implicite-
ment, de toute existence).
On est sans doute en droit de supposer que le récit autobiographique s'inspire toujours, au moins pour une part, du
souci de donner sens, de rendre raison, de dégager une logique à la fois rétrospective et prospective, une consistance
et une constance, en établissant des relations intelligibles, comme celle de l'effet à la cause efficiente, entre les états
successifs, ainsi constitués en étapes d'un développement nécessaire. (Et il est probable que ce profit de cohérence et
de nécessité est au principe de l'intérêt, variable selon la position et la trajectoire, que les enquêtés portent à l'entre-
prise biographique.) Cette inclination à se faire l'idéologue de sa propre vie en sélectionnant, en fonction d'une inten-
tion globale, certains événements significatifs et en établissant entre eux des connexions propres à les justifier d'avoir
existé et à leur donner cohérence, comme celles qu'implique leur institution en tant que causes ou plus souvent, en
tant que fins, trouve la complicité naturelle du biographe que tout, à commencer par ses dispositions de profession-
nel de l'interprétation, porte à accepter cette création artificielle de sens.
Il est significatif que l'abandon de la structure du roman comme récit linéaire ait coïncidé avec la mise en question de
la vision de la vie comme existence dotée de sens, au double sens de signification et de direction. Cette double rup-
ture, symbolisée par le roman de Faulkner, Le Bruit et la Fureur, s'exprime en toute clarté dans la définition de la vie
comme anti-histoire que propose Shakespeare à la fin de Macbeth : « C'est une histoire que conte un idiot, une his-
toire pleine de bruit et de fureur, mais vide de signification. » Produire une histoire de vie, traiter la vie comme une
histoire, c'est-à-dire comme le récit cohérent d'une séquence signifiante et orientée d'événements, c'est peut-être

sacrifier à une illusion rhétorique, à une représentation commune de l'existence, que toute une tradition littéraire n'a
cessé et ne cesse de renforcer. C'est pourquoi il est logique de demander assistance à ceux qui ont eu à rompre avec
cette tradition sur le terrain même de son accomplissement exemplaire. Comme l'indique Alain Robbe-Grillet, «
l'avènement du roman moderne est précisément lié à cette découverte : le réel est discontinu, formé d'éléments jux-
taposés sans raison dont chacun est unique, d'autant plus difficiles à saisir qu'ils surgissent de façon sans cesse im-
prévue, hors de propos, aléatoire ». (…)
Tout permet de supposer que le récit de vie tend à se rapprocher d'autant plus du modèle officiel de la présentation
officielle de soi, carte d'identité, fiche d'état civil, curriculum vitae, biographie officielle, et de la philosophie de l'iden-
tité qui le sous-tend, que l'on s'approche davantage des interrogatoires officiels des enquêtes officielles — dont la
limite est l'enquête judiciaire ou policière —, s'éloignant du même coup des échanges intimes entre familiers et de la
logique de la confidence qui a cours sur ces marchés protégés où l'on est entre soi. Les lois qui régissent la produc-
tion des discours dans la relation entre un habitus et un marché s'appliquent à cette forme particulière d'expression
qu'est le discours sur soi ; et le récit de vie variera, tant dans sa forme que dans son contenu, selon la qualité sociale
du marché sur lequel il sera offert — la situation d'enquête elle-même contribuant inévitablement à déterminer la
forme et le contenu du discours recueilli. Mais l'objet propre de ce discours, c'est-à-dire la présentation publique,
donc l'officialisation, d'une représentation privée de sa propre vie, implique un surcroît de contraintes et de censures
spécifiques (dont les sanctions juridiques contre les usurpations d'identité ou le port illégal de décorations représen-
tent la limite). Et tout permet de supposer que les lois de la biographie officielle tendront à s'imposer bien au-delà
des situations officielles, au travers des présupposés inconscients de l'interrogation (comme le souci de la chronologie
et tout ce qui est inhérent à la représentation de la vie comme histoire), au travers aussi de la situation d'enquête qui,
selon la distance objective entre l'interrogateur et l'interrogé, et selon l'aptitude du premier à « manipuler » cette rela-
tion, pourra varier depuis cette forme douce d'interrogatoire officiel qu'est le plus souvent, à l'insu du sociologue,
l'enquête sociologique, jusqu'à la confidence, au travers enfin de la représentation plus ou moins consciente que
l'enquêté se fera de la situation d'enquête, en fonction de son expérience directe ou médiate de situations équiva-
lentes (interview d'écrivain célèbre, ou d'homme politique, situation d'examen, etc.) et qui orientera tout son effort de
présentation de soi ou, mieux, de production de soi.
L'analyse critique des processus sociaux mal analysés et mal maîtrisés qui sont à l'œuvre, à l'insu du chercheur, dans la
construction de cette sorte d'artefact irréprochable qu'est « l'histoire de vie », n'est pas à elle-même sa fin. Elle con-
duit à construire la notion de trajectoire comme série des positions successivement occupées par un même agent (ou
un même groupe) dans un espace lui-même en devenir et soumis à d'incessantes transformations. Essayer de com-
prendre une vie comme une série unique et à soi suffisante d'événements successifs sans autre lien que l'association à
un « sujet » dont la constance n'est sans doute que celle d'un nom propre, est à peu près aussi absurde que d'essayer
de rendre raison d'un trajet dans le métro sans prendre en compte la structure du réseau, c'est-à-dire la matrice des
relations objectives entre les différentes stations. Les événements biographiques se définissent comme autant de
placements et de déplacements dans l'espace social, c'est-à-dire, plus précisément, dans les différents états successifs
de la structure de la distribution des différentes espèces de capital qui sont enjeu dans le champ considéré. Le sens
des mouvements conduisant d'une position à une autre (d'un éditeur à un autre, d'une revue à une autre, d'un évêché
à un autre, etc.) se définit, de toute évidence, dans la relation objective entre le sens au moment considéré de ces
positions au sein d'un espace orienté. C'est dire qu'on ne peut comprendre une trajectoire (c'est-à-dire le vieillisse-
ment social qui, bien qu'il l'accompagne inévitablement, est indépendant du vieillissement biologique) qu'à condition
d'avoir préalablement construit les états successifs du champ dans lequel elle s'est déroulée, donc l'ensemble des
relations objectives qui ont uni l'agent considéré — au moins, dans un certain nombre d'états pertinents du champ
— à l'ensemble des autres agents engagés dans le même champ et affrontés au même espace des possibles. Cette
construction préalable est aussi la condition de toute évaluation rigoureuse de ce que l'on peut appeler la surface
sociale, comme description rigoureuse de la personnalité désignée par le nom propre, c'est-à-dire l'ensemble des
positions simultanément occupées à un moment donné du temps par une individualité biologique socialement insti-
tuée agissant comme support d'un ensemble d'attributs et d'attributions propres à lui permettre d'intervenir comme
agent efficient dans différents champs.
Pierre Bourdieu : Raisons pratiques, Sur la théorie de l'action. Paris, Éd. du Seuil, 1994. Chapitre 3 : Pour une science
des œuvres. Annexe 1.
4- L'espace des points de vue.
Pour comprendre ce qui se passe dans des lieux qui, comme les « cités » ou les « grands ensembles », et aussi nombre
d'établissements scolaires, rapprochent des gens que tout sépare, les obligeant à cohabiter, soit dans l'ignorance ou
dans l'incompréhension mutuelle, soit dans le conflit, latent ou déclaré, avec toutes les souffrances qui en résultent, il
ne suffit pas de rendre raison de chacun des points de vue saisi à l'état séparé. Il faut aussi les confronter comme ils
le sont dans la réalité, non pour les relativiser, en laissant jouer à l'infini le jeu des images croisées, mais, tout au con-
traire, pour faire apparaître, par le simple effet de la juxtaposition, ce qui résulte de l'affrontement des visions du
monde différentes ou antagonistes : c'est-à-dire, en certains cas, le tragique qui naît de l'affrontement sans concession
ni compromis possible de points de vue incompatibles, parce que également fondés en raison sociale.
Si les entretiens ont été conçus et construits comme des ensembles autosuffisants, susceptibles d'être lus isolément

(et dans un ordre quelconque), ils ont été distribués de manière à ce que les gens appartenant à des catégories qui ont
des chances d'être rapprochées, voire confrontées, dans l'espace physique (comme les gardiens de HLM et les habi-
tants, adultes ou adolescents, ouvriers, artisans ou commerçants, de ce genre de résidence) se trouvent aussi rappro-
chés dans la lecture. On espère ainsi produire deux effets : faire apparaître que les lieux dits « difficiles » (comme
aujourd'hui la « cité » ou l'école) sont d'abord difficiles à décrire et à penser et qu'il faut substituer aux images sim-
plistes, et unilatérales (celles que véhicule la presse notamment), une représentation complexe et multiple, fondée sur
l'expression des mêmes réalités dans des discours différents, parfois inconciliables ; et, à la manière de romanciers
tels que Faulkner, Joyce ou Virginia Woolf, abandonner le point de vue unique, central, dominant, bref quasi divin,
auquel se situe volontiers l'observateur, et aussi son lecteur (aussi longtemps au moins qu'il ne se sent pas concerné),
au profit de la pluralité des perspectives correspondant à la pluralité des points de vue coexistants et parfois directe-
ment concurrents.
Ce perspectivisme n'a rien d'un relativisme subjectiviste, qui conduirait à une forme de cynisme ou de nihilisme. Il est
en effet fondé dans la réalité même du monde social et il contribue à expliquer une grande part de ce qui advient
dans ce monde, et, en particulier, nombre des souffrances nées de la collision des intérêts, des dispositions et des
styles de vie différents que favorise la cohabitation, notamment au lieu de résidence ou au lieu de travail, de gens
différant sous tous ces rapports. C'est à l'intérieur de chacun des groupes permanents (voisins de quartier ou d'im-
meuble, collègues de bureau, etc.), horizon vécu de toutes les expériences, que sont perçues et vécues, avec toutes les
erreurs (de cible notamment) résultant de l'effet d'écran, les oppositions, en matière de style de vie surtout, qui sépa-
rent des classes, des ethnies ou des générations différentes. Même si l'on rencontre parfois des personnes que leur
trajectoire, autant que leur position, incline à une vision déchirée et divisée contre elle-même (je pense à cette mar-
chande d'articles de sport d'une cité « difficile » qui se sent fondée à se défendre avec vigueur contre les agressions
des jeunes, tout en portant sur eux un regard compréhensif), la confrontation directe des différences a pour effet de
favoriser la lucidité intéressée et partielle de la polémique (c'est le cas, par exemple, lorsque telle immigrée espagnole
invoque la différence entre les structures des familles européennes, qui combinent un taux de fécondité faible et,
souvent, une forte discipline de vie, et les familles maghrébines, très prolifiques et souvent vouées à l'anomie par la
crise de l'autorité paternelle résultant de la condition de l'exilé, mal adapté et parfois placé sous la dépendance de ses
propres enfants).
Il n'est pas jusqu'à l'expérience de la position occupée dans le macrocosme social qui ne soit déterminée ou, au moins,
altérée par l'effet directement éprouvé des interactions sociales à l'intérieur de ces microcosmes sociaux, bureau,
atelier, petite entreprise, voisinage et aussi famille étendue. La pièce de Patrick Süskind, La contrebasse, fournit une
image particulièrement réussie de l'expérience douloureuse que peuvent avoir du monde social tous ceux qui, comme
le contrebassiste au sein de l'orchestre, occupent une position inférieure et obscure à l'intérieur d'un univers presti-
gieux et privilégié, expérience d'autant plus douloureuse sans doute que cet univers, auquel ils participent juste assez
pour éprouver leur abaissement relatif, est situé plus haut dans l'espace global. Cette misère de position, relative au
point de vue de celui qui l'éprouve en s'enfermant dans les limites du microcosme, est vouée à paraître « toute rela-
tive », comme on dit, c'est-à-dire tout à fait irréelle, si, prenant le point de vue du macrocosme, on la compare à la
grande misère de condition ; référence quotidiennement utilisée à des fins de condamnation (« tu n'as pas à te
plaindre ») ou de consolation (« il y a bien pire, tu sais »). Mais, constituer la grande misère en mesure exclusive de
toutes les misères, c'est s'interdire d'apercevoir et de comprendre toute une part des souffrances caractéristiques d'un
ordre social qui a sans doute fait reculer la grande misère (moins toutefois qu'on ne le dit souvent) mais qui, en se
différenciant, a aussi multiplié les espaces sociaux (champs et sous-champs spécialisés), qui ont offert les conditions
favorables à un développement sans précédent de toutes les formes de la petite misère. Et l'on n'aurait pas donné
une représentation juste d'un monde qui, comme le cosmos social, a la particularité de produire d'innombrables
représentations de lui-même, si l'on n'avait pas fait leur place dans l'espace des points de vue à ces catégories particu-
lièrement exposées à la petite misère que sont toutes les professions qui ont pour mission de traiter la grande misère
ou d'en parler, avec toutes les distorsions liées à la particularité de leur point de vue.
La misère du monde, Pierre Bourdieu, dir., Seuil, 1993, pp. 9,10 & 11.
5 -
Quiconque a fait des entretiens s'est trouvé confronté à la difficulté de choisir une technique d'analyse, qualitative ou
quantitative, et s'est interrogé sur les avantages comparés de l'analyse thématique ou de la lexicométrie, de l'analyse
structurale ou syntaxique. Comment traiter ce matériel de manière rigoureuse et systématique, tout en sauvegardant
sa richesse et sa diversité? Ce problème, Bourdieu le résout de manière originale, en donnant à lire les entretiens au
lecteur. Leur publication repose sur une double exigence, de fidélité et de lisibilité. Les auteurs n'ont pas livré le ma-
tériel brut. Ils ont fait un choix parmi les entretiens, ils ont opéré des coupures, allégé le texte des redites, des onoma-
topées et des tics de langage qui rythment l'expression orale, supprimé les passages purement informatifs ou anecdo-
tiques ou permettant d'identifier les personnes interrogées.
Mais ils sont restés globalement fidèles au texte d'origine, ils n'ont «jamais remplacé un mot par un autre, ni trans-
formé l'ordre des questions ou le déroulement de l'entretien et toutes les coupures ont été soulignées » (p. 922). Leur
apport principal réside dans la présentation des entretiens. Pour en permettre la compréhension, de courts textes
introductifs situent socialement les personnes interrogées, «afin de rappeler les conditions sociales et les condition-

nements dont l'auteur du discours est le produit, sa trajectoire, sa formation, ses expériences professionnelles » (p. 8).
Des titres et des sous-titres, toujours tirés des paroles mêmes des interviewés, mettent en relief les propos les plus
significatifs. L'ordre même des entretiens leur donne sens, par la mise en perspective de points de vue opposés sur
une même réalité. L'analyse proprement dite des entretiens s'arrête là. Comme souvent dans les textes de Bourdieu,
«l'observation n'a pas pour tâche de contrôler la validité des hypothèses», au demeurant non explicitées, «mais seule-
ment d'illustrer un développement théorique» (Bon et Schemeil, 1980, p. 1 296). Les textes d'accompagnement des
entretiens analysent les mécanismes sociaux censés conditionner le discours des interviewés - exclusion scolaire,
relégation en grande banlieue, politique du logement, influence des médias, etc. Ils sont destinés à orienter la lecture,
mais c'est au lecteur de se faire sa propre idée, les entretiens tels qu'ils sont présentés parlant d'eux mêmes. L'essentiel
est qu'ils permettent de comprendre, car pour Bourdieu «comprendre et expliquer ne font qu'un» (p. 910).
Il y a dans cette manière de procéder une véritable révolution par rapport à la pratique sociologique telle que la pré-
sentait Le métier de sociologue. Bourdieu voyait alors «la malédiction des sciences de l'homme» dans le fait qu'elles
avaient «affaire à un objet qui parle», mettant en garde le sociologue contre le risque «de substituer purement et sim-
plement à ses propres prénotions les prénotions de ceux qu'il étudie, ou un mixte faussement savant et faussement
objectif de la sociologie spontanée du 'savant' et de la sociologie spontanée de son objet» (Bourdieu, Chamboredon
et Passeron, 1968, p. 64). Dans La misère du monde, c'est le sociologue qui s'efface derrière la parole des interviewés,
réduit au rôle de «l'écrivain public», essentiellement chargé «d'accompagner les messages qui lui ont été confiés» (p.
924), sans les trahir.
Hier encore, Bourdieu soulignait les ambiguïtés du langage commun et voyait dans ce que d'autres critiquent comme
du jargon sociologique une nécessité, reprenant à son compte cette affirmation de Durkheim : « Nous croyons que le
moment est venu pour la sociologie de renoncer aux succès mondains, pour ainsi parler, et de prendre le caractère
ésotérique qui convient à toute science. Elle gagnera ainsi en dignité et en autorité ce qu'elle perdra en popularité»
(Bourdieu, Chamboredon et Passeron, 1968, p. 113). Aujourd'hui, il plaide pour une sociologie non seulement com-
préhensive mais compréhensible par le grand public, s' adressant à l'émotion autant qu'à la raison. Les entretiens sont
assimilés à «des paraboles du discours prophétique», qui permettent de «livrer un équivalent plus accessible d'analyses
conceptuelles complexes et abstraites (...) Capables de toucher et d'émouvoir, de parler à la sensibilité, sans sacrifier
au goût du sensationnel, ils peuvent entraîner les conversions de la pensée et du regard qui sont souvent la condition
préalable de la compréhension» (p. 922).
Loin de les opposer, il souligne les correspondances entre la sociologie et la littérature. Le point de vue du sociologue
est assimilé à celui des romanciers tels que Faulkner, Joyce ou Virginia Woolf (p. 910). Et il est demandé au lecteur
d'approcher La misère du monde avec les mêmes égards que pour un texte littéraire ou philosophique : «II faut,
comme l'enseignait Flaubert, apprendre à porter sur Yvetot le regard que l'on accorde si volontiers à Constantinople :
apprendre par exemple à accorder au mariage d'une femme professeur avec un employé des postes l'attention et
l'intérêt que l'on prêterait au récit littéraire d'une mésalliance et à offrir aux propos d'un ouvrier métallurgiste l'accueil
recueilli que certaine tradition de la lecture réserve aux formes les plus hautes de la poésie ou de la philosophie» (p.
924). (…)
La «conversation ordinaire» n'est pourtant pas la seule manière de mener un entretien. Pour explorer un univers
idéologique, rien ne vaut l'entretien non directif rogérien. Contrairement à ce qu'affirme Bourdieu, il ne repose ni sur
«le pur laisser-faire » (p. 906) ni sur «l'annulation de l'observateur» (p. 916) mais sur l'empathie, une écoute active et
des reformulations fidèles, miroir des propos de l'enquêté. Il fonctionne comme un test projectif à partir d'une con-
signe initiale, à cette différence près que le sociologue y cherche moins les structures de la personnalité de son inter-
locuteur que les modèles culturels dont ce dernier est porteur, en fonction des divers groupes sociaux auxquels il
appartient (Michelat, 1975).
Si l'on veut tester la cohérence des opinions déclarées, le «stress interview» (Smith, Bruner et White, 1956, pp. 64-65),
aux antipodes de la nondirectivité, reposant sur la contradiction systématique de l'enquêté, sera le mieux adapté. Pour
mesurer l'intensité et la fréquence des attitudes mises au jour par les entretiens, on aura recours au questionnaire
standardisé auprès d'un échantillon représentatif, ou sondage d'opinion. Loin de s'opposer, ces divers types d'entre-
tien sont complémentaires. Même le sondage d'opinion, tant décrié, n'est qu'une technique parmi d'autres de recueil
de données, susceptible de bons ou de mauvais usages. Pour s'en convaincre il est instructif de relire L'amour de l'art.
Pierre Bourdieu faisait alors avec Alain Darbel une enquête par sondage portant sur «le public des musées européens,
ses caractéristiques sociales et scolaires, ses attitudes à l'égard du musée et ses préférences artistiques» (Bourdieu et
Darbel,1969, p. 21). Leur questionnaire, élaboré à partir d'une préenquête par entretiens, est un modèle du genre. Il
cerne le rapport à l'art des personnes interrogées et ses conditions sociales de production, sans jamais les interroger
directement sur l'art, par le biais de questions sur la fréquence de leurs visites dans les musées, les conditions de leurs
visites (seul, en famille, en groupe, avec un guide, avec un conférencier ou un professeur, etc.), et leurs attentes (flé-
chage de la visite, panneaux informatifs, etc.).
A cette époque, Bourdieu ne voyait pas encore dans les sondages d'opinion une «science sans savant» (p. 919), et sa
conception de la sociologie était moins réductrice.
L'entretien selon Pierre Bourdieu
Analyse critique de La misère du monde - Nonna Mayer – Revue Française de Sociologie - 1995
1
/
5
100%