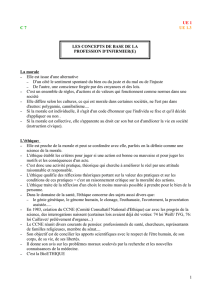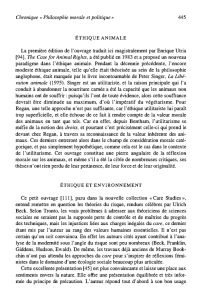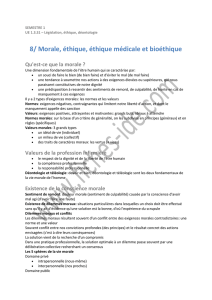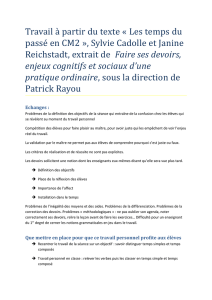Ethique cours redige

1. L’empirisme en éthique : des sentiments moraux sont la base de nos conduites morales
Qu’est-ce qui nous motive effectivement à agir dans un sens moral ? Qu’est-ce qui, par exemple, me
fait secourir une personne manifestement dans le besoin ? À coup sûr, c’est en général l’empathie, ou
la « pitié » (Rousseau). C’est donc la nature (humaine) qui explique la morale. Et c’est l’éducation,
qui recouvre ou au contraire développe cette tendance innée (Rousseau).
Certainement il n’y aurait pas eu de conduite morale, de jugement moraux, de critique morale, etc.
bref, de vie morale si les êtres humains n’avaient pas eu une nature qui les rendent capable de certains
sentiments moraux, à commencer par l’empathie. Mais 1/ est-ce une condition suffisante ? 2/ est-ce
que nos sentiments justifient la bonne conduite à adopter ?
Limites de l’empirisme
Parce que les sentiments sont subjectifs, partiaux, et contingents, ils ne peuvent pas justifier de
manière objective que nous devrions moralement faire x plutôt que y.
Le cœur a peut-être ses raisons, mais celles-ci ne sont pas partageables, ce sont des raisons subjectives.
D’une manière générale, seule la raison peut justifier un choix d’une manière objective et universelle
(pour tous sujet placé dans la même situation, le choix justifié rationnellement sera le même).
Par ailleurs, il ne faut pas confondre une explication (c’est mon sentiment d’empathie qui explique ma
conduite) avec une justification (ce sentiment ne justifie pas ma conduite, qui peut être inapproprié)
2. L’utilitarisme : une éthique du bien collectif
L’utilitarisme fournit une théorie des devoirs moraux et des choix éthiques. Contre la tendance
égoïste de l’homme, que certains (tel Hobbes) estiment indépassable, on peut opposer que l’homme est
capable de choix impartiaux. Nos choix éthiques doivent et peuvent reposer sur la nécessité de
l’impartialité et de l’objectivité. Nous savons ce que nous devons faire dans une décision éthique
lorsque nous avons déterminé, après examen, quelle est l’option qui « maximise » la satisfaction des
individus, humains et animaux (doués de sensibilité), et qui « minimise » la souffrance et
l’insatisfaction. On mesurera la valeur d’une action possible en fonction de plusieurs paramètres, dans
la mesure du possible (intensité du plaisir ou de la souffrance produite, nombre d’individus concernés,
probabilité, etc.)
Selon J S Mill, la plupart des règles de la morale commune, les normes morales
communément admises dans nos sociétés (ex : il faut respecter nos promesses et nos contrats ; il faut
être sincère ; il faut être fidèle et loyal ; il faut rendre service à qui nous à rendu service, etc.), satisfont
le principe utilitariste. En effet, si la religion, l’Etat, la société marchande, etc. ont historiquement
retenu ces règles comme valables, c’est au fond parce qu’elles sont utiles à tous (leur nécessité est
fondée sur l’induction), bien que ce fondement n’ait pas été aperçu explicitement et ait été masqué par
d’autres idéologies (notamment religieuse).
Cependant, selon Mill, ces devoirs moraux n’ont une validité que générale, et non pas
universelle : il faut parfois savoir s’en écarter, lorsque les circonstances l’exigent. Les exceptions sont
donc possibles, et même parfois nécessaires.
Par exemple, dans le domaine médical, le secret professionnel (la non divulgation à un tiers
d’informations concernant un patient), doit être en général préservé, sans quoi les patients ou les
prévenus ne se confieront plus à leur médecins, ce qui finira par nuire à la santé publique (ex : en cas
d’épidémie). Il en est de même dans le domaine judiciaire, où le secret professionnel qui oblige
l’avocat garantie les droits du prévenu à être conseillé et défendu correctement dans un procès, ce qui
est un droit de l’homme. Mais, considère à juste titre les utilitaristes, ce secret doit pourtant
exceptionnellement être rompu. Par exemple, le médecin a le devoir ne prévenir le conjoint d’un
patient séropositif si ce dernier refuse de l’en informer.
On dit aujourd’hui, en éthique médicale, que le devoir de secret professionnel est un devoir « prima
facie » (en premier aspect), mais il peut être annulé par un autre devoir qui dans telle circonstance est
supérieur (ici la protection d’une victime potentiel).

Les limites de l’éthique utilitariste
Peut-on dire d’une action bénéfique à l’humanité (ou aux animaux, d’ailleurs), donc « utile »,
qu’elle est nécessairement bonne moralement ? Certainement pas. Les critères utilitaristes permettent
de mesurer le caractère bénéfique du résultat d’une action, mais ne prennent pas en compte la
motivation de l’acteur (la portée morale ou non de son intention) ou ses vertus. Par exemple, on ne
peut faire la différence d’un point de vue utilitariste entre un donateur intéressé à ses dons (qui attend
un gain en termes de réputation ou autre) et un donateur véritablement généreux. L’utilitarisme peut
donc fournir de bons critères pour une politique (au sens large d’action collective…) mais pas pour
une éthique individuelle.
L’utilitarisme considère que la fin de la morale est le bonheur (collectif), compris dans le sens
minimal de plus grandes satisfactions. Il s’agirait de rendre le plus grand nombre heureux (« the best
for the most »). Pourtant, une telle thèse conduit à des risques de paternalisme : l’agent moral est
supposé savoir ce qui rend heureux les autres, et agir pour leur bonheur, éventuellement malgré eux !
Le défaut ici, évident, est que la théorie n’aménage pas de place centrale à la liberté, l’autonomie des
individus à qui l’agent à affaire dans sa vie pratique. Par exemple, en éthique médicale, le médecin ne
doit pas imposer un traitement à un patient sans le consentement éclairé (éclairé par les informations
communiquées par le médecin) du patient : c’est le principe du respect de l’autonomie, au cœur de la
philosophie morale de Kant.
3. La théorie de Kant : des devoirs moraux inconditionnels
Ces deux critiques nous conduisent à une autre perspective éthique : une morale de l’intention (plus
que du résultat) et une morale des devoirs inconditionnels (sans exception)
• ce qui fait la valeur proprement morale d’une action ne serait pas tant son résultat que l’intention qui
la dirige. Le caractère bénéfique doit être distingué du caractère moralement bon d’une action.
• Pour être moralement bonne, l’intention doit être donnée et suivie de manière absolument libre, donc
désintéressée : si c’est l’intérêt qui dicte ma conduite, alors celle-ci est amorale (neutre) ou immorale
(mauvaise). Mon intérêt n’est en effet pas partagé par tous, et peut en plus varier suivant le moment.
Mais un devoir moral, lui ne varie pas ainsi.
Pour qu’elle soit désintéressée il faut qu’elle puisse valoir pour tous les sujets, tous les agents moraux.
Mon intention doit donc suivre une règle qui soit universalisable.
• En conséquence, les devoirs moraux n’admettent pas d’exception : ils sont universels.
• Ils imposent des limites absolues à mon action : il y a devoir moral là où il y a, ou s’il y a des êtres
ou des actes qui ont une valeur absolue, que je dois respecter sans condition, même si je ne le désire
pas. Ces choses, ce sont les personnes humaines, soit les êtres doués de libre-arbitre. Un être doué de
volonté libre est une « fin en soi » : elle n’a pas à exister ou à faire quoique ce soit pour autre chose
qu’elle-même, en particulier pour moi. C’est la notion moderne de dignité de la personne humaine.
Nos actions doivent donc suivre des règles respectant la Loi morale connu sous la forme d’un
impératif catégorique (un commandement, un devoir absolu), formulé ainsi :
« agis de telle sorte que la règle de ton action puisse être une loi universelle »
Ou :
« agis de telle sorte que tu traites l’humanité dans ta personne aussi bien que dans la personne de tout
autre toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen »
Ces principes sont des principes de la raison pure : ils ne sont pas du tout tiré de l’expérience, et ont
donc une valeur absolue, universelle, nécessaire. Ainsi la morale peut être indépendante de la variété
des sujets, de la diversité des cultures, etc. Cette morale fonde les droits de l’homme.
Les « choses »
tous les êtres sans libre-arbitre
Les personnes
tous les êtres doués de libre-arbitre
Sous l’angle de la valeur
Valeur extrinsèque
Valeur intrinsèque
valeur relative
Valeur absolue
Valeur finie
Valeur infinie
prix
Dignité

Sous l’angle du rapport moyen / fin
Simple moyen
Fin en soi
Sous l’angle des droits
Objet de droits
Sujet de droits (porteurs de droits)
« Impératifs hypothétiques »
je dois faire x pour y
« Impératif catégorique »
je dois faire x
Propriétés de la règle d’action
Conditionnel
Inconditionnel
Relatif (à une fin désirée)
Absolu (non relatif)
Particulier (propre au sujet)
Universel (s’impose à tous)
Contingent (conditionné par un
désir)
Nécessaire (on ne peut pas ne
pas le faire)
Les capacités du sujet
Raison au service d’un désir
Raison pure
hétéronomie
Autonomie
Les fins de ses actions
Objet ultime possible : le
« bonheur »
Objet : le Bien moral
exemple
je dois être fidèle à mes amis pour
les garder (et être heureux)
Je dois fidélité à mes amis par
respect de leur personne
Limites de l’éthique kantienne
• les hommes n’ont droit au respect qu’en tant qu’être doué de libre-arbitre, et non en tant que
vivant ou être doué de sensibilité.
- Mais les hommes aux aptitudes intellectuelles trop faibles voire nulles n’ont-ils pas de droits ?
- Les animaux n’ont-ils pas de droits
1
?
• problème du caractère inconditionnel des devoirs – Mill, a contrario, souligne : « tous les
moralistes reconnaissent que les devoirs admettent des exceptions ».
• problème des conflits de devoirs, inconcevables pour Kant. Soit une personne qui se réfugie
chez moi alors qu’elle est poursuivie par un assassin. Ce dernier frappe à ma porte et me
demande si j’ai vu le fugitif. Kant soutient que l’on ne doit pas lui mentir (le devoir de
sincérité étant universel et nécessaire) : je ne suis responsable que des effets directs de mon
action, pas des conséquences possibles (ici la mort du fugitif suite à ma déclaration sincère).
C’est pourtant ce dernier point qui est contestable : je suis responsable des conséquences
prévisibles de mon action, comme le soutiennent les utilitaristes. Or, j’ai un devoir de
bienfaisance à l’égard du fugitif
2
. Ici, un critère utilitariste semble plus approprié : le mal
produit par le mensonge est pondéré par le bien très probable produit par l’assistance au
fugitif
• l’idée d’une morale universelle est toujours fragilisée par la diversité des cultures et le
relativisme culturel qu’elle semble impliquer.
- La tradition philosophique distinguait les devoirs d’humanité (ce que l’on doit à tout homme)
et les devoirs de statuts (ce que l’on doit à certains hommes en vertu de notre statut social).
Kant considère surtout les premiers… pourtant les autres ne sont pas universels
- Les devoirs d’humanité eux-mêmes peuvent-ils être considérés comme universels ? La
manière de considérer l’humanité varie d’une culture à l’autre (cf. Lévi-Strauss, Race et
Histoire)
4. L’éthique d’Aristote et ses mérites
1
Kant considère que les animaux n’ont de droits qu’indirects : nous ne devons pas être cruels envers eux parce
que cela les fait souffrir, mais parce que cela développe des vices chez nous que nous pourrions exercer envers
d’autres hommes.
2
Kant l’accepte, mais considère que les interdictions morales comme ne pas mentir l’emportent sur les devoirs
de bienfaisance : les devoirs négatifs (ne pas nuire) sont d’importance supérieurs aux devoirs positifs (faire du
bien)

Les anciens ne mettaient pas l’accent sur la connaissance des règles morales, mais sur les qualités qui
caractérisent une bonne personne : sur les vertus. Aristote suit cette voie.
• L’homme bon est celui qui a développé les vertus personnelles, relatives à ses désirs (tempérance
dans ses désirs du corps), craintes (courage face à la peur), relative à son argent et ses biens
(générosité non excessive), à son amour-propre (estime de soi sans vanité), etc.
• Comment acquérir ces vertus ? Elles s’acquièrent par l’apprentissage. L’éducation prépare le terrain :
un enfant qui n’a jamais appris à contrôler ses désirs deviendra difficilement tempérant. Ensuite, c’est
la personne qui d’elle-même doit accomplir des actes de telle nature pour en contracter l’habitude.
« c'est en jouant de la cithare qu'on devient cithariste ; de même, c'est
en pratiquant les actions justes que nous devenons justes, les actions
modérées que nous devenons modérés, et les actions courageuses que
nous devenons courageux »
On finit par en contracter l’habitus, comme disent les latins, une disposition acquise, voire une
seconde nature.
• mais comment savoir ce qu’il faut faire pour accomplir un acte courageux, concrètement : comment
savoir jusqu’à quel point, avec quelle énergie, jusqu’à quel sacrifice, il faut se battre pour être
courageux ? Comment savoir ce que je dois dire lorsqu’on me félicite pour un acte honorable, afin de
ne faire preuve ni de vanité ni de fausse modestie ?
Ici le modèle de la science est inapproprié, le monde pratique dans lequel nous vivons est fait de
situations singulières, donc ne peut être l’objet que d’opinion (thèse constante d’Aristote).
Pour déterminer notre décision, nous raisonnons, de manière consciente ou non : nous avons estimé la
situation (à qui l’on a affaire, dans quelle circonstance, etc.) et nous avons tranché entre diverses
options possibles : la délibération se conclut par une décision et l’action. Le combattant à estimer le
risque qu’il courait, les forces de l’adversaire, les siennes propres, … et a agis en conséquence. De
même l’homme honoré a estimé le caractère de ses interlocuteurs, etc., et a trouvé le mot adéquate
pour n’être ni prétentieux ni inutilement humble. La « phronesis » ou sagesse pratique
3
est cette vertu
intellectuelle qui nous rend capable d’estimer correctement une situation et les personnes concernées,
et déterminer l’action la plus approprié. Elle nous rend donc capable d’appliquer la règle (« tu ne dois
pas faiblir » ; « tu ne dois pas te vanter », etc) en situation concrète, ou d’atteindre notre fin (le courage,
etc) avec les moyens adéquates.
• Mais parfois, nous hésitons non pas sur la bonne manière d’atteindre telle fin (l’acte courageux, la
modération, etc.) sur quelles fins poursuivre, parmi plusieurs : par exemple, dois-je rester au combat/
au travail, ou dois-je remplir d’autres obligations, comme mes devoirs familiaux ? La concurrence
entre plusieurs fins et les conflits de devoirs ne sont pas du tout exceptionnels : ils sont quotidiens. Ils
sont liés au fait que nous multiplions nos activités, nos relations, et nos statuts (amis, employé,
collègue, père, etc…), sans nous diviser nous-mêmes. Comment être un bon fils, et un bon ami, et un
bon étudiant, etc. ? Certains statuts et obligations qui y sont liées imposent une hiérarchie stricte,
formelle : certaines professions impliquent une priorité sur nos obligations familiales. Mais dans la
plupart des cas, la hiérarchie est variable selon les moments, les situations. Selon Aristote, l’éthique,
comme la politique, est l’art de hiérarchiser mes fins au mieux selon les circonstances (afin de
réussir sa vie, individuelle en éthique, la vie collective de la cité en politique). La phronesis, la sagesse
pratique, est cette qualité intellectuelle qui nous fait choisir les bonnes fins en fonction des bonnes
circonstances.
• C’est une vertu que peuvent partager l’homme privé (vous, moi) et l’homme public (l’homme
politique ou le général, comme Périclès pour Aristote, Napoléon ou De Gaulle pour nous). C’est le
sage qui fournit la mesure de la bonne manière d’agir. Il faut s’inspirer de la manière dont les hommes
sages dans l’action, prudents, vertueux, agissent, s’en servir comme exemple, pour inspirer notre
conduite. L’exemple est plus important que la règle : c’est lui qui donne la règle, comme l’artiste de
génie (Kant, Alain).
3
Le grec ancien dispose de deux mots traductible par « sagesse ». « Sophia » signifie davantage sagesse
théorique (un savoir général des choses les plus importantes). Phronesis signifie chez Aristote puis Épicure la
sagesse pratique : savoir comment bien agir. Les philosophes latins ont traduit prudentia, qui a donné le français
prudence, mais dont le sens moderne est très appauvri.

Conclusion : comment être une bonne personne, une personne juste, généreuse, humble ; indulgente,
etc. ? Il faut faire les actions qui conviennent. Comment savoir celles qui conviennent, celles qui
accomplissent nos devoirs éthiques ?
• la place de la sensibilité
Le cœur, les affects, sont insuffisants : leur « jugement » est subjectif, changeant, relatif. (rationaliste
contre empiriste)
Mais pour être bon, il faut tout de même certaines prédispositions affectives : la nature et l’éducation
doivent préparer la sensibilité : c’est une base sur laquelle le caractère bon va s’enraciner (Aristote).
Nos affects, si nous avons une bonne nature et une bonne éducation, nous orientent déjà vers le bon
type de conduite. De plus, de nombreuses vertus impliquent certains sentiments (par exemple être bon
avec sa famille implique aussi de l’amour). C’est même un devoir moral que de ne pas être trop
« froid » ; trop « insensible » (contre Kant).
Mais le cœur est insuffisant : il faut savoir plus précisément que faire pour bien agir.
• la place des principes rationnels : utilitariste (principe d’utilité) et kantien (impératif catégorique)
Les rationalistes modernes ont cherché à bâtir des théories morales à la manière des mathématiques :
un ou quelques principes qui se précisent ensuite en règles particulières. L’action à accomplir serait
déductible des règles établies par la raison.
L’utilitarisme, fondé sur le principe d’utilité, souligne la nécessité d’évaluer la qualité morale d’une
action en fonction de ses conséquences prévisibles, et insiste sur une de nos fins morales qui sont les
nôtres : le bien collectif des humains, voire de tous les animaux.
La philosophie kantienne, fondée sur l’impératif catégorique, insiste elle sur la valeur de l’intention de
l’acteur, qui dépend selon lui primordialement du respect de toutes personnes humaines. La conduite
doit être voulue de manière purement autonome, libre des désirs intéressés, et avoir pour objet le
respect de l’autonomie des personnes.
Ces deux philosophies modernes répondent toutes deux à certaines de nos valeurs morales centrales,
qui se contredisent parfois dans nos expériences. Aucune ne peut l’emporter absolument sur l’autre.
• la place de la raison (vraiment) pratique. La sagesse pratique (phronesis, Aristote)
Le défaut des philosophies morales modernes est de s’être concentré sur la valeur des règles plutôt que
sur l’importance de la décision et de l’action. Or, l’action est toujours singulière, singularisée par des
circonstances naturelles (lieu, moment, milieu) et sociales (quels interlocuteurs…). La question
centrale est donc celle de la bonne règle ou du bon modèle à suivre dans ce moment particulier, en
sachant que j’ai souvent plusieurs options. L’homme sage (phronimos) est celui qui sait juger les
circonstances de l’action, s’en faire une bonne opinion, sélectionner les bonnes fins, suivre les bonnes
règles, ou savoir s’en écarter lorsqu’il convient.
1
/
5
100%