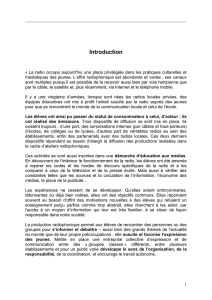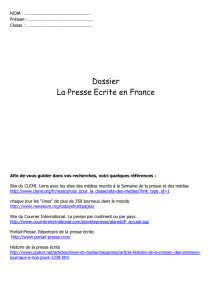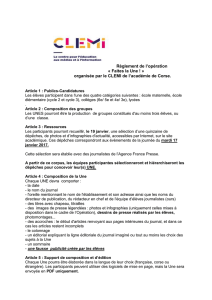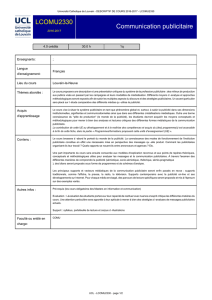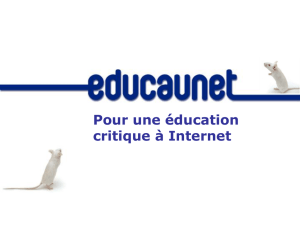p.3

SMOLARSKI Alison N° 5090003
BIEZ-CHARRETON Delphine N° 2042553
Master 1 Sciences de l’éducation
DOSSIER DE COMMUNICATION ET
DES SCIENCES DE L’EDUCATION
L’EDUCATION AUX MEDIAS
Alain GIROD

2
SOMMAIRE
INTRODUCTION ................................................................................................................. p.2
I) QU’EST-CE QUE L’EDUCATION AUX MEDIAS ? .................................................. p.3
A) Les médias ............................................................................................................. p.3
1) Définition ................................................................................................... p.3
2) Alors, de quoi parle-t-on ?.......................................................................... p.3
B) L’éducation aux médias ......................................................................................... p.5
1) Définition ................................................................................................... p.5
2) Les buts de l’éducation aux médias ........................................................... p.6
II) ROLE DE L’ECOLE DANS L’EDUCATION AUX MEDIAS .................................. p.7
A) Comment éduque-t-on aux médias ? ...................................................................... p.7
1) Théorie et pratique ..................................................................................... p.7
2) Approche transversale ................................................................................ p.8
B) Quelques conseils avant d’entreprendre l’éducation aux médias en classe ....... p.10
C) La place du décryptage des messages médiatiques à l’école ............................. p.10
III) PEDAGOGIE ET PRATIQUE .................................................................................. p.11
A) Présentation du terrain ........................................................................................ p.11
B) Séance d’animation ............................................................................................. p.13
1) Objectifs ................................................................................................ p.13
2) Déroulement de l’animation .................................................................. p.13
a) Présentation ............................................................................... p.13
b) Etude de la publicité YAGLOU ................................................ p.14
c) Etude de la publicité CANDIA.................................................. p.18
C) Pistes pédagogiques ............................................................................................ p.20
CONCLUSION ................................................................................................................... p.21
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................. p.22

3
INTRODUCTION
Le travail présenté dans ce dossier est le fruit d’une recherche théorique et
pédagogique reposant sur le rapport entre la communication et les sciences de l’éducation. De
ce fait, nous avons choisi de nous pencher plus particulièrement sur l’éducation aux médias.
Les médias et les jeunes sont un vaste domaine d’interrogations pour un thème
d’actualité qui ne cesse d’interpeller l’école depuis l’introduction, en 1976, de l’utilisation de
la presse comme support pédagogique. La relation aux médias devient donc un phénomène de
société auquel l’école se trouve confrontée, mais peut-elle apporter les réponses et les
solutions permettant aux jeunes de l’appréhender ?
Nous avons choisi d’effectuer ce travail en binôme dans un esprit de complémentarité.
Dans une première partie, nous avons étudié ensemble la partie théorique ayant l’une
comme l’autre peu de notions au sujet des médias.
L’une d’entre nous préparant activement le concours du professorat des écoles (CRPE),
ses connaissances du système éducatif ainsi que des programmes scolaires officiels, du socle
commun des connaissances et des compétences a permis, dans une deuxième partie, de mieux
aborder le rôle de l’école dans l’éducation aux médias .
Enfin, dans une dernière partie, notre complémentarité nous a été fort utile lors de
l’étude de terrain. En effet, la seconde d’entre nous étant diététicienne diplômée d’Etat et
chargée de projet en prévention en matière de nutrition, nous a donné les moyens de faire une
animation relevant de nos deux domaines respectifs tout en introduisant l’éducation aux
médias.

4
I) QU’EST-CE QUE L’EDUCATION AUX MEDIAS ?
A) Les médias
1) Définition
Un « médium » est un moyen, un instrument ou une action qui permettent d’intervenir
si l’on en croit le dictionnaire ou les origines latines du terme. Cela correspond à un support
qui véhicule ou transmet des informations diverses. On utilise un médium lorsque l’on veut
communiquer indirectement avec quelqu’un plutôt qu’en présentiel. Le terme « médias » est
simplement le pluriel de « médium »
1
.
D’après la définition du dictionnaire
2
, les médias se définissent par « tout support de
diffusion de l’information (radio, télévision, presse imprimée, livre, ordinateur, vidéogramme,
satellite de télécommunication…) constituant à la fois un moyen d’expression et un
intermédiaire transmettant un message à l’intention d’un groupe. »
Les médias nous proposent des versions sélectives du monde, et non un accès direct à celui-ci.
Fabrice BARTHELEMY, dans son ouvrage L’école et les médias
3
met en avant que
le terme médias est souvent confondu avec l’expression « médias de masse », cette dernière
signifiant qu’elle touche un public large, dispersé et hétérogène. Certaines formes de
communication plus traditionnelles, comme les livres, sont aussi considérées par certaines
personnes comme des « médias », puisqu’ils nous présentent eux aussi des versions ou des
représentations du monde.
2) Alors, de quoi parle-t-on ?
Les éléments du débat « Construire les médias aujourd’hui » issu de l’ouvrage Jeunes
et médias : éthique, socialisation et représentation du GRREM (Groupe de Recherche sur la
Relation Enfants Médias) sous la direction de Maryvonne MASSELOT-GIRARD
4
nous ont
permis d’identifier les caractéristiques des médias :
Les langages des médias :
Les messages des médias sont souvent complexes et font appel à divers langages tels
que l’image, le son, la couleur, l’éclairage, le mouvement, le cadrage,…
1
UNESCO sous la direction de Frau-Meigs D. (2006). Kit d’éducation aux médias. Paris.
2
Le Petit Larousse Illustré. (1995).
3
Barthélémy F. (2004). L'école et les médias. L’Harmattan. Paris/Budapest/Torino.
4
GRREM (Groupe de recherche sur la relation enfants médias) sous la direction de Masselot-Girard M. (2004)
Jeunes et médias : éthique, socialisation et représentations. L’Harmattan. Paris Budapest Torino.

5
Chacun d’entre eux utilise des codes, des signes, des éléments qui leur sont propres et
qui ont une influence sur le sens que peuvent véhiculer les messages des médias et sur la
manière dont ils sont perçus par le public.
Leurs représentations :
D’après Roland BARTHES : « si les médias étaient des fenêtres ouvertes sur le monde,
s’ils réfléchissaient la réalité, il n’y aurait pas plus d’intérêt à les étudier qu’il n’y en a à
étudier une vitre ».
5
Ainsi, les messages des médias n’apparaissent pas uniquement comme le
reflet de la réalité. Il s’agit de conceptions et d’interprétations de la réalité.
Les représentations des médias deviennent familières et prennent alors la valeur de
reflets neutres, objectifs et naturels de la réalité. Une part importante de ce que nous
apprenons et savons du monde provient des représentations véhiculées par les médias. De ce
fait, leurs représentations construisent notre propre perception de la réalité sans que nous en
prenions pleinement conscience.
Les types de messages
Le GRREM
6
a mis en avant que les documents médiatiques se classent en fonction de
certaines catégories : genre, contenu, fonction (téléroman, dessin animé, téléjournal, page web,
ligne ouverte radiophonique, film d’horreur, documentaire, réclame publicitaire, vidéoclip,
retransmission d’évènements sportifs…). L’appartenance à ces diverses catégories implique
une certaine harmonisation dans la manière de produire, de diffuser, et de percevoir les
messages des médias.
Les publics
Selon Fabrice BARTHELEMY, « les médias segmentent de plus en plus finement les
publics avec des offres ciblées ». Autrement dit, les messages des médias sont produits et
diffusés en fonction du public visé et ce dernier interagit avec les médias. Chaque individu
perçoit, utilise et s’approprie les messages des médias en fonction de caractéristiques
individuelles (sexe, âge,…) mais aussi selon sa culture (son appartenance à un groupe, à une
communauté, une classe sociale,...).
Joël BREE, dans son ouvrage Les enfants, la consommation et le marketing
7
, précise
que la dimension commerciale est aussi importante dans la façon dont sont constitués les
publics des médias. Les médias cherchent en effet la plupart du temps à toucher le maximum
de monde afin d’assurer la rentabilité de leur activité.
5
Barthes R. (1957). Mythologies. Seuil.
6
GRREM (Groupe de recherche sur la relation enfants médias) sous la direction de Masselot-Girard M. (2004)
Jeunes et médias : éthique, socialisation et représentations. L’Harmattan. Paris Budapest Torino
7
Bree J. (1993). Les enfants, la consommation et le marketing. Gestion presses universitaires de France
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%