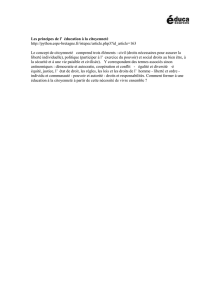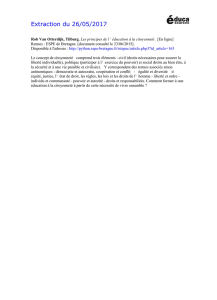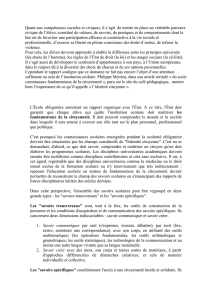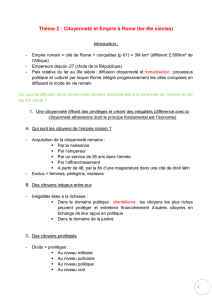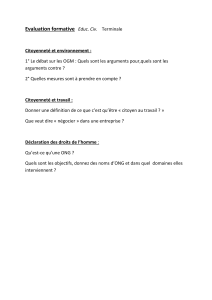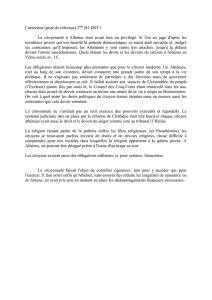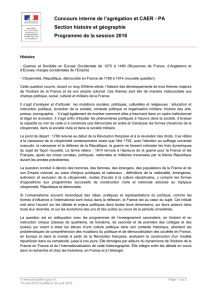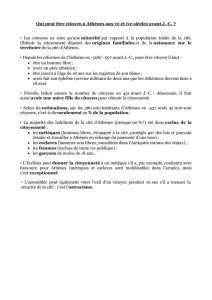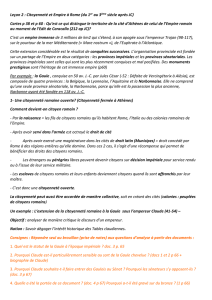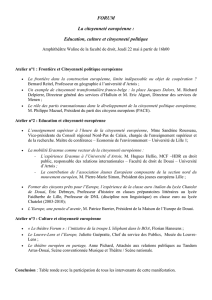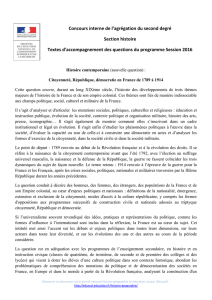Athènes Rome

Corrigé évaluation
Dans l’Antiquité, Athènes au Vème siècle av. JC et l’empire romain (Ier – IIIème siècle) présentent deux
conceptions différentes de la citoyenneté. Ces différences tiennent essentiellement à la place qui est
attribuée aux citoyens dans la vie politique.
En quoi Athènes et Rome développent deux conceptions différentes de la citoyenneté ?
Athènes
Rome
Qui est
citoyen ? Qui
est exclu de
la
citoyenneté ?
A Athènes on nait citoyen.
La citoyenneté est acquise à la naissance
si :
- Les deux parents sont athéniens
- Inscription au dème
- Après éphébie
Cas particulier des femmes (citoyenne
sans droit)
Pas de promotion possible. Les exclus
(esclaves et métèques) ne peuvent
accéder à la citoyenneté en aucun cas.
Droit qui se restreint avec la loi de 451.
Mais possibilité d’être exclu (ostracisme)
On nait citoyen si on est fils légitime de
citoyens romains.
Sont exclus : esclaves et pérégrins.
On peut accéder à la citoyenneté si :
- On a fait un service de 25 ans dans
l’armée romaine
- On est magistrat d’une cité de
droit latin
- Si on est un esclave affranchi d’un
citoyen romain.
- Sur décision impériale.
La citoyenneté est une récompense.
La citoyenneté est accordée de plus en plus
largement aux habitants de l’empire :
- 48 : l’empereur Claude accorde la
citoyenneté complète aux
magistrats des cités latines
- 212 : l’empereur Caracalla
accorde la citoyenneté à tous les
hommes libres de l’empire.
Quel est le
rôle des
citoyens ?
Dans la démocratie athénienne :
Les citoyens disposent de nombreux droits
et devoirs.
Droits : participation à la vie politique :
- Présence à l’écclesia (vote des
lois, participation aux débats,
proposition de lois…
- Exercice de magistrature si
tirage au sort ( à l’Héliée) ou
élection (stratège)
- De propriété
Devoirs :
- Défense de la cité
- Liturgies
- Participation aux manifestations
religieuses
Dans l’empire romain :
La citoyenneté est un statut, un privilège qui
n’apporte que peu de droits :
- Pas de droits politiques (les
assemblées ont perdu leur pouvoir
sous l’empire)
- Des droits juridiques (droit romaine
et droit de recours auprès de
l’empereur)
- Droit de propriété
- Cursus honorum
Des devoirs :
- Servir dans la légion (mais certains
y échappent)
- Participer au culte impérial
conclusion
Citoyenneté restreinte car liée à
d’importants droits politiques (démocratie
directe)
Citoyenneté limités au cadre restreint de la
cité.
Citoyenneté fondée sur le droit du sang
Citoyenneté ouverte et largement offerte mais
vidée de tout contenu politique.
Citoyenneté dans le cadre d’un immense
empire. La citoyenneté est un outil et une des
conséquences de la romanisation.
Facteur de stabilité et de pérennité de
l’empire
1
/
1
100%