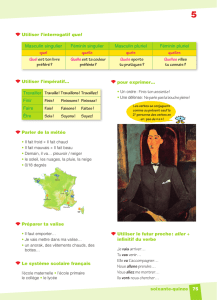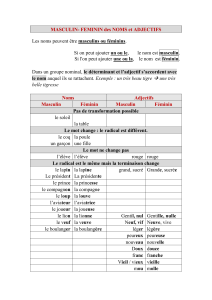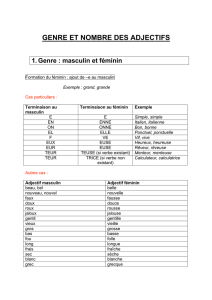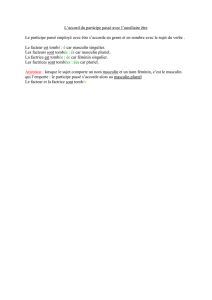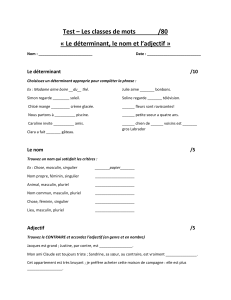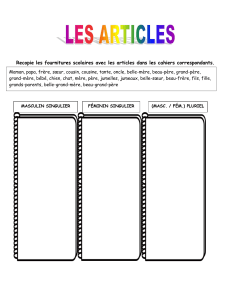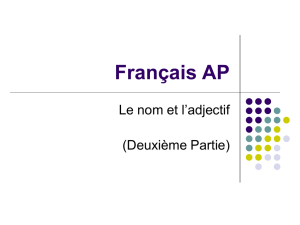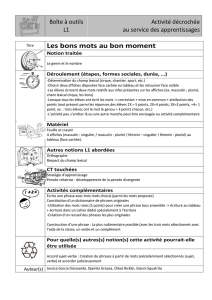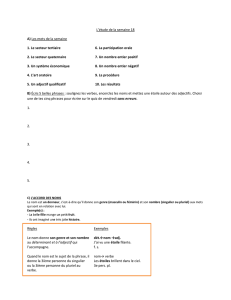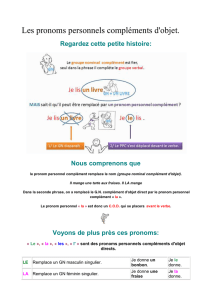Les adjectifs qualificatifs

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005
Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 1 sur 8
MAITRISE DE LA LANGUE AU CYCLE 3
Le verbe et le nom dans la phrase et dans le texte
Le nom (grammaire, orthographe)
Les adjectifs qualificatifs
informations pour le maître
L’objectif n’est pas de construire et faire réciter une définition de l’adjectif et un tableau des différents types d’adjectifs (qualificatifs -
épithètes, attributs - démonstratifs, possessifs.) mais de travailler,
- du point de vue grammatical, sur les limites du groupe du nom (sujet ou complément du verbe) en voyant les différentes
formes d’expansion du nom (adjectif qualificatif, relative, complément du nom) ;
- du point de vue orthographique, sur les chaînes d’accord dans le groupe nominal , l’adjectif donnant l’occasion de
traiter les marques du genre (masculin/féminin) en plus des marques du nombre (singulier/pluriel) ;
- et, évidemment, du point de vue du sens, sur la distinction entre le nom seul et le nom accompagné d’une expansion et la
distinction entre la caractérisation par les procédés cités plus haut ( une pomme bien mûre, les pommes que j’ai cueillies,
les pommes des pommiers de tante Adèle) et les expressions figées (une pomme de terre) qu’il faut considérer comme
une seule unité lexicale (un nom).
1) Avec les adjectifs, on est dans le groupe du nom et dans les procédés de qualification (comparer : une pomme rouge ; une
pomme qui est de couleur rouge ; une pomme de couleur rouge).
On ne fera pas de distinction byzantine entre épithète et attribut (ces notions ne sont pas au programme) mais il faudra bien traiter le
cas des « verbes d’état » qui ne sont pas des « verbes » au sens strict. Dire « le gentil petit garçon » ou « le petit garçon est gentil »
revient au même, « gentil » qualifie toujours « garçon » comme « petit », la place de l’adjectif et l’intercalation du verbe « être » ne
changent rien et on pourrait dire aussi « c’est un gentil petit garçon ».
2) Du point de vue orthographique, les adjectifs participent à la chaîne d’accords en genre et en nombre dans le groupe du nom.
Comme on a déjà traité de l’accord en nombre dans la phrase et des signaux du pluriel et du singulier, on traitera ici surtout les
problèmes de l’accord en genre. Contrairement aux manuels traditionnels, il ne s’agira pas de « mettre au féminin » mais de
repérer les signaux du masculin et du féminin (déterminants, noms, adjectifs) qui ne se trouvent que dans le groupe du nom (qui
peut être sujet ou complément) : le verbe n’est pas concerné. On travaillera autant à l’oral qu’à l’écrit (voir le travail de tri sur les
formes orales et écrites). On traitera la notion de genre pour les noms et les adjectifs simultanément ou de manière très
rapprochée.
On traitera l’accord des participes (passé ou présent) avec celui des adjectifs qualificatifs puisqu’ils ont une fonction adjective et
servent aussi à qualifier le nom. En effet, qui peut faire la différence (et à quoi cela servirait-il ?) entre : un air chagrin ; une mine
chagrinée ; il semble chagrin ; elle est chagrinée ; une situation affligeante ; c’est affligeant ?
Comme à chaque fois qu’on traite de problèmes orthographiques, la conception qui est celle des manuels (une leçon ou deux chaque
année sur le sujet) ne semble pas opératoire : les travaux en observation réfléchie de la langue seront relayés par des entraînements en
atelier de lecture-écriture, par des remarques à l’occasion des lectures ou des rédactions dans toutes les disciplines. Ils donneront lieu
à la construction d’outils sous forme de listes analogiques (qui seront préférées aux règles suivies de listes d’exception) ; elles seront
utilisées et complétées tout au long des trois années du cycle. On ne peut donc pas donner le schéma d’une séquence sur les
adjectifs mais on peut tenter d’établir des domaines à traiter sur les trois années du cycle 3, le domaine orthographique étant à
travailler et retravailler plusieurs fois . Chaque maître organisera son travail sur l’année en fonction des activités dans les différentes
disciplines et le conseil des maîtres s’engagera à reprendre et compléter en CM1 et CM2 ce qui aura été fait en CE2.
En vocabulaire et orthographe lexicale, les adjectifs pourront prendre place évidemment dans les familles de mots et particulièrement
dans l’étude de certains suffixes caractérisant l’opposition masculin-féminin et de certains préfixes plus utilisés pour les adjectifs que
pour les verbes ou les noms (exemple : les mots de sens contraire commençant par in-, il-, im-, ir).
3) Les adjectifs feront aussi l’objet d’un travail important quand on établira le lexique propre à chaque discipline ; ils seront en
particulier mis en évidence à chaque fois qu’on aura à lire ou à produire une description (portrait d’un personnage réel en
histoire ou de fiction en littérature ; description et comparaison de paysages en géographie ; description d’un être vivant, d’un
objet, d’une matière…en sciences et technologie ; description d’une figure en géométrie…). Il sera intéressant de travailler au
cours du cycle la différence entre la caractérisation par les différents procédés (adjectifs qualificatifs, relatives, compléments de
nom) et la définition, en rapport avec la distinction entre les noms simples et les noms composés ou expressions figées (comparer
une voie fréquentée et une voie ferrée fréquentée).

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005
Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 2 sur 8
Essai de liste des activités sur les adjectifs
Programmation sur l’orthographe
Dans les différentes
disciplines
En atelier de
lecture-écriture
En observation réfléchie de la langue
1
Les marques
et les signaux
du nombre
(voir
document
spécifique)
Utiliser les textes lus
ou écrits pour
trouver les signaux
du singulier ou du
pluriel ; pour
enrichir la liste des
verbes d’état ; pour
bien comprendre la
différence entre la
notion de pluralité et
le pluriel
grammatical
S’entraîner à
repérer
automatiquement
les signaux du
singulier ou du
pluriel à l’oral ;
faire des
hypothèses sur les
marques à l’écrit :
dictée commentée
ou atelier de
négociation
graphique
(voir document
spécifique)
A travailler d’abord sur des phrases à ordre syntaxique régulier (« des
roses jaunes embaument le salon ») puis sur des groupe du nom.
On aura intérêt à choisir des adjectifs du groupe 1 (voir plus loin) car
ce sont les plus nombreux en français il sont invariables en genre, ce
qui permet dans un premier temps de se centrer sur le problème du
nombre.
Traiter du verbe être et le séparer nettement des autres verbes pour
montrer l’égalité entre « les côtés égaux » et « les côtés sont égaux » ;
commencer une liste des verbes d’état
2
Les marques
et les signaux
du genre
Utiliser les textes lus
ou écrits pour
trouver les signaux
du féminin ou du
masculin et pour
enrichir les listes ; et
pour bien
comprendre la
différence entre la
notion de sexe et le
genre grammatical
S’entraîner à
repérer
automatiquement
les signaux du
féminin ou du
masculin à l’oral ;
faire des
hypothèses sur les
marques à l’écrit :
dictée commentée
ou atelier de
négociation
graphique
(voir document
spécifique)
Le genre ne concerne pas la phrase mais le groupe du nom seul (seuls
les participes passés ont une marque de genre avec les verbes d’état et
on les traite comme des adjectifs).
Traiter d’abord du nom au singulier avec un déterminant marqué en
genre (un/une ; le/la).
Traiter ensuite du groupe du nom avec adjectif(s).
Remarquer qu’il y a des adjectifs qui varient en genre et d’autres qui ne
varient pas, à l’oral, à l’écrit.
3
Les variations
de l’adjectif à
l’oral et à
l’écrit en
genre et en
nombre
(voir listes
plus loin)
Utiliser les textes lus
ou écrits pour
enrichir les listes
S’entraîner à faire
la différence entre
oral et écrit
Constater que les adjectifs combinent marque du genre et marque du
nombre.
Classer les adjectifs en cinq groupes :
Groupe 1 : 1 forme orale ; 2 formes écrites (jaune)
Groupe 2 : 1 forme orale ; 4 formes écrites (noir)
Groupe 3 : 2 formes orales ; 3 formes écrites (heureux)
Groupe 4 : 2 formes orales ; 4 formes écrites (grand)
Groupe 5 : 2 formes orales et 4 formes écrites (amical) mais les deux
formes orales séparent le singulier et le pluriel au genre masculin (alors
que dans le groupe 4 les deux formes orales distinctes concernent le
singulier masculin et féminin).
Dans chaque groupe, tenter de trouver des régularités.

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005
Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 3 sur 8
3 (suite)
Les variations
de l’adjectif à
l’oral et à
l’écrit
Préparer des listes de
vocabulaire
thématique pour
rédiger un portrait,
une description en
faisant varier
nombre et genre
Ecrire des textes
courts par
imitation, en
particulier des
descriptions par
énumération
(voir document
spécifique)
Utiliser des listes thématiques existantes
ex. : pour les descriptions : « Vocabulaire junior » le Robert et Nathan
Transformer à l’oral et à l’écrit un groupe du nom en passant :
- du singulier au pluriel et inversement ;
- du masculin au féminin et inversement.
ex. : une chevelure blonde ; des cheveux blonds
un visage souriant ; une figure souriante
un œil vif ; des yeux vifs
une bouche charnue ; des lèvres charnues…
Faire le rapprochement avec les groupes précédents qu’on construira en
parallèle.
Liste d’autres activités sur les adjectifs
Les adjectifs
dans les
familles de
mots
Les procédés
de dérivation
Utiliser les textes lus
ou écrits pour
enrichir les familles
Transformer des
phrases
En vocabulaire et orthographe lexicale :
- retrouver les adjectifs dans les familles de mots construites ;
- travailler sur les affixes
- pour trouver les contraires (ex. : honnête malhonnête ;
mangeable immangeable…) ;
- pour passer du nom à l’adjectif (commerce
commercial) ;
- pour passer du verbe à l’adjectif (démonter
démontable) ;
- pour passer du féminin au masculin (moteur motrice)
…
Le groupe du
nom dans la
phrase
Les divers
procédés de
qualification
Utiliser les textes lus
ou écrits
Repérer les
expressions figées et
les mots composés
dans le lexique
thématique de
chaque discipline
Dans des
dictionnaires ,
chercher dans les
entrées si les noms
composés et
expressions figées
qui font l’objet
d’une définition
ont leur propre
entrée (chêne-
liège ; poids lourd)
ou sont traités dans
l’article du nom
principal (chemise
de nuit dans
chemise)
En ce qui concerne le partie 1 du programme d’ORL ( le verbe et le
nom dans la phrase et dans le texte) : repérer des groupes du nom dans
la phrase (sujet ou complément du verbe) ; retrouver le ou les noms
dans chaque groupe ; examiner ce qui les qualifient.
Répertorier, comparer les procédés de qualification (adjectifs
qualificatifs, relative, complément de nom) qui fonctionnent en
expansion du nom.
Traiter parallèlement, dans la partie 3 du programme ( vocabulaire et
orthographe lexicale), mots composés et expressions figées à traiter
orthographiquement comme des noms simples :
- des pommes rouges ou jaunes
- des pomme de terre rouges ou jaunes
- un golf bien aménagé
- un golf miniature bien aménagé
Etablir des listes d’expressions figées et de mots composés en fonction
de leur composition (nom+ nom ; nom+adjectif ; nom+complément de
nom ; infinitif+infinitif…
La fonction
adjectif et les
diverses
fonctions
Repérer des mots qui
ont plusieurs
fonctions possibles
dans la phrase
Prendre conscience qu’un même mot peut avoir diverses fonctions
selon les circonstances
ex : une ligne droite (adjectif) ; une droite (nom) ; marcher droit
(adverbe).
En relation avec l’étude du verbe, distinguer par le sens et
l’orthographe les participes qui ont une fonction de verbe et ceux qui
ont une fonction d’adjectif.

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005
Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 4 sur 8
Tableau des cinq groupes d’adjectifs
Au maximum, on peut trouver quatre formes distinctes (masculin singulier – masculin pluriel – féminin singulier – féminin pluriel)
Sur un corpus d’adjectifs, trions en fonction du nombre de formes entendues à l’oral et vues à l’écrit
1 - groupe de ceux qui n’ont qu’une seule forme à l’oral et deux formes à l’écrit (singulier et pluriel)
jaune jaune jaunes jaunes
abominable abominable abominables abominables
acceptable acceptable acceptables acceptables
accessible accessible accessibles accessibles
acide acide acides acides
admirable admirable admirables admirables
adulte adulte adultes adultes
etc.
(ils sont notés ASIG dans EOLE)
on constate - qu’à l’oral on ne distingue ni le genre, ni le nombre qui sont donnés par les autres mots du groupe
(déterminant et/ou nom) ;
- qu’à l’écrit ils n’ont pas de marque de genre : ils se terminent par un « e » au singulier et on les utilise
avec des noms masculin ou féminin sans variation (bien noter que le « e » n’est pas la signature du
féminin !) ;
- qu’ à l’écrit ils varient de la même façon en nombre (pluriel avec un « s » ; singulier sans « s »).
2 - groupe de ceux qui n’ont qu’une seule forme orale mais les quatre formes écrites
noir noire noirs noires
abattu abattue abattus abattues
aboli abolie abolis abolies
abonné abonnée abonnés abonnées
abrupt abrupte abrupts abruptes
accidentel accidentelle accidentel accidentelles
actuel actuelle actuels actuelles
amer amère amers amères
exact exacte exacts exactes
etc.
on constate - qu’à l’oral on ne distingue ni le genre, ni le nombre qui sont donnés par les autres mots du groupe
(déterminant et/ou nom) ;
- qu’à l’écrit ils constituent deux groupes en ce qui concerne les marques du genre :
1) ceux qui se terminent par un son voyelle qui s’écrit par une voyelle finale au masculin et par cette
voyelle+e muet au féminin : abattu abattue
aboli abolie
abonné abonnée
2) ceux qui se terminent par un son consonne qui s’écrit avec une consonne finale (qui s’entend) au
masculin et par cette consonne+e muet au féminin (avec le doublement de cette consonne pour
certaines terminaisons ou l’adjonction d’un accent) :
abrupt abrupte accidentel accidentelle amer amère
exact exacte actuel actuelle
- qu’à l’écrit, ils varient tous de la même façon en nombre (pluriel avec un « s » ; singulier sans « s »).

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005
Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 5 sur 8
3 - groupe de ceux qui ont deux formes orales (masculin et féminin) et trois formes écrites différentes :
heureux heureuse heureux heureuses
acquis acquis acquis acquises
bas basse bas basses
confus confuse confus confuses
dissous dissoute dissous dissoutes
doux douce doux douces
faux fausse faux fausses
vieux vieille vieux vieilles
etc.
on constate - qu’à l’oral on distingue le genre (son voyelle au masculin ; [z] ou [s] ou [t]au féminin) mais pas le nombre
qui est donné par les autres mots du groupe (déterminant et/ou nom) ;
- qu’à l’écrit le masculin se termine par -s ou -x et ne varie pas entre singulier et pluriel .
4 - groupe de ceux qui ont deux formes orales (masculin et féminin) et quatre formes écrites :
grand grande grands grandes
abusif abusive abusifs abusives
accablant accablante accablants accablantes
actif active actifs actives
adoptif adoptive adoptifs adoptives
adroit adroite adroits adroites
aérien aérienne aériens aériennes
africain africaine africains africaines
allemand allemande allemands allemandes
alpin alpine alpins alpines
beau belle beaux belles
boudeur boudeuse boudeurs boudeuses
bref brève brefs brèves
brun brune bruns brunes
complet complète complets complètes
dévastateur dévastatrice dévastateurs dévastatrices
fin fine fins fines
gentil gentille gentils gentilles
moteur motrice moteurs motrices
muet muette muets muettes
neuf neuve neufs neuves
sec sèche secs sèches
etc.
on constate qu’on peut faire quatre sous groupes :
1) grand/grande
à l’oral, le masculin se termine par un son-voyelle et le féminin par ce son voyelle+un son-consonne ;
à l’écrit, le masculin se termine par une consonne muette ; le féminin se termine par cette consonne+e,
ce qui explique qu’on entende le son consonne en finale
2) brun/brune ; fin/fine ; entier/entière
à l’oral, le masculin se termine par un son-voyelle et le féminin par un son-consonne avec un
changement du son-voyelle qui précède ;
à l’écrit, le masculin se termine par la lettre consonne qu’on entend sonner au féminin .
3) actif/active ; neuf/ neuve
le son en finale est [f] au masculin et [v], écrit -ve, au féminin
4) dévastateur/dévastatrice ; boudeur/boudeuse ; beau/belle ;
à l’oral, on entend une son en finale au masculin et un autre très différent au féminin ; évidemment les
terminaisons à l’écrit sont très différentes ; on peut constituer les séries par suffixe, comme pour les
noms :
-eur –euse -eau/-elle
-teur/-trice -il/ille
-teur/-teresse -er/-ère
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%