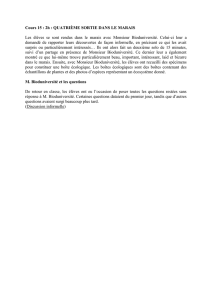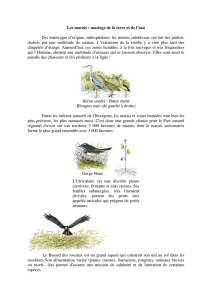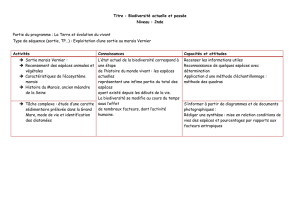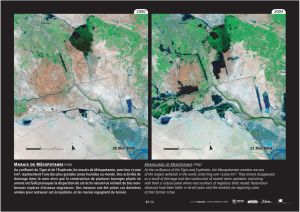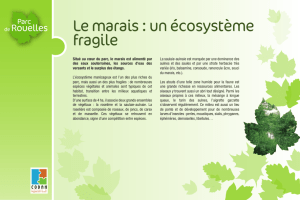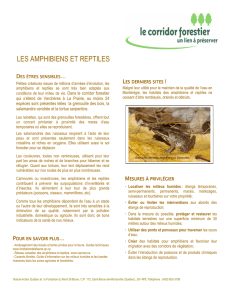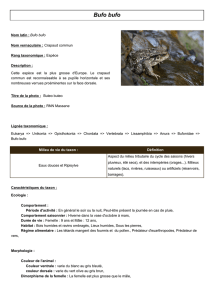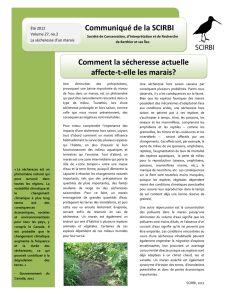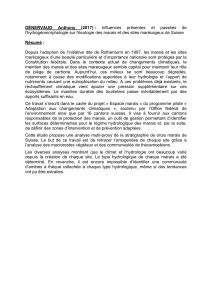téléchargement format doc

1
Sébastien Baratte mai 2000
Mathieu Legros
Stage TER
Elaboration et application d’un protocole
d’échantillonnage des Amphibiens sur les sites
restaurés du marais de Lavours en l’an 2000
Maître de stage : M. Fabrice Darinot ,
Entente Internationale de Démoustication ; Chindrieux (Savoie)
Directeur : M. Raymond Gruffaz.
Tuteur : M. Pierre Joly.
MAITRISE DE BIOLOGIE DES POPULATIONS ET DES ECOSYSTEMES
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

2
SOMMAIRE ET INDEX DES ILLUSTRATIONS
Introduction (tableau 1) ............................................................ 3
Matériel et Méthodes ........................................................... 4
1. Standardisation des sites d’étude ............................................................... 4
Les sites et la diversité des milieux du marais de Lavours (tableau 2) ....... 4
Les sites et les opérations de restauration .................................................. 5
Les sites et les contraintes expérimentales .................................................. 5
2. Standardisation de la méthode de recensement........................................ 5
Première visite ............................................................................................. 6
Deuxième visite ............................................................................................ 7
Troisième visite ............................................................................................ 7
3. Standardisation du traitement des données .............................................. 8
Pour les Anoures (tableau 3) ...................................................................... 8
Pour les Urodèles (tableau 4) ..................................................................... 9
Résultats .......................................................................... 10
1. Résultats sur le Site 1 ................................................................................ 10
Choix des zones d’étude ............................................................................ 10
Recensement (tableau 5) ............................................................................ 10
Plan du site 1 (figure 1) ............................................................................. 10
2. Résultats sur le Site 2 ................................................................................ 11
Choix des zones d’étude ............................................................................ 11
Recensement (tableau 6) ............................................................................ 11
Plan du site 2 (figure 2) ............................................................................. 11
3. Résultats sur le Site 3 ................................................................................ 12
Choix des zones d’étude ............................................................................ 12
Recensement (tableau 7) ............................................................................ 12
Plan du site 3 (figure 3) ............................................................................. 12
4. Résultats sur le Site 4 ................................................................................ 12
Choix des zones d’étude ........................................................................... 12
Recensement (tableau 8) ........................................................................... 13
Plan du site 4 (figure 4) ............................................................................ 13
5. Approche de terrain .................................................................................. 13
Discussion ........................................................................ 14
1. Composition du peuplement du marais de Lavours : année 2000
(tableau 9) .............................................................................................................. 14
2. Evolution des peuplements de 1997 à 2000 (tableau 10) ............................. 14
Le cas des espèces n’ayant pas été recensées sur le marais ...................... 15
Le cas des espèces en augmentation ........................................................... 15
Le cas des espèces en disparition ............................................................... 16
3. Effets de la restauration ............................................................................ 18
Site 1 ........................................................................................................... 18
Site 2 ........................................................................................................... 18
Sites 3 et 4 ................................................................................................... 18
4. Perspectives ................................................................................................ 19
Bibliographie ..................................................................... 20

3
INTRODUCTION
Situé à 80 kilomètres en amont de Lyon, au cœur d’un des secteurs de tressage fluvial de
la vallée alluviale du Rhône, le marais de Lavours constitue une des dernières grandes zones
humides de la vallée médiorhôdanienne. A une altitude de 230 mètres, cet ancien lac post-
glaciaire se compose actuellement d’une dépression tourbeuse encadrée à l’est par le bourrelet
alluvionnaire du Rhône, et à l’ouest par celui d’un affluent du Rhône, le Séran (Joly, 1992, A).
Soumise à la fois aux influences climatiques océaniques et continentales, aux perturbations
entraînées par les crues périodiques du Rhône et de ses affluents, à la dynamique des eaux de
résurgences issues des montagnes environnantes, la réserve naturelle nationale est naturellement
propice aux peuplements des amphibiens qui, pour leur reproduction, préfèrent les sites engagés
dans des processus de successions écologiques rapides vers l’atterrissement (Joly et Morand,
1997).
D’après l’atlas national de répartition des Amphibiens et des Reptiles (Castanet et
Guyétant, 1989), la région compte potentiellement 15 espèces d’Amphibiens dont l’aire de
répartition recouvre la réserve naturelle de Lavours (tableau 1).
Salamandridés
Bufonidés
Ranidés
Salamandra salamandra
Triturus helveticus
Triturus vulgaris
Triturus alpestris
Triturus cristatus
Bufo bufo
Bufo calamita
Discoglossidés
Bombina variegata
Alytes obstetricans
Rana temporaria
Rana dalmatina
Rana esculenta
Rana lessonae
Rana ridibunda
Pélobatidés
Pelodytes punctatus
Hylidés
Hyla arborea
Tableau 1 : Liste des espèces d’amphibiens susceptibles d’être présentes sur les sites du Marais de Lavours.
Néanmoins, les perturbations hydrologiques provoquées par les travaux de drainage et
d’endiguement du Rhône ont accéléré les processus d’atterrissement et d’expansion du
boisement, entraînant la disparition des sites de reproduction et, en conséquence, une baisse de la
diversité de la batrachofaune. Afin de contrer ce phénomène, des opérations de restauration de
sites et de suivi à moyen et long terme ont été mises en place en 1995 sur la Réserve Nord dans le
cadre du Programme de Préservation des Zones Humides. Suite à des recensements effectués

4
avant restauration (Joly, 1992, A) et après restauration en 1997 (Fleurance et al., 1999), notre
étude poursuit ces investigations batrachologiques avec les objectifs suivants :
suivre l’évolution des populations des sites restaurés depuis le recensement de 1997 ;
évaluer l’impact de la restauration, 5 ans après, sur la faune amphibienne ;
fournir une méthode d’approche standardisée permettant de suivre à long terme et à
moindre frais les peuplements d’Amphibiens du marais ;
apporter des éléments pour la gestion des zones humides de Lavours.
MATERIEL ET METHODES
1. Standardisation des sites d’étude
Les sites et la diversité des milieux du marais de Lavours
En 1995, 5 sites ont été restaurés, suite à leur atterrissement ou suite à la fin de l’exploitation
de la tourbe. Cette restauration a consisté en un rajeunissement des sites par adoucissement des
pentes, surcreusement ou élargissement, dans le but de recréer un gradient de profondeur d’eau
favorable au développement de ceintures de végétation et d’enclencher ainsi une nouvelle phase
de succession écologique. Les 4 sites étudiés en 1997 et reconduits dans la présente étude
(localisés sur le plan situé en Annexe 1), ont été sélectionnés pour être représentatifs de la
mosaïque des milieux qui composent le marais de Lavours (tableau 2).
Substrat
Environnement
Durée de mise en eau
Origine principale de l’eau
Tourbe
Ouvert
Permanent
Nappe phréatique
Site 3
Site 4
Alluvions
Semi-ouvert
Le Mergeais (rivière)
Site 1
Fermé
Semi-permanent
Crues annuelles du Séran
Site 2
Tableau 2 : Caractéristiques principales et discriminantes des sites d’étude du marais de Lavours.
Environnement : degré d’ouverture de la zone terrestre arborescente ; Durée de mise en eau : stabilité du milieu
aquatique ; Origine principale de l’eau : il est à noter que, pour chacun des sites, les précipitations et les crues
annuelles (Séran et Mergeais) et décennales (Rhône) constituent un apport secondaire, responsable de la
présence de poissons. De plus, la tourbière se caractérise par un affleurement permanent de la nappe phréatique à
sa surface

5
Les sites et les opérations de restauration
Site 1 : l’étang des Rousses, plan d’eau naturel d’une superficie de 1,5 ha, est alimenté en
permanence par un canal le reliant à la rivière Le Mergeais. Sa profondeur moyenne est de 1
mètre et ses berges sont dégagées de tout couvert végétal. Sa restauration a consisté à creuser
trois petites mares, peu profondes, d’environ 10 m de diamètre sur ses berges ouest (figure 1, p.
10).
Site 2 : ancien bras mort du Séran dont la restauration a consisté, outre la création de trois
petites mares satellites, en un surcreusement et un élargissement de l’extrémité amont, aménagé
en pentes douces (figure 2, p. 11).
Site 3 : au centre de la dépression tourbeuse, trois petites mares peu profondes ont été
creusées, deux en milieu pâturé et une en milieu non pâturé (figure 3, p. 12).
Site 4 : à l’extrémité nord de la réserve, au pied de la montagne du Grand Colombier,
d’anciennes fosses d’exploitation de tourbe de Culoz ont été recreusées de façon à créer deux
étangs aux pentes adoucies et d’une profondeur ne dépassant pas un mètre (figure 4, p. 13).
Les sites et les contraintes expérimentales
Dans l’optique d’établir un protocole d’étude standardisé et optimisé, il nous a semblé
important de satisfaire sur chacun des sites aux objectifs suivants :
rechercher, pour chaque site restauré étudié, des sites de référence pertinents, afin
d’évaluer et de discuter précisément de l’impact des efforts de restauration ;
maximiser la reproductibilité des efforts de terrain (repérage des zones d’étude,
recensement sur des longueurs de berges identiques, mise en place, pour chaque site,
d’une fiche de terrain favorisant l’archivage et le suivi temporel des sites), afin de faciliter
la réalisation de comparaisons spatio-temporelles rigoureuses;
expliciter au maximum le protocole utilisé dans notre approche pour faciliter sa
compréhension, sa transmission, mais aussi sa remise en cause éventuelle.
2. Standardisation de la méthode de recensement
Il n’existe pas de méthode standardisée d’étude de la batrachofaune, néanmoins il nous a
semblé nécessaire de mettre en place un échantillonnage standardisé qui permettrait, au moins sur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%