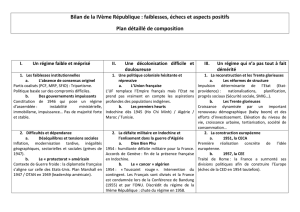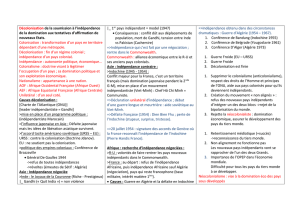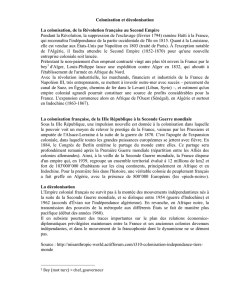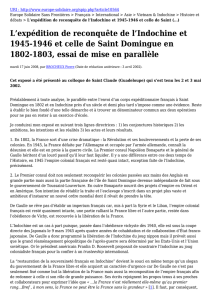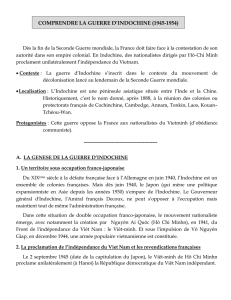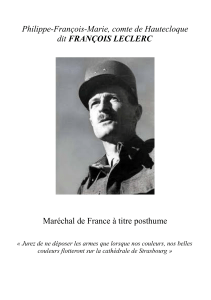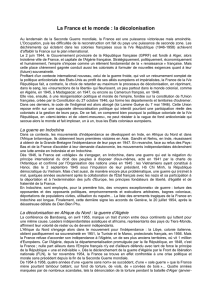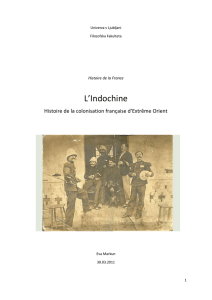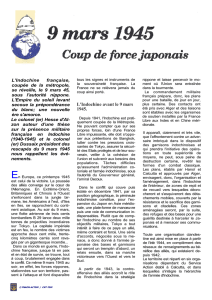Le patronat français et la guerre d`IC

Le patronat français et la Guerre d’Indochine
Hugues Tertrais, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Depuis la fin du XIXe siècle, les milieux d’affaires français manifestent un intérêt
conquérant à l’égard de l’Asie orientale, centré sur l’Indochine mais pas seulement :
les concessions française en Chine, en particulier celle de Shanghai, y ajoutent leur
réseau comme, sur un mode plus traditionnel, les cinq comptoirs conservés en Inde
1
.
Les outils mis en place – la Banque de l’Indochine est fondée à Saigon en 1875 – et les
investissements consentis, dans les mines du Tonkin ou la culture de l’hévéa en
Cochinchine, illustrent un esprit d’entreprise toujours à l’initiative. Après le second
conflit mondial, cependant, de la Guerre d’Indochine ressort un comportement
pratiquement inverse de ces mêmes milieux d’affaires. Dans ce nouveau contexte, la
problématique est en effet bien différente : l’Indochine ne « rapporte » plus, si tant
est qu’elle l’ai jamais fait, mais surtout la guerre menée pour s’y maintenir apparaît
vite ruineuse pour l’économie nationale ; à défaut de dominer la situation, le patronat
français doit alors se déterminer, voire prôner le désengagement
2
.
Sans doute faut-il d’abord répondre à une question traditionnelle : la guerre
d’Indochine s’est-elle déclenchée pour défendre des intérêts économiques ? Ceux-ci
n’en sont certes pas absents, en particulier le caoutchouc : au début de la guerre, une
certaine dose d’illusion impériale est même entretenue à son propos, et des deux
côtés. Le Viet Minh, du moins dans sa propagande, paraît fidèle à l’idée que le profit
capitaliste explique l’acharnement français ; un tract distribué dans une plantation de
Loc Ninh en juin 1947 l’affirme : « Tant que les plantations d’hévéa existeront la
guerre se poursuivra, aussi nous faut-il les détruire. »
3
Marius Moutet, ministre de la
France d’outre-mer, n’écrit pas autre chose en août de la même année : « La
conservation des plantations d’hévéa d’Indochine est primordiale non seulement
pour l’économie française mais encore pour l’économie de l’Indochine. »
4
François
Bloch-Lainé, conseiller financier de l’amiral Thierry d’Argenlieu, premier haut-
commissaire français dépêché sur les lieux, s’était d’ailleurs empressé,dès la fin de
1945,de récupérer la production de caoutchouc du temps de guerre, elle-même
sécurisée pendant le conflit par le gouverneur général Decoux
5
.
Ces intérêts paraissent être cependant vite passés au second plan : la France est
plutôt dans une logique de reconquête et l’esprit économique impérial ne s’y retrouve
pas. Le patronat, dont cela pouvait sembler être l’intérêt, a-t-il néanmoins contribué
au financement de la guerre ? Pas plus, même si l’idée exista « d’étudier dans quelles
conditions les bénéfices réalisés par les Français en Indochine, du fait des
circonstances, pourraient concourir au financement de nos dépenses militaires »
6
: le
financement de la guerre reste principalement budgétaire. Il faudrait mieux,
1
Le Comité de l’Asie française, qui publie un Bulletin du même nom, est fondé en 1901 sous
la direction d’Eugène Etienne.
2
Une partie des éléments utilisés dans cet article sont issus de la thèse de l’auteur : Hugues
Tertrais, La piastre et le fusil. Le coût de la guerre d’Indochine (1945-1954), Paris, 2002.
3
Traduction d’une lettre remise aux cadres indigènes de Loc Ninh. SHAT, 4 Q114
4
Lettre du 11 août 1947 au président du Conseil. SHAT, 4 Q114
5
François Bloch-Lainé, Profession fonctionnaire, Paris 1976, cité dans Leclerc et l’Indochine,
Paris 1992 (annexe 3, p. 370)
6
Rapport Pineau, janvier 1952, Archives de l’Assemblée nationale.

2
cependant, parler de l’attitude "des" patronats, tant ce milieu n’est pas monolithique,
s’agissant de l’Indochine en particulier, et en distinguer les différentes composantes :
le patronat proprement colonial s’emploie à survivre, voire à profiter de la situation et
à rapatrier ce qui peut l’être ; le patronat métropolitain directement concerné – par
ses exportations – s’accroche ; le nouveau "grand patronat" préfère quant à lui
tourner la page – de l’Indochine comme de la guerre elle-même.
1. Le capitalisme colonial en Indochine : un patronat sur la défensive
L’emprise du capitalisme français sur l’Indochine reste intacte jusqu’en 1954, mais la
situation y est très inégale. Globalement, le contexte est défavorable depuis la fin des
années 1930, quand Paul Bernard déplore déjà la raréfaction des investissements
7
. La
Seconde Guerre mondiale perturbe ensuite les circuits d’échanges et intègre
l’Indochine dans la « Sphère de co-prospérité » de la « Grande Asie » orientale. Mais
les achats japonais ne compensent pas les pertes enregistrées dans la circulation des
biens : la Société française des charbonnages du Tonkin, qui exportait avant-guerre
60 % de sa production vers l’Asie, subit une chute d’un quart de celle-ci dans la
période de guerre et ne s’en remet pas ensuite ; après 1945, elle doit vendre l’essentiel
de sa production en Indochine même
8
. L’économie coloniale ne se relève
pratiquement pas de l’année 1945, qui constitue une rupture forte pour toute
l’Indochine. Indépendamment de l’anthracite, dont les principaux gisements se
situent à proximité de la baie de Ha Long, la plupart des mines de fer et de non
ferreux (étain, tungstène, zinc etc.) sont fixées dans des zones contestées et souvent
contraintes à la fermeture. Pour la Société française des charbonnages du Tonkin elle-
même, 1945 est l’année zéro, à partir de laquelle tout doit être reconstruit et ne l’est
que partiellement. Le secteur des plantations de caoutchouc connaît une situation
comparable : dans un cas comme dans l’autre, le niveau de production de 1945 est six
à neuf fois inférieur à celui de la période précédente
9
.
Dans une telle situation, l’esprit de protection, voire d’assistance, domine. Les
plantations de caoutchouc, symbole du profit colonial, restent apparemment un
domaine florissant : au début de la guerre, environ quinze sociétés du secteur restent
cotées à la Bourse de Paris. Aussi l’Union des planteurs de caoutchouc fait-elle
pression « pour la défense des activités françaises en Indochine » et la sécurisation
des lieux de production – ils reçoivent d’ailleurs le soutien du ministre Moutet
10
en
août 1947. Une volonté publique de protéger la ressource et les planteurs se
manifeste : pour compenser le surcoût lié à cette sécurisation (avec l’emploi d’unités
militaires ou le recrutement de milices locales), une subvention leur est attribuée en
1949, d’un montant de 30 cents par kilo, tandis que l’accord permet aux entreprises
de ne débourser que 136,37 pour un kilo, lui-même payé 141,47 francs aux planteurs.
Encore ce caoutchouc subventionné reste-il trop cher dans la région, puisqu’il est
disponible à 120,30 francs à Singapour : l’État ne délivre cependant d’autorisation
d’achat hors de la zone franc qu’au-delà d’un certain quota d’achats en Indochine.
7
Paul Bernard, Le problème économique indochinois, Paris, 1934 & Paul Bernard, Nouveaux
aspects du problème économique indochinois, Paris, 1937.
8
Selon les chiffres de l’Agence économique et financière du 9 novembre 1954, repris dans H.
Tertrais, op. cit. p. 378.
9
Regroupement des données du Bulletin statistique de l’Indochine, du Monde et du Conseil
économique pour les années 1939 à 1953.
10
Lettre du 11 août 1947 au Président du Conseil. SHAT, 4 Q 114 .

3
Mais, après 1950, le caoutchouc naturel perd de son importance et cette éventuelle
justification économique à la guerre disparaît par conséquent.
La France ne se bat pas non plus pour l’anthracite du Tonkin, seule activité minière
maintenue, quoique réorientée sur l’Indochine. Si le produit est de bonne qualité, les
quantités extraites paraissent insignifiantes par rapport à la production française
puisqu’elles ne pèsent que 2 % de la production nationale au mieux. Les autres
sociétés minières quant à elles – Compagnie minière de l’Indochine, Société des
mines d’étain du Haut-Tonkin, Étain & Wolfram du Tonkin – ont pour principale
activité la récupération et l’emploi des indemnités de guerre prévues par un décret de
1947.
L’Indochine n’est cependant pas "finie" pour tout le monde car elle reste aussi ou
devient un lieu de profit à court terme, celui qui est lié à la guerre et aux trafics qu’elle
génère. La présence d’un corps expéditionnaire qui mobilise jusqu’à 190 000
hommes au début des années 1950 ne passe pas inaperçue dans les comptes de
certaines entreprises. Le développement de la consommation de diverses boissons,
bière en particulier, dont les Brasseries & glacières de l’Indochine (BGI) ont un quasi-
monopole, n’a d’égal que celui des cigarettes : après avoir relevé qu’un million de
kilos de cigarettes a été consommé en Indochine en 1951, les Manufactures
indochinoises de cigarettes sont ainsi autorisée à investir pour développer leur
production
11
. Les modalités de financement de la guerre, par le biais de la
surévaluation de la piastre et des transferts piastres/francs, paraissent également
juteuses : « La guerre se révèle une très bonne affaire pour la Banque de l’Indochine.
De 1948 à 1954, elle trouve dans les circuits de financement du corps expéditionnaire
la principale source de son activité et de ses profits. »
12
Plus généralement, la tendance est au désinvestissement. Si l’Indochine en guerre est
une véritable "pompe à capitaux" pour la Banque de l’Indochine, celle-ci permet aussi
la réorganisation de ses actifs. Plutôt qu’elle ne fixe des investissements, l’Indochine
en guerre leur fait peur : la fuite des capitaux s’accompagne de leur redéploiement sur
le reste de l’Union française. Les transferts d’actifs étant soumis à l’autorisation de la
Rue de Rivoli, il est possible d’en suivre le parcours : les BGI obtiennent ainsi en 1951
l’autorisation d’investir l’équivalent d’environ 400 millions de francs en Afrique
(Dakar, Tunis, Alger) pour y développer leurs métiers. La Banque de l’Indochine,
« trop riche de capitaux qu’elle rapatrie d’Indochine », selon le mot de Marc Meuleau,
fait de même : comme son conseil d’administration le note sobrement dès 1947, « un
établissement comme le nôtre se doit de savoir s’adapter aux circonstances nouvelles
et de s’abstenir de regrets stériles »
13
.
2. Le lobby colonial : un patronat qui s’accroche à l’Indochine
Après la seconde guerre mondiale, il n’y a plus de Comité de l’Asie française, comme
Eugène Etienne l’avait constitué au début du siècle. Mais il reste des activistes et
11
Documents du Comité des investissements en Indochine (1952). AEF, Fonds Trésor, B
43908.
12
Marc Meuleau, Des pionniers en Extrême-Orient. Histoire de la Banque de l’Indochine,
1875-1975, Paris 1990.
13
Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1950.
Cité par Marc Meuleau, op. cit.

4
divers métiers continuent, au moins partiellement de vivre de la guerre, sinon d’en
profiter. Les derniers activistes, s’il est permis de les appeler ainsi, relèvent de deux
générations. La plus ancienne, symbolisée par l’Union des syndicats professionnels
indochinois (USPI) et surtout Paul Bernard, toujours entreprenant, se mêle à la
nouvelle, qui s’active dans le cadre du plan. Bernard, considéré comme
« représentant des intérêts privés en Indochine » par Edgar Faure, qui s’en méfie, a
construit sa notoriété dans les années 1930 par la publications de deux ouvrages déjà
cités : Le problème économique indochinois (1934) et les Nouveaux aspects du
problème économique indochinois (1937). Après 1945, il continue avec d’autres de
représenter l’Indochine dans les milieux qui travaillent à la préparation et à la
réalisation du Plan Monnet ; une sous-commission de modernisation de l’Indochine y
relève de la commission de modernisation des territoires d’outre-mer, que préside
René Pleven ; Bernard préside l’une des six sections de cette sous-commission, la
section Industrialisation, qui publie son premier rapport en 1948.
Certaines des idées de ce plan Indochine, dit plan Bourgoin, manifestent un sursaut
de l’esprit économique impérial et sont précisément dues à sa section
industrialisation. L’axe de réflexion est lié à la situation d’après-guerre dans le
Pacifique : la défaite du Japon, longtemps seule puissance industrielle de la zone,
transforme l’environnement économique extérieur de l’Indochine ; à travers cette
dernière, pense-t-on, la France a une place à prendre en Extrême-Orient. Plusieurs
facteurs internes lui confèrent justement « une vocation industrielle de premier
ordre » : d’une part une « main-d’œuvre abondante, habile, industrielle », d’autre
part des sources d’énergie (anthracite, hydro-électricité) et la plupart des matières
premières « nécessaires à l’installation d’une industrie à grande échelle »
14
. Le plan
prévoit en particulier deux pôles littoraux d’industrialisation : Cam Pha dans le nord,
en bordure d’un gisement d’anthracite pratiquement à ciel ouvert ; et Nha Trang dans
le centre méridional, débouché facile pour l’énergie hydroélectrique du barrage de Da
Nhim, proche de Dalat. Une large palette industrielle est envisagée, comprenant un
secteur métallurgique, y compris non ferreux, et de la chimie lourde – visant surtout
la production d’engrais.
La poursuite de la guerre a eu raison de ce plan et de ses ambitions, car ils ne
trouvent pas de financement. Pour autant, Bernard reste constamment actif sur le
dossier indochinois – comme un groupe de pression à lui tout seul… Il « bombarde »
les administrations concernées de rapports et de propositions jusqu’à la fin du
conflit : en 1954, en particulier, il soumet au Conseil économique un épais document
sur La conjoncture économique des États associés, qui figure dans de multiples
cartons des Archives économiques et financières mais n’aura jamais été adopté Place
d’Iéna. Cette importante personnalité paraît cependant assez vite "démonétisée" ;
Faure, déjà cité à son propos, estime notamment qu’il «ne tient aucun compte de
l’évolution des facteurs politiques du problème »
15
.
Le lobby colonial se compose aussi de tous ceux qui, directement ou non, vivent de la
guerre : s’y retrouvent les milieux industriels liés au « marché captif » qu’est
l’Indochine en guerre et que la perspective d’un échec rend inquiet. Au début des
années 1950, l’Indochine figure en bonne place dans les exportations françaises (la
14
Rapport général de la section Industrialisation, novembre 1947, 53 pp. Archives nationales,
80 AJ 12.
15
Conclusion du rapport Bernard en annexe 21 de H. Tertrais, op. cit. p. 593.

5
seconde après l’Algérie en 1952, la quatrième en 1953), alors que la métropole n’en
importe que très peu de produits. « L’économie française supporterait difficilement la
perte du marché indochinois », note alors la presse spécialisée
16
. En effet, ce fort
courant exportateur est directement lié à la guerre ; le patronat textile paraît le
premier concerné : environ 80 % des importations indochinoises de textiles se
composent de produits cotonniers et viennent de France ; il faut en particulier vêtir
les nouvelles « armées nationales » qui, encore balbutiantes à la fin des années 1940,
rassemblent 292 000 hommes
17
en 1954.
Le spectre d’une fin de la « préférence impériale », que suggèrent les négociations
menées en 1954 avec les États associés, mobilise les énergies en métropole. Le
Syndicat général de l’industrie cotonnière française monte au créneau, trouvant
soutien au sein même de l’administration française. Transmettant l’une de ses notes,
le préfet du Haut-Rhin « insiste sur l’importance que revêtiront pour plusieurs
branches industrielles françaises les décisions qui seront prises lors des
négociations » en question. Les principaux intéressés, souligne-t-il, « sont les
dirigeants de l’industrie cotonnière du Haut-Rhin, qui occupe 31 % de la population
active non agricole, auxquels il convient d’ajouter les ouvriers des industries
mécaniques et chimiques » liées au secteur textile
18
; le Nord et le Nord-Est sont
d’une manière générale directement concernés. Le Syndicat général de l’industrie
cotonnière française et la presse spécialisée argumentent : « L’Indochine représente
cinq semaines de travail pour 15 à 20 000 ouvriers, principalement dans les Vosges
(10 000 ouvriers concernés). Les soyeux lyonnais sont eux-mêmes d’autant plus
inquiets que le marché indochinois représente 10 % de leur chiffre d’affaires et 25 %
de leur activité de fabrication de tissu de soie, soit 10 000 métiers et 10 000
ouvriers. »
19
Certaines activités profitent directement de la guerre, notamment chez les
compagnies de transport et autres branches en aval. La navigation maritime, soit
pour l’essentiel les Chargeurs réunis (du groupe Seydoux) et les Messageries
maritimes, assure cent cinquante-trois départs pour l’Indochine en 1953 – le rapport
parlementaire Pineau envisage précisément de les taxer cette année-là. Dans le
transport aérien, la guerre fait les affaires de la compagnie Aigle Azur qui assure bon
nombre des transports militaires ; son patron, Sylvain Floirat, en reconvertit une
partie dans la création de la station de radio Europe n°1 et dans celle de la société
d’armements Matra.
Est-il nécessaire de revenir sur le caractère juteux de la guerre pour la Banque de
l’Indochine ? Compte tenu des tendances vichystes de plusieurs de ses dirigeants, la
Banque ne devait éprouver aucune compassion particulière pour les difficultés qu’y
rencontrait la IVe République : Paul Baudouin, alors son président, fut en 1940 à
Bordeaux le premier ministre des Affaires étrangères du maréchal Pétain, qui nomma
l’amiral Decoux à la tête du gouvernement général ; plus tard, au début des années
16
La Correspondance économique, 20 avril 1954. AEF, Fonds Trésor, B 33550
17
La reconnaissance en 1949 des États associés du Vietnam (Bao Dai), du Cambodge et du
Laos s’accompagne pour ces derniers de la formation d’« armées nationales » dont les unités
combattent avec le corps expéditionnaire français.
18
Lettre du préfet du Haut-Rhin au ministre des Finances, 18 février 1954. AEF Fonds
Trésor, B 43912.
19
La Correspondance éconmique, op. cit.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%