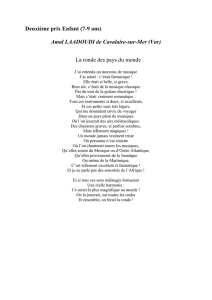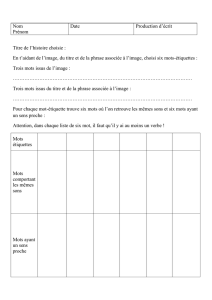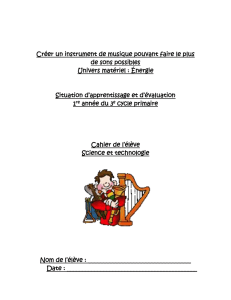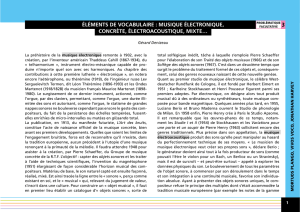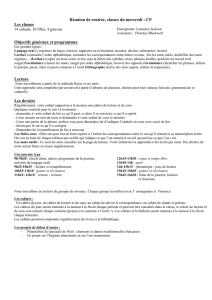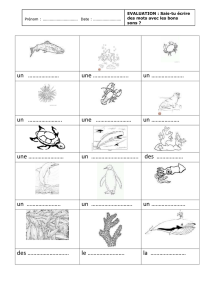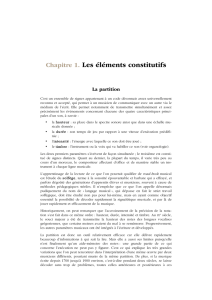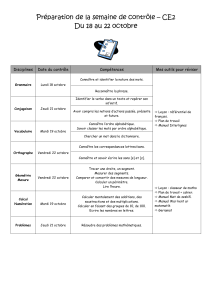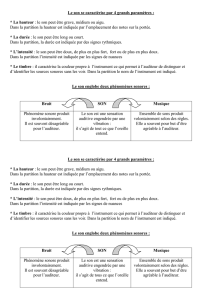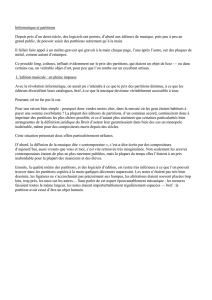Voilà plus d`un quart de siècle que mon esprit ne

- 1 -
Considérations (toujours actuelles)
sur l’état de la musique en temps réel.
Philippe MANOURY,
revue l’étincelle, IRCAM, n° 3 novembre 2007.
Voilà plus d’un quart de siècle que mon esprit ne cesse d’être
préoccupé, hanté même, par cette invention qui, un autre quart de
siècle auparavant, a provoqué une fissure dans le monde de la
musique: celle de l’électronique.
Mes premiers contacts avec la musique électronique ont eu lieu au cours
des années soixante-dix. Ce serait un euphémisme que de dire qu’à cette
époque, en France, les musiques électroniques et instrumentales ne
faisaient pas bon ménage. La querelle qui, dans les années cinquante,
opposa les « compositeurs de l’écriture » (Barraqué, Boulez et Stockhausen
principalement) à ceux de « l’intuition expérimentale » (incarnés par le
GRM de Pierre Schaeffer) n’est que la plus célèbre de toutes. Pour être
bref, les premiers reprochaient aux seconds de n’être que des
analphabètes musicaux, tandis que les seconds auraient aimé reléguer les
premiers dans les greniers poussiéreux de la tradition. Provenant
d’horizons culturels très différents, les compositeurs œuvraient soit dans
l’une, soit dans l’autre de ces catégories, mais rarement dans les deux.
Elevé dans la tradition de l’écriture instrumentale, je n’en éprouvais pas
moins une réelle attirance pour les possibilités offertes par la musique
électronique. Ce furent les fréquentes venues de Stockhausen à Paris, au
cours des années soixante dix, qui me firent prendre conscience de la
possibilité et du grand intérêt qu’il y aurait à relier ces deux conceptions
musicales en une seule. Je découvrais qu’on pouvait à la fois composer de
la musique d’orchestre et de la musique électronique et, parfois, au sein
d’une même œuvre. La création parisienne de Mantra, en 1973, fut pour
moi un moment initiatique. J’y découvrais la richesse potentielle de
l’unification des mondes instrumentaux et électroniques au sein de ce que
l’on aurait pu, déjà à cette époque, appeler « la musique électronique en
temps réel ». Mais cette œuvre, aussi emblématique qu’elle fût, n’en
demeurait pas moins, à mes yeux, inégalement proportionnée quant à
l’usage de ces deux modes d’expression. La partie électronique ne
consistant qu’en une transformation passive des sons des deux pianos, à
aucun moment, elle ne possédait une structuration formelle autonome,
comparable dans sa construction à celle des instruments. Dans ses œuvres
précédentes, ce même Stockhausen avait magistralement montré dans
quelles mesures les textures électroniques pouvaient être rigoureusement
composées. Mais, à l’époque de Mantra, l’état de la technologie rendait
encore impossible une telle complexité dans le contexte du temps réel. Le
seul support possible pour composer des formes évoluées avec les
matériaux électroniques demeurait la bande magnétique.
C’est donc avec une certaine frustration, due à la difficulté de réunir ces
deux modes d’expression, que j’entrepris mes premiers travaux. Autant les
potentialités sonores de la musique électronique m’attiraient, autant la
rigidité de son organisation temporelle n’en finissait pas de me poser
problème. Ce n’est qu’au début des années quatre-vingt, avec la
construction des premiers modèles de synthétiseurs en temps réel par
Giuseppe di Giugno à l’Ircam, que j’entrevis immédiatement une ouverture
possible vers une plus grande souplesse temporelle qui libérerait la
musique électronique de ce temps figé qu’imposait la bande magnétique.
Je me souviens tout particulièrement d’une séance de travail autour de
Pierre Boulez et « Peppino » di Giugno, au cours de laquelle la preuve fut
faite que ce que jouait le flûtiste Lawrence Beauregard pouvait être
identifié par un ordinateur, et ce, quel que soit le niveau de virtuosité
instrumentale. Je vécus ce jour-là comme une sorte de second moment
initiatique : il était donc possible de synchroniser automatiquement la
musique électronique avec le jeu instrumental. Le point le plus important
de cette avancée consistait dans le retournement de la situation habituelle
dans laquelle l’instrumentiste était l’esclave du déroulement automatique
et inexorable d’une bande magnétique. Dorénavant, ce serait
l’instrumentiste le maître du temps. Il pourrait jouer à son propre tempo,
accélérer, ralentir, faire des points d’orgue, bref, retrouver toute la
respiration et la liberté qui était la sienne depuis que la musique existe,
l’électronique le suivrait désormais. Au cours des dix années qui suivirent,
je menais, avec la collaboration du mathématicien Miller Puckette, une
série de recherches dont le premier résultat allait être]upiter, pour flûte et
électronique. Cette œuvre, composée en 1987, était la première à utiliser
un suiveur de partition et développait de nombreux principes d’interactivité

- 2 -
entre la flûte et les sons de synthèse
1
. Elle marquait le début du déclin de
la musique sur bande magnétique qui, malgré quelques positions
nostalgiques, voire . d’arrière-garde, allait finir par disparaître. Ensuite
naquirent successivement Pluton, La partition du Ciel et de l’Enfer, Neptune
et En écho, œuvres dans lesquelles je développais de nouvelles relations
avec le monde instrumental tout en cherchant à aller aussi loin que
possible dans les modes de communication interactifs. Pas à pas,
j’entreprenais une sorte de « recherche du temps perdu », celui, continu,
organique et flexible, de la musique jouée par les musiciens, et que je
cherchais à réintégrer dans les musiques électroniques. J’ai alors porté tous
mes efforts sur le développement de structures musicales électroniques
élaborées, dépassant le simple procédé de la transformation passive des
instruments, et pouvant être soumises au temps flexible d’un interprète.
En d’autres termes, je voulais doter la musique de synthèse de la
possibilité d’être interprétée.
Pourquoi le temps réel ?
Une critique contre le temps réel a souvent été formulée, pointant une
qualité sonore insuffisante, inférieure à celle qui était produite par les
moyens de l’électronique traditionnelle sur bande magnétique. Cette
critique était fondée dans les débuts, mais n’a plus lieu d’être aujourd’hui
car le raffinement auquel sont parvenus les moyens de la synthèse sonore
n’a désormais plus rien à envier aux anciennes méthodes. Une des
premières commodités du temps réel a été l’instantanéité des résultats
dans des calculs parfois complexes. C’était un avantage considérable si l’on
se souvient des nuits interminables, passées autrefois à attendre que les
machines aient terminé leur travail avant de constater que le résultat
n’était pas à la hauteur des espérances et qu’il fallait relancer les calculs
pendant autant de nuits successives qu’il était nécessaire. La rapidité des
calculs n’entraînait pas pour autant une plus grande rapidité dans le
processus de composition. C’était parfois même le contraire. Mais lorsqu’un
compositeur est à sa table de travail, ce qu’il note sur sa partition
« sonne » dans sa tête, et il bénéficie ainsi d’une sorte de « temps réel
virtuel » qui guide son intuition et son imagination. Ce n’était pas le cas
1
J’utiliserai le terme « son de synthèse » ou « musique de synthèse » pour
représenter tous les sons qui sont produits par les moyens technologiques. Dans la
réalité, ils peuvent appartenir au monde de la synthèse pure, mais aussi à celui du
traitement. Je considérerai qu’ils sont tous produits par un synthétiseur.
quand l’écoute du résultat n’intervenait que très longtemps après l’écriture.
D’autant plus que cette «écriture» n’était en fait qu’un langage fait de
nombres et de valeurs numériques, ce qui est la manière la moins intuitive
qui soit pour composer de la musique. Malgré l’affirmation de Leibniz, selon
laquelle « toute musique est un calcul inconscient », il restait difficile
d’appréhender une qualité sonore à la simple vue d’un listing de colonnes
chiffrées. Ce fut un autre atout du temps réel, plus important que ce simple
gain de temps, que d’avoir profondément modifié la manière dont un
musicien transmet ses idées à une machine. Avec les premiers
programmes en temps réels — et je pense particulièrement à l’invention du
programme Max par Miller Puckette — l’utilisation de curseurs graphiques
et virtuels a permis d’intégrer des éléments gestuels comme outils de
contrôle de l’ensemble des qualités sonores. Il n’était plus besoin de
formaliser numériquement une structure de timbre, car on pouvait la
construire et la faire varier d’une façon analogue à celle d’un musicien qui
produit le son par une variation de souffle ou une pression de l’archet. De
fait, ces machines commençaient alors à ressembler à des instruments de
musique, du moins dans les manières avec lesquelles on communiquait
avec elles.
Enfin, le temps réel a ouvert la voie à l’interactivité entre les instruments
acoustiques et les machines. Or, si de nombreux pas ont été faits pour ce
rapprochement, le mode de communication qui domine le plus souvent
n’est, pour le moment, qu’une sorte de «code morse». De temps en temps,
pour les besoins d’une captation ou d’une synchronisation, s’ouvre une
communication entre instrument et machine, qui se referme une fois le
processus de captation achevé, laissant instruments et électronique
continuer de manière indépendante sans plus de relations entre eux. Ainsi
ce que l’on a parfois appelé « temps réel » s’avérait souvent n’être que des
séquences musicales pré-composées, comme des petits morceaux de
bandes magnétiques mis bout à bout que l’on pouvait, certes, démarrer au
moment propice, mais dont le contrôle dans le temps nous échappait. On
entrait dans le temps musical par de petites fenêtres, qui s’ouvraient par
intermittence, pour se refermer aussitôt. Pour obtenir une véritable
continuité dans la communication entre instruments et électronique, et
faire en sorte que la réaction de cette dernière soit non seulement
instantanée, mais aussi suffisamment riche pour s’adapter aux différentes
situations et se modifier dans le temps d’une œuvre, il existe un outil

- 3 -
fondamental. L’artisan majeur d’une réussite en la matière est, sans aucun
doute, le suiveur de partitions.
À l’approche du «temps retrouvé»
Un suiveur de partitions est un programme qui a mémorisé une partition et
cherche à la reconnaître lorsqu’elle est jouée. Cet outil possède plusieurs
niveaux de tolérance car des erreurs peuvent toujours intervenir pendant
une exécution. Il est celui qui suit, pas à pas, le déroulement de la musique
dans le temps, et permet aux événements électroniques de se synchroniser
avec une précision à laquelle l’oreille (ou une quelconque action humaine)
ne peut pas atteindre. Si, depuis son invention, il a permis de retrouver
une partie de ce «temps perdu », il faut bien avouer que nous sommes loin
du « temps retrouvé». En amont de ce suiveur de partitions se dresse
l’épineux problème de la détection, de la reconnaissance et de l’analyse en
temps réel des sons instrumentaux. Plusieurs poches de résistances se
sont trouvées sur ce chemin, certaines naturelles, comme l’extrême
complexité du fonctionnement des instruments de musique, d’autres
technologiques, comme la difficulté d’analyser et de reconnaître des
éléments polyphoniques, d’autres enfin psychologiques: beaucoup de
compositeurs hésitaient à se lancer sur une voie aussi complexe et jonchée
de tant d’embûches technologiques.
Les instruments de musique ne sont en rien comparables aux objets
standardisés que notre époque aime tant à produire. Mis à part les
instruments du quintette à cordes, chacun possède son propre mode de
fonctionnement. Flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors, trompettes,
trombones et tubas, bien que réagissant tous au souffle, ne possèdent
guère de caractéristiques mécaniques communes. La richesse de leur
diversité nous pose des problèmes d’une grande complexité lorsque l’on
veut les accoupler avec la technologie moderne. Il faut souvent inventer
autant de manières différentes, pour capter leurs informations, qu’il y a
d’instruments. On a mis des capteurs pour détecter les doigtés sur une
flûte, d’autres sous les touches d’un piano ou d’un vibraphone, on a utilisé
des systèmes de vidéo pour analyser tel ou tel geste de percussionniste, on
a placé des antennes pour mesurer la position d’un archet ou utilisé des
méthodes spécifiques pour analyser sa pression sur une corde. D’abord
purement mécaniques, les systèmes de captations ont ensuite utilisé les
moyens audio, vidéo, les capteurs sensitifs, la gravitation... et souvent,
c’est par le couplage de deux ou trois de ces méthodes que nous arrivons à
construire des systèmes qui nous donnent satisfaction, souvent au prix
d’un fouillis de fils, de câbles, de caméras et autres micros. Si l’absence de
standardisation gouverne le fonctionnement de nos instruments, elle
gouverne également l’attitude de ceux qui les utilisent. Tel pianiste aimera
parfois enfoncer silencieusement les touches de son instrument avant de
plaquer un accord, tel violoniste tiendra son archet d’une façon différente
de tel autre, tel flûtiste produira un staccato beaucoup plus bref que ses
collègues… La variété de gestes et de comportements est pratiquement
infinie. Pour cela, nous avons appris à nos machines à apprendre, et à
s’adapter à telle ou telle personnalité; de réelles avancées ont été
accomplies dans ce domaine depuis les dix dernières années.
Une des méthodes les plus unifiée pour reconnaître ou analyser les signaux
acoustiques consiste à transmettre à une machine ce qui est capté par un
simple micro. On peut ainsi identifier non seulement quel son est joué.
mais aussi quelle est sa structure. et comment il évolue dans le temps. La
vitesse de réaction des machines est parfois effarante dans des traits de
très grande virtuosité, et dépasse de beaucoup les capacités de l’oreille
humaine la plus exercée. Cela permet. en outre, de capter la voix humaine
sans imposer une chirurgie quelconque sur un chanteur ou une chanteuse
afin de leur greffer des capteurs. Cela a toutes les apparences d’une
plaisanterie. mais que l’on se souvienne de nos castrats et de ce qu’on leur
faisait subir pour l’amour du beau chant! La méthode audio semble la plus
riche de toutes... jusqu’au moment où on demande à l’ordinateur
d’identifier deux sons superposés. Une polyphonie, même minimale.
semble pour l’instant hors des possibilités actuelles de détection audio, car
deux sons qui se superposent, mélangent tous leurs harmoniques et l’on ne
sait plus à quelles fondamentales chacun appartient. Seuls les instruments
monodiques peuvent être utilisés avec ce procédé. Ce n’est donc pas par
reconnaissance des hauteurs que l’on arrive à suivre une partition
polyphonique. mais en ayant appris à une machine tous les spectres
sonores qui proviennent d’une interprétation, et en lui demandant de les
reconnaître au moment de l’exécution. Dans le début de son roman Sound
and Fury, Faulkner présente un jeune garçon atteint de débilité qui capte,
néanmoins avec beaucoup de sensibilité. tous les événements qui lui
parviennent mais sans pouvoir les nommer. C’est à peu près ce que fait un
suiveur de partitions actuel. Il reconnaît ce qu’il a appris mais est encore
incapable de nous dire s’il s’agit d’un do ou d’un ré. Ce n’est pas d’une

- 4 -
importance capitale tant qu’on ne lui demande rien d’autre que de
reconnaître. Mais il serait parfois intéressant de pouvoir augmenter le
« niveau d’intelligence » de ces systèmes pour pouvoir effectuer des
opérations qui seraient basées sur l’analyse fine d’un discours musical.
Ainsi, dans ma Partita I pour alto et électronique, il a été totalement
impossible de reconnaître des doubles sons qui devaient être joués dans un
ordre aléatoire. La partition prévoyait un espace de liberté de navigation
dans lequel l’altiste pouvait, à son gré, modifier la musique électronique
suivant le chemin qu’il prenait. Seul un système pouvant identifier
« musicalement » ce qu’il captait aurait pu venir à bout de ce problème.
J’ai dû alors me résoudre à adopter un ordre déterminé dans
l’enchaînement de ces séquences. La recherche de méthodes fiables
capables d’analyser le contenu d’une situation polyphonique me semble
être l’une des priorités majeures sur laquelle les chercheurs devraient se
concentrer aujourd’hui.
À cette série de problèmes, il faut en ajouter un autre, d’ordre plus
psychologique. pour faire le tour de ces poches de résistances qui ont
freiné le développement du temps réel tel qu’il aurait dû avoir lieu. Force
m’est de constater que, parmi tous les musiciens qui se sont approchés du
temps réel de façon décisive. ce n’est pas dans ma famille esthétique
proche — celle des compositeurs — que j’ai trouvé l’engagement le plus
conséquent, mais dans un courant esthétique beaucoup plus éloigné de
mes orientations artistiques: celui des musiques improvisées et des
« performers ». Cette curieuse situation m’a laissé assez isolé pendant
longtemps, car cette union d’orientations esthétique et technologique qui
était la mienne, n’était que rarement partagée par d’autres. Le seul
compositeur chez qui j’ai pu observer, durant ces années, un intérêt
soutenu dans la nécessité de construire un temps réel véritablement
puissant et interactif. n’est autre que Pierre Boulez. Alors directeur de
l’Ircam. il fit du temps réel la priorité de recherche de cet institut et mit
l’utilisation du suiveur de partitions, au centre de ses intérêts comme en
témoignent les œuvres …explosante-fixe… et Anthème II. Ce manque
d’intérêt de la part des compositeurs pour le développement d’une
technologie du temps réel puissante et du suivi de partitions créa, pour de
longues années, une situation stagnante. C’est une sorte de principe
démocratique qui sous-tend généralement la recherche: moins un champ
d’investigation est partagé par un grand nombre de personnes, moins il
évolue car c’est sur la diversité des expériences que fleurissent les
développements. Ce fut le cas du suivi de partitions, et de celui de
l’interactivité entre les instruments acoustiques et les méthodes de
synthèses sonores. En revanche. l’attrait du temps réel, pour la
construction de musiques de synthèse interactive, a par contre été
immédiat chez les musiciens improvisateurs. Ce fut chez eux que les
recherches ont avancé le plus vite. Ces musiciens concentraient tous leurs
efforts sur des procédés d’analyse du son en temps réel, afin de construire
des musiques de synthèses réactives à la manière dont les « performers »
produisaient le son. Mais, n’écrivant pas leur musique, ils n’ont pas eu à se
préoccuper d’une quelconque synchronisation avec une partition. Les
compositeurs de musique écrite demeuraient réticents face à cette absence
de prédétermination qui consistait à attraper, « à la volée » dans le jeu
instrumental, les éléments nécessaires à la création des sons électroniques.
Eux voulaient fixer, et avec le maximum de précision, les configurations
sonores de leur invention afin que se reproduise le même résultat au cours
de différentes interprétations de la même œuvre. Cette attitude est
évidemment en accord avec la pratique contemporaine de la musique
instrumentale qui est basée sur des notations de plus en plus précises. De
par ma formation et mes orientations esthétiques, c’est dans cette dernière
direction que s’inscrit ma démarche et non dans celle des musiques
improvisées.
L’improvisation m’a toujours semblé ne prendre un réel sens artistique qu’à
partir du moment où certains éléments étaient au préalablement
déterminés. La musique classique indienne ou la tradition du jazz en sont
des exemples connus. Les musiques entièrement improvisées, si prisées de
nos jours, mettent souvent en œuvre un « performer » et un ordinateur. La
plupart du temps, rien n’est prédéterminé. La machine est censée réagir au
contenu acoustique de ce que le musicien joue, ce qu’elle fait généralement
très bien. C’est la toute-puissance de nos calculateurs qui est alors mise
sur scène. On sait qu’ils réagiront d’une façon ou d’une autre à ce que le
musicien inventera sur le moment. Mais lorsqu’aucune structure musicale
ne sert de base à la création spontanée, la musique reproduit des
archétypes formels souvent simplistes’ standardisés et connotés. Trop
fréquemment le résultat bascule tantôt du côté d’une complexité
maximale, tantôt dans celui d’une simplicité désarmante. Et l’on sait qu’au
niveau de la perception, ces extrêmes se rejoignent. On y décèle des
comportements, que l’on pourrait qualifier de basiques car, quand bien
même ils partageraient un large spectre d’expressions musicales avec les

- 5 -
compositions écrites, ils sont présentés dans la simplicité d’une succession
linéaire, comme pour une démonstration. On y reconnaît l’imitation,
l’influence, le contraste, la progression vers une tension qui sera
obligatoirement suivie par une détente avant une nouvelle progression...
Tous ces phénomènes existent aussi dans les musiques écrites, mais, à la
différence de ces improvisations, peuvent être insérés dans des formes
temporelles élaborées. Les formes temporelles des musiques totalement
improvisées, bien qu’il s’y produise parfois des réussites sonores
indéniables, sont pareilles à un nuage qui change constamment d’aspect,
dans une pure linéarité, avant de disparaître. La raison en est simplement
qu’un discours musical élaboré est une chose beaucoup trop complexe pour
être inventé et présenté sur le champ. Les phénomènes de mémoire, de
prémonition, la construction de formes hybrides, les stratégies de
préparation et de conclusion, les transitions, les proportions, les courts-
circuits ne peuvent s’improviser. Cela demande une réflexion critique, des
esquisses, des biffures, des recommencements, et je ne pense pas qu’il
existe un seul cerveau humain capable d’organiser toutes ces formes,
parfois simultanément, dans l’instant même où elles sont présentées.
L’ordre dans lequel apparaissent les différents éléments d’une composition
musicale ne respecte pas obligatoirement, peu s’en faut, celui dans lequel
ils sont nés dans l’imagination du compositeur. Une introduction peut très
bien naître d’une transition, comme un motif peut être déduit de ce qui
aura valeur de son propre commentaire. Le «temps réel» de la
composition, qui est le propre de l’improvisation entièrement spontanée,
est impuissant à même imaginer de telles constructions, encore plus à les
mettre en œuvre.
Il faut, à mon sens, qu’il existe une partie du discours musical déjà
déterminée d’une manière ou d’une autre. Et s’il fallait relever encore une
différence fondamentale entre les musiques improvisées et écrites, je dirais
qu’elle se trouve dans le fait de déterminer et de séparer ce qui doit être
fixé, de ce qui ne l’est pas, ou ne peut pas l’être. On peut vouloir concevoir
des musiques de synthèse comme on conçoit des partitions écrites, et
déterminer ce que l’on veut exprimer avec le maximum de précision. Ce
sont là des attitudes artistiques tout à fait respectables. Mais si la partition
instrumentale est un support fixe et non modifiable. la façon dont elle va
être interprétée ne rentre pas dans ces catégories de reproductibilité à
l’identique. L’interprétation, par définition, n’est pas déterministe. On ne
peut raisonnablement pas parler d’interprétation lorsqu’on connaît d’avance
exactement ce qui va se produire. L’interprétation n’est pas, non plus,
totalement aléatoire. Elle se situe dans une région intermédiaire entre les
deux et se produit « en temps réel ». Ces notions de temps réel et de
temps différé ne sont pas une chasse gardée de la technologie
informatique, mais appartiennent aussi à la pratique musicale
traditionnelle. La séparation entre valeurs fixes et variables, déterminées et
indéterminées, constitue sans doute l’élément le plus important de toute
cette problématique. On ne peut pas faire l’économie d’un examen attentif
de cette situation si l’on veut, tout à la fois, sortir définitivement de la
rigidité et du déterminisme hérité de la musique sur bande sans tomber
pour autant dans une pratique qui relèverait de la seule spontanéité. Pour
continuer ce rapprochement entre les musiques instrumentales et
électroniques, il n’y a pas meilleure méthode qu’examiner le contexte
traditionnel de nos partitions musicales.
La partition, son interprétation et les ordinateurs
Une partition fixe des valeurs que l’on pourrait considérer comme «
absolues» car, idéalement, on devrait pouvoir les vérifier lors de chaque
nouvelle interprétation. Ce terme de valeur « absolue» n’a, à bien y
regarder, de réalité que dans le seul cadre d’un écrit. Mais c’est aussi
suivant le degré de mécanicité des instruments que ces valeurs tendront à
devenir absolues. La hauteur et l’évolution dynamique d’un son joué sur un
violon, n’ont évidemment rien d’absolu car elles sont à tout moment
modifiables par le mouvement d’un doigt sur une corde ainsi que par la
variation d’une pression de l’archet. Al’ opposé, sur un orgue, ces
dimensions sont déjà mécanisées et ne dépendent d’aucun geste physique.
Plus on substitue une mécanique au geste physique, plus on limite les
possibilités d’interprétation. Le temps devient alors la seule variable
possible dans un tel système hautement mécanisé. Pour écrire des
partitions, on a créé des symboles comme les notes de la gamme et les
indications de dynamiques et de durées. Ces symboles représentent en fait
plus des champs que des valeurs absolues. On accepte comme un la toute
une bande de fréquences, gravitant autour de 440 Hz. On détermine un
mezzo forte comme un champ d’énergie sonore, encore plus vaste et
imprécis que le précédent, situé entre les champs piano et forte. Les
ambitus de ces champs varient selon le pouvoir discriminateur de l’oreille.
Des oreilles très bien exercées reconnaissent, de façon immédiate et sans
ambiguïté, un la d’un la +1/4de ton, mais divergeront grandement lorsqu’il
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%