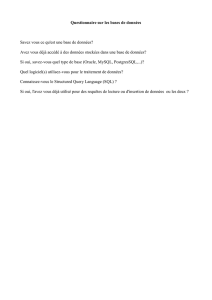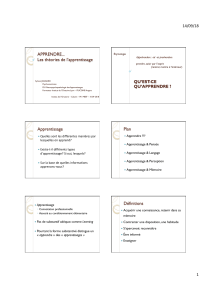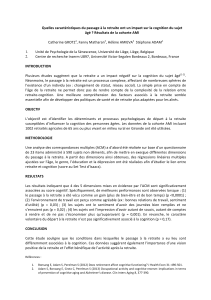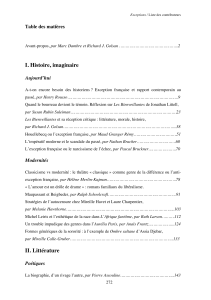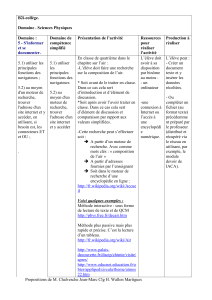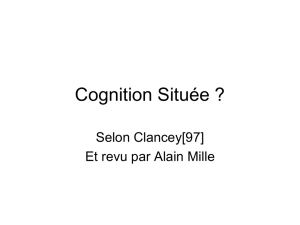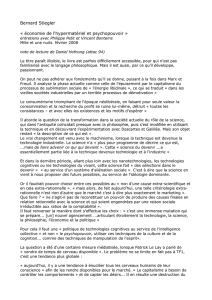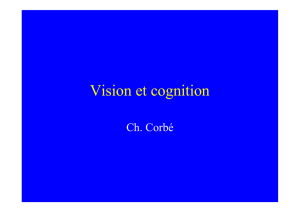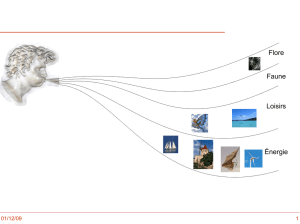La négociation du sens commun dans les wikis publics

1
La négociation du sens commun dans les wikis publics
Table des matières
La négociation du sens commun dans les wikis publics ...................................................................... 1
Problématique de recherche ................................................................................................................. 2
Contexte .......................................................................................................................................... 2
Questions ......................................................................................................................................... 3
Hypothèses ...................................................................................................................................... 4
Définitions conceptuelles ..................................................................................................................... 4
Les wikis publics ............................................................................................................................. 4
La notion de sens commun .............................................................................................................. 6
La notion de négociation par la contribution .................................................................................. 6
Cadre théorique .................................................................................................................................... 7
L'anthropologie des savoirs, un cadre général ................................................................................ 7
Approches politiques des usages des technologies ......................................................................... 8
Les théories sociales et pragmatiques de la cognition ..................................................................... 9
La cognition sociale ................................................................................................................... 9
La pragmatique ......................................................................................................................... 10
Organisation de la recherche: ............................................................................................................ 12
Choix du terrain ............................................................................................................................. 12
Contributeurs québécois à Wikipédia ....................................................................................... 12
Contributeurs au wiki de Koumbit ........................................................................................... 12
Contributeurs québécois au Wiki d'Ubuntu .............................................................................. 13
Approche méthodologique ............................................................................................................ 14
Instruments d'enquête et d'analyse ................................................................................................ 15
Échéancier ..................................................................................................................................... 16
Bibliographie ...................................................................................................................................... 16
Anthropologie des savoirs ............................................................................................................. 16
Sur la politisation usages des technologies de communication ..................................................... 18
Sur la cognition sociale et pragmatique ........................................................................................ 21
Sur les wikis .................................................................................................................................. 25
Méthodologie ................................................................................................................................ 26
Problématique de recherche
Contexte
Depuis les années 1980, le développement des technologies d'information et de
communication a donné lieu à de nouvelles façons de construire et diffuser les connaissances et à
des formes de coordination à grande échelle. Certains chercheurs ont décrit la multiplication de ces
technologies comme l'avènement d'une ère de l'information (Castells, 1998, Mattelart, 2001) et de la
communication en réseau (Mattelart, 2004, Proulx et Breton, 2002, 2006). Plusieurs pratiques

2
sociales inédites ont émergé de l'usage de ces « nouvelles » technologies. Selon moi, deux éléments
majeurs ont été transformés: nos modes d'acquisition et de production des connaissances et nos
modes d'organisation et d'intervention dans l'espace social.
Concernant nos modes d'acquisition et de production des connaissances, à savoir nos modes
de cognition, c'est vers une légitimation de la pensée collective que semble tendre les recherches
contemporaines. La recherche en sciences sociales et en sciences cognitives a tout particulièrement
investi la dimension sociale de la cognition depuis une vingtaine d'années (Lave et Wenger, 1991,
Hutchins, 1995, Conein, 2004, 2006, Bouvier et Conein, 2007). Certains auteurs ont cherché à
démontrer que la cognition était naturellement sociale, voir distribuée entre des agents qui se
complètent pour accomplir une action (Lave, 1988, Lave et Wenger, 1991, Hutchins, 1995). Mais il
est clair que les technologies liées à internet et donc organisées en réseaux ont permis de révéler,
favoriser voire encourager une certaine socialisation de la cognition (Conein, 2004, Stiegler 2005).
Les études portant sur la pensée collective semblent également envisagées sous un nouveau jour
depuis le siècle dernier. À la suite d'une littérature critique portant sur « l'infériorité mentale des
foules » (Lebon, 1905, p1) ou encore l'immédiateté non réflexive du sens commun (Bourdieu, 1976,
2001), il semble émerger un courant de recherche enthousiaste devant l'intelligence collective
(Lévy, 1994, Butler et al. 2002, Stalder et Hirsh, 2002), venant parfois précisément réfuter ces
approches critiques comme l'a fait Surowiecki (2004) qui répondait à Lebon (1905) par un traité sur
la sagesse des foules. La question de la sagesse ou d'intelligence des masses, des foules et du sens
commun est cependant loin de faire consensus. D'un côté, des technophiles humanistes célèbrent
avec enthousiasme les perspectives d'un renouveau humaniste, pour une société mondiale connectée
à elle-même comme un réseau de neurone. De l'autre, l'érudition prudente ne cesse de montrer du
doigt les leurres de la révolution numérique. Cependant lorsque ces deux extrêmes acceptent le
débat, celui-ci a pour intérêt de questionner les conditions de cette intelligence du nombre.
L'introduction des technologies dans nos modes d'organisation et d'intervention dans
l'espace social, a quant à elle déplacé et renouvelé les formes de pouvoir, de décision, et
d'orientation. En particulier, les technologies cognitives qui supportent la production, la gestion, la
mémorisation et la diffusion de l'information jouent un rôle très important dans notre rapport au
savoir. Une certaine forme de politisation critique a émergé au milieu du 20ème siècle, prévenant
d'une perte de contrôle dûe à l'emprise de technologies, et cette approche critique a continué avec la
diffusion des technologies cognitives. Pourtant, nous verrons que les praticiens ont eux aussi
développé un savoir-faire critique.
Ainsi si l'usage de ces technologies a certainement favorisé des formes de cognition plus
collectivisées, l'intelligence et la légitimité des savoirs issues de ces pratiques ne sont pas seulement
questionnées par les penseurs critiques, mais aussi par les contributeurs eux-même: beaucoup de
projets collaboratifs rendent compte de débats qui trament leurs évolutions, éclairant le fait que la
cognition collective ne se fait pas dans un consensus mou et fluide mais plutôt via des interventions
dynamiques et parfois particulièrement rugueuses. Dans un espace invitant à une communication
argumentative, la pratique d'une cognition collective est liée à un savoir faire tant technique que
politique. Dans leur Histoire des théories de l'argumentation, Philippe Breton et Gilles Gauthier
(2000) établissent un lien entre l'émergence de théories de l'argumentation, la pratique d'un discours
critique et la naissance d'un espace démocratique (l'agora grecque). Aux interstices d'une société
marquée par la communication de masse, voit-on réapparaître des espaces de délibération politisés?
Certains acteurs ont investi les technologies liées à internet pour développer des espaces de
collaboration souvent sous-divisés en espaces de construction et de délibération. Sur quelles bases
s'effectue cette délibération? Que révèle-t-elle des modes de légitimation dans les communautés qui

3
produisent des connaissance publiques? Comment se légitime une contribution dans un système
dynamique ouvert (Conein, citant Lazega, 2004c).
Ce travail a pour ambition de rassembler quelques éléments de compréhension des
conditions d'intelligence ou plus exactement de légitimation de la cognition collective, telle que
pratiquée dans un wiki. Ce qui me questionne tout particulièrement, ce sont les questions politiques
qui peuvent émerger de la rencontre des producteurs de savoir. Nous savons que les disciplines, les
cultures, les cités, les champs, les classes, ont créé des multitudes de sphères de compréhension, aux
hermétismes encore persistants. Comment, pourquoi des technologies permettant de penser plus
collectivement et de construire à plusieurs atténueraient-elles ses discordes ? Sans renoncer à la
possibilité de penser un bien informationnel commun (Aigrain, 2005), je propose d'analyser les
rugosités qui traversent la construction des projets collectifs en m'attardant aux controverses et
négociations qui émergent de la production des savoirs et de leur règles.
Questions
Tout d'abord, en m'appuyant sur les approches politiques des technologies, je chercherai à
comprendre les enjeux de pouvoir liées à l'usage des TIC. En partant du principe évoqué par Michel
Foucault qu'un savoir est lié à un pouvoir, je réfléchirai notamment à l'enjeu de la mise en accès des
savoirs et savoir-faire relatifs aux technologies. Le second enjeu que je suivrai est lié à la mise en
commun et aux modes de négociation de cette mise en commun. Plus particulièrement, je
m'intéresserai à la politisation de ces enjeux par les acteurs. La première question qui guidera ce
travail est la donc suivante :
Quelle lecture (politique) pouvons nous faire d’un dispositif où les connaissances ainsi
que leurs conditions de légitimation sont maintenues ouvertes à l’argumentation ?
Ensuite, les approches sociales et pragmatiques de la cognition me permettront de
comprendre, en situation, comment se font les opérations de catégorisation, de généralisation et de
négociation du sens commun. En particulier, je chercherai à répondre à la question suivante :
Qu'est ce que les négociations des acteurs sur les contenus, les échelles (local/global,
privé/public) et les conventions nous apprennent de la légitimation des savoirs dans les
communautés numériques ?
Hypothèses
Ce travail s'appuie sur deux hypothèses, l'une de nature empirique, liée à mes premières
observations des pratiques collaboratives sur un wiki, l'autre de nature plus théorique, liée à notre
compréhension des problèmes posés par les approches politiques des usages et les approches
sociales de la cognition.
Notre hypothèse empirique est que les technologies numériques n'ont pas mené à une
communion des esprits, mais à l'émergence de nouvelles pratiques, incluant de nouvelles formes de
collaboration et de sociabilité, mais aussi dissensus, de discussion et de scission. Les wikis étant des
sites aux structures particulièrement malléables par leurs usagers, ceux dédiés à la création d'une
connaissance publique me semblent constituer un terreau propre à l'analyse de l'émergence de ces
pratiques. En laissant l'usager devenir réellement contributeur, les wikis renouvellent en profondeur
les logiques de production du savoir.

4
Notre hypothèse théorique est qu'un rapprochement est à faire entre les approches politiques des
usages des technologies de communication et les analyses socio-cognitives des négociations de
catégories, règles et références des contenus produits en collaboration. À ce titre, notons que la
cohabitation des deux questions de recherche peut sembler révéler une ambiguïté quand à la
direction du projet. Le projet vise à démontrer que ces deux questions sont intimement liées, que
d'une part l'ouverture du dispositif permet la négociation et que d'autre part l'espace de négociation
est en soi politique et participe au modelage du dispositif.
Définitions conceptuelles
Les wikis publics
Les wikis sont des logiciels serveurs qui permettent aux usagers de créer et d'éditer des
pages Web via un navigateur. Le premier wiki a été conçu en 1994 par Ward Cunningham afin de
supporter la création collaborative d'une base de connaissances liée à des solutions d'ingénierie
logicielle. Ce dispositif a été pensé pour favoriser une édition collective rapide (WikiWiki signifie
«très vite» en hawaïen). Les wikis servent aujourd’hui de support à l'édition dynamique et collective
d'une pluralité de projets constitués autour de la construction collaborative de connaissances. Les
wikis ont une syntaxe simplifiée qui facilite la création de nouvelles pages et de liens entre les
pages. Ils rendent possible une structuration collective des contributions et des contenus, avec en
général, le maintien de l'historique des modifications et pour certains, l'accès à un espace de
discussion sur le texte. Ce dispositif a la particularité d'être ouvert et souple, autorisant une
intervention libre mais aussi la réécriture des textes, ainsi que parfois, le dialogue entre les auteurs.
Je m'intéresse tout particulièrement aux wikis publics qui maintiennent ces caractéristiques
d'ouverture. Nous verrons cependant que le caractère public du wiki dans son ensemble, ou d'une
certaine catégorie de pages constitue en soi un sujet de débat touchant en profondeur les
significations politiques et épistémiques des projets de construction de connaissance. En particulier,
la question de la « publicité » telle que développée par Habermas (1978), semble être renouvelée
ici, à propos de la gestion d'un espace informationnel à priori public, autorisant l'intervention et la
lecture du plus grand nombre.
Ward Cunningham prononçait au WikiSymposium de San Diego (2005) une
communication intitulée « The Crucible of Collaboration » (le creuset de la collaboration) dans
laquelle il faisait la distinction entre pratiques de collaboration et pratiques de coopération. Il est
crucial, selon lui, de comprendre ce qui les distingue afin de saisir la spécificité des usages d'un
wiki. Son analyse met en perspective les pratiques de la communauté Ebay avec celles des usagers
de wikis. La coopération fait référence à une action menée conjointement par une pluralité d'acteurs
autour d'un but commun et dont les prestations doivent être identifiées avec soin dans un but de
reconnaissance mutuelle et distincte. La coopération permet ainsi de valoriser les prestations, c'est-
à-dire d’attribuer une valeur distincte aux différentes opérations, ouvrant sur une forme d'économie
d'échange. La collaboration fait référence quant à elle à une action menée conjointement par une
pluralité d'acteurs dont les contributions n'appellent pas d'impératif d'identification parce que le
succès du projet collectif semble être ce qui valorise l'apport individuel. Par exemple, on voit
apparaître des acteurs discrets, parfois baptisés « WikiGnomes » (ou « jardiniers »), qui viennent
parfaire le projet commun par des contributions considérées comme mineures, telles que des
corrections orthographiques. On s'écarte ici d'un modèle du « don contre don » pour un modèle du
bien commun, où la contribution au bien collectif semble prendre une valeur supérieure à la

5
performance individuelle. Ainsi, dans ce mode de construction collective des connaissances, la
signature des actes d'écriture n'est pas requise :
« Le système ouvert [des Wikis] permettant à chacun de modifier les pages, nous ne
pouvons garantir la validité permanente du contenu. Veuillez également noter que
toutes les modifications sont archivées dans l'historique de la page ainsi que l'adresse
Internet des contributeurs non inscrits. Sans identification par le nom, c'est l'adresse
[Internet] qui apparaît dans le fil des dernières modifications. »
1
Comme postulé dans un travail de collaboration orienté vers la construction d'un projet
commun, dans bon nombre de wikis, dont Wikipédia, rien n'oblige le contributeur à s'identifier.
Selon les principes originels d’usage des wikis, tout mot de passe ou procédure d'identification est
considéré comme un obstacle de plus au visiteur qui, de ce fait, hésitera à se faire contributeur.
L'écriture dans l'anonymat est novatrice au regard de nos habitudes de responsabilité éditoriale.
Contrairement à une logique fondée sur la signature d'un auteur pouvant se voir gratifié (ou fustigé)
pour sa contribution, l'individualité de chacun compte moins que l'effort collectif. Si certains
écrivent de longs morceaux de texte, d'autres ne font que « jardiner » : par exemple, nettoyer,
corriger les coquilles, prendre soin du détail sans pour autant se faire connaître à travers ces actions.
Pour la gestion du vandalisme, les communautés d''usagers de wikis publics s'appuient souvent sur
un principe dit de sécurité douce. Aidés d'outils de suivi, les contributeurs sont capables de
visualiser et de réinitialiser rapidement les pages vandalisées. Ainsi, le vandalisme est dissuadé par
la facilité à le contrer. La responsabilité de la gestion du wiki devient alors un enjeu collectif, où la
masse de contributeurs actifs fait la force du wiki. Cette logique de collaboration propose une
responsabilité partagée qui pourrait être emblématique d’un régime d’espace public collaboratif :
c'est au groupe de décider ce qui lui est utile, ce qui constitue une contribution.
La notion de sens commun
J'utilise le terme sens commun en jouant volontairement sur le caractère polémique de son
usage dans les sciences humaines et sociales. Après avoir été valorisé au 18ème siècle par la
philosophie des lumières comme une sorte de bon sens, approchant de la connaissance l'universel,
les sciences sociales ont travaillé à décliner cette notion dans sa diversité en tant que système
culturel (Geertz, 1986 ), ou réalité multiple (James, 2005 et Schütz, 2005). Les sociologues de la
rupture épistémologique et des approches critiques (Durkheim, 1894, Bourdieu, 1976) ont
fermement distingué le savoir issu du sens commun de celui produit par la recherche scientifique,
qui s'appuie sur des méthodes et une légitimation propre à son champ. Les sociologues qui
s'affilient à une tradition de recherche plus pragmatique estiment quant à eux que les gens sont
capables de jugement critique, selon certaines conditions : l'existence d'un espace public
(Habermas, 1978), la possession de certaines compétences d'argumentation et de justification
(Boltanski et Thévenot, 1991), la diversité et l'indépendance des participants, ainsi que la
décentralisation des prises de décision (Surowiecki, 2004). Il est approprié de parler de sens
commun pour décrire ce qui est produit dans un wiki car c'est à la fois la production d'un sens
(d'une connaissance significative) et d'une mise en commun dont il est question. Je m'intéresserai
donc tout particulièrement à la nature des interactions qui entourent cette mise en commun dans un
wiki public.
1
http://fr.Wikibooks.org/Wiki/Wikilivres
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%