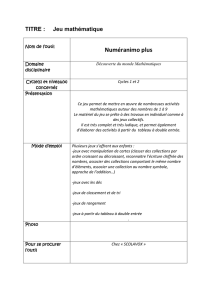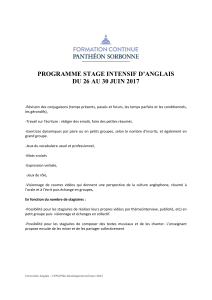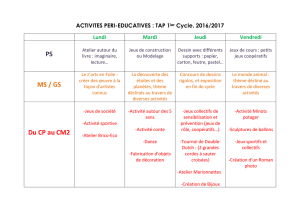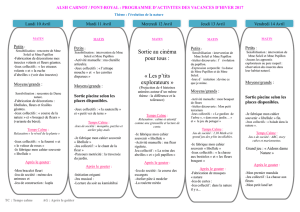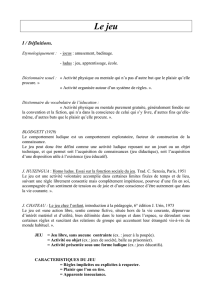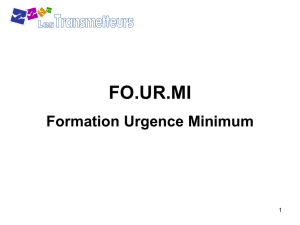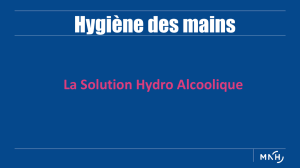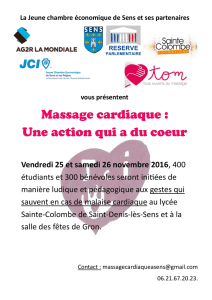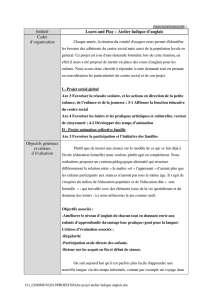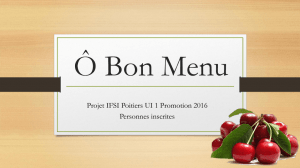Le jeu à l`école

Licence de Science, Technologies et Santé
Parcours Pluridisciplinaire
Le jeu à l’école
DREGE Isabelle Cours de psychologie de M PULIDO
FOUCHER Stéphanie Année universitaire2004-2005
UFR Sciences
2 Bd Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

2
Sommaire
Introduction ……………………………………………………………………………….….…3
I. Qu’est ce que le jeu ? ....................................................................... 4
1) Définition ........................................................................................................................ 4
2) A quoi sert le jeu ?. ......................................................................................................... 5
3) Caractères propres aux jeux des enfants. ...................................................................... 6
4) Les différentes formes de jeu …...………………………….…...……………………………...……….….8
II. L’intérêt du jeu en classe .................................................................. 9
1) dans la construction de l’enfant. ................................................................................... 9
2) dans sa relation avec les autres. .................................................................................. 11
3) dans l’apprentissage a l’école. ..................................................................................... 12
III. L’intégration du jeu à l’école ............................................................ 14
1) Le rôle de l’enseignant ................................................................................................. 14
2) Le choix des jeux……………………..…………………………………………………………………...….16
IV. Les limites du jeu ............................................................................ 17
Conclusion .......................................................................................... 19

3
Introduction
Au sein de notre enseignement de psychologie, il nous est demandé de réaliser un écrit sur un
sujet de notre choix mettant en relation la psychologie et l’un des aspects de notre futur métier
de professeur des écoles.
Nous avons choisi de parler du jeu qui nous apparaît être l’activité à laquelle les enfants
consacrent le plus de temps.
Quel est l’intérêt du jeu dans la construction de l’enfant ? Quel est son intérêt psychologique
dans l’apprentissage à l’école ? Pour essayer de répondre à cette problématique nous allons
traiter différents points.
Tout d’abord dans un premier temps, nous tenterons de définir ce qu’est le jeu, ce qu’il
apporte aux enfants en général, et nous détaillerons les différentes formes de jeu existantes.
Cette partie va nous servir à poser les bases de notre réflexion.
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons plus particulièrement aux apports
bénéfiques du jeu d’un point de vue pédagogique, dans la construction de l’enfant, dans sa
construction avec autrui et dans l’apprentissage à l’école. Cette partie nous paraît importante
car elle permet de mettre en évidence les bienfaits du jeu et montre pour quelles raisons le jeu
peut être utilisé comme outil pédagogique.
Ensuite dans une troisième partie, nous évoquerons l’intégration du jeu à l’école, le rôle qu’à
l’enseignant dans cette intégration et la façon dont il doit choisir les jeux. Cette partie permet
de mettre en relation le jeu, l’apprentissage et l’enseignant.
Enfin dans une quatrième et dernière partie, nous discuterons des limites du jeu car il nous
paraît intéressant d’évaluer les contraintes de mise en place du jeu au sein d’une classe.
L’intérêt du dossier est d’étudier l’une des principales activités de l’enfant au cours de l’école
élémentaire et ainsi de mieux le comprendre dans ses activités ludiques et aussi de mieux le
guider dans sa construction personnelle.

4
I. Qu’est ce que le jeu ?
1) Définition
Montaigne considère les jeux comme « les plus sérieuses actions des enfants ». C’est
pourquoi une réflexion tournée vers le sens profond du jeu nous apparaît indispensable.
Selon Le Robert, le jeu est une activité physique ou mentale qui n’a pas d’autre but que le
plaisir qu’elle procure. Or, nous tenterons de montrer que le jeu n’est pas seulement une
source de plaisir mais aussi un très bon outil pédagogique.
Pour le philosophe hollandais Johan Huizinga (cité dans l’enfant et les jouets), «le jeu est une
action volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une
règle librement consentie mais impérieuse, pourvue d’une fin en soi, accompagnée d’un
sentiment de tension et de joie et d’une conscience d’être autrement que dans la vie
courante. ».
Rogers Caillois définit le jeu par les formes que prend cette activité, il en distingue six, dont :
-le jeu libre : c’est l’activité à laquelle le joueur ne saurait être obligé sans que le jeu perde
aussitôt sa nature de divertissement attirant et joyeux.
-le jeu réglé : activité soumise à des conventions qui suspendent les lois ordinaires et qui
instaurent momentanément une législation nouvelle, qui seule compte.
Piaget quant à lui en distingue trois formes en fonction de l’âge de l’enfant :
-le jeu d’exercice : il concerne les deux premières année de la vie de l’enfant. Il s’agit alors
d’interaction entre l’enfant et les objets du monde physique. L’enfant répète par pur plaisir
des gestes qu’il a appris et assimilés. C’est la période durant laquelle il prend les objets, les
lance, manipule les éléments naturels tel que l’eau, la terre, le sable…
-le jeu symbolique : c’est la période durant laquelle les enfants jouent ensembles et se mettent
en scène dans un souci d’imitation de l’adulte : schématiquement, les petite filles jouent à la
maman et à la poupée, tandis que les garçons mettent en scène le gendarme et le voleur.
Ces jeux se caractérisent par les interactions qu’ils engendrent entre les enfants.

5
-les jeux de règles : ils commencent à se développer chez les enfants à partir de 4 ans, mais
ils sont davantage utilisés à partir de 7 ans. Ce sont des jeux compétitifs régis par des codes,
des règles transmises ou des accords momentanés.
Chacune de ces formes de jeu correspond donc à une période de la vie de l’enfant et participe
à plusieurs apprentissages.
2) A quoi sert le jeu ?
Le jeu servirait, d’après l’opinion la plus ancienne et la plus répandue de nos jours, à se
délasser. C’est le jeu considéré comme une récréation, pour se délivrer des soucis et de la
fatigue.
Toutes les références que nous citerons dans cette partie sont tirées du livre écrit par Jeanne
Bandet et Réjane Sarazanas .
D’après Schiller-Spencer, le jeu serait aussi un moyen d’expression et de libération de forces
inutilisées dans la vie; appliquées aux adultes, cette théorie explique toutes les activités dites
« de loisir » ou de vacances, quand le travail n’exige plus l’exercice de l’action et de
l’énergie. Cette énergie, qui se trouve en excès, est donc utilisée dans des actes inutiles mais
qui servent justement, dans le jeu, à l’extérioriser. Il est difficile d’appliquer cette théorie aux
enfants lorsqu’on les a vus se fatiguer à jouer, allant jusqu’à l’extrême limite de leurs forces.
Stanley-Hall propose la théorie de l’atavisme:
Les jeux reproduiraient à peu près dans l’ordre où elles sont apparues, dans le passé, à travers
les générations, les activités des hommes. Sans doute retrouve-t-on dans les jeux des enfants
certaines formes ancestrales où se découvrent les mêmes instincts (chasse, combat) et les
mêmes rites (formules magiques des comptines, pouvoir de certains gestes); mais, il faut
remarquer aussi que, de plus en plus, les jeux sont influencés par la société dans laquelle vit
l’enfant.
Groos évoque une autre théorie qui est la théorie de l’exercice préparatoire. Cette thèse met
l’accent sur le rôle du jeu dans le développement des êtres vivants. L’idée fondamentale est la
ressemblance entre les activités ludiques et les actions qui caractérisent ensuite les adultes de
la même catégorie. Par exemple, « le petit chat bondit sur le morceau de papier ou sur la
feuille sèche, comme il bondira plus tard sur la souris ou sur l’oiseau. »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%