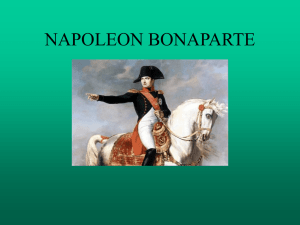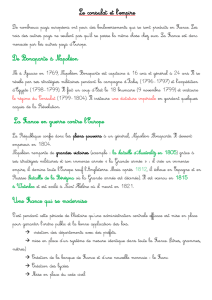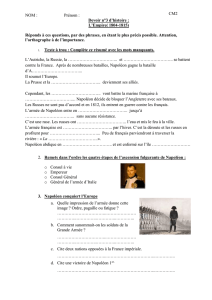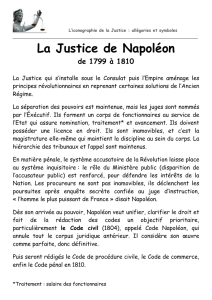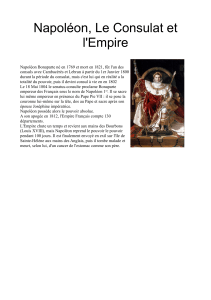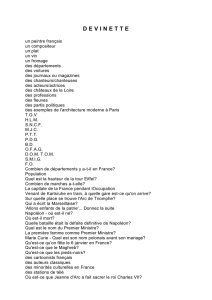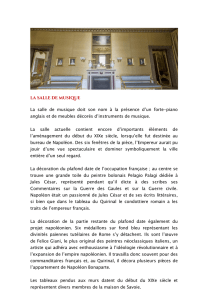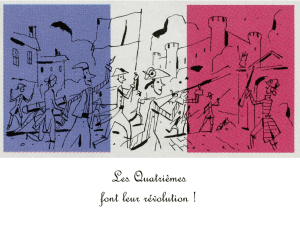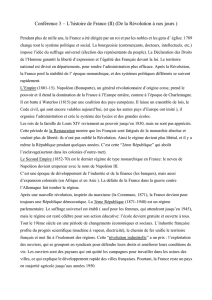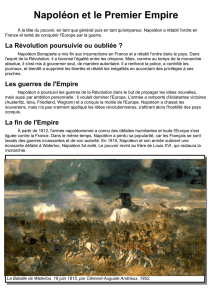11 la retraite de Russie 1812 : la Bérézina

11 la retraite de Russie 1812 : la Bérézina
Présentation des évènements
La campagne de Russie marque un tournant dans l’histoire des guerres
napoléoniennes. Alors que la suprématie de la Grande Armée semblait incontestable
avant 1812, cet épisode montrera au reste de l’Europe la faillibilité des troupes
françaises et redonnera moral et courage à ses ennemis.
Depuis maintenant 7 ans Napoléon, couronné Empereur de tous les Français, met
l’Europe à feu et à sang, dans le désir secret de réaliser l’union de tous les peuples
sous sa bannière. A l’aube de sa quarante troisième année il a déjà remporté de
multiples batailles, écrasé 5 coalitions, et pris le contrôle de nombreux pays tels que
la Prusse, les Royaumes d’Italie et ceux de Scandinavie, l’Espagne…
Mais, indomptable, l’Angleterre a continué de se dresser fièrement face à lui. Après
la bataille de Trafalgar, qui a vu la majorité de sa flotte anéantie par l’Amiral Nelson
en 1805, Napoléon a du se résoudre à tenter d’isoler l’île, faute de pouvoir la
prendre. Il a alors cherché à mettre en place un blocus continental visant à interdire
tout commerce entre l’Angleterre et le reste de l’Europe.
Même s’il ne contrôle pas la Russie, un accord avec le Tsar Alexandre 1er conclu en
1808 à Tilsit, ainsi que quelques entrevues, lui assure à la fois la paix avec les
Russes, et leur accord pour fermer leurs ports aux navires anglais.
Mais en août 1811, le blocus, déjà hésitant, cesse sur les bords de la Baltique,
rendant inefficace l’ensemble du système. De plus, le Tsar fait stationner des troupes
à la frontière polonaise, profitant de l’absence de la Grande Armée sur le front est.
Finalement, suite à plusieurs négociations de paix avortées, Napoléon, à la tête de
presque 700.000 hommes, franchit le Niémen le 24 juin 1812 marquant ainsi
officiellement le début de la Campagne de Russie.
De leur côté, les Russes ne sont pas préparés. Le Tsar n’est pas compétent en
matière militaire, même s’il détient le commandement. Les effectifs de ses troupes
sont méconnus, du fait de leur dispersion à travers le pays, et de l’imprécision des
chiffres, gonflés pour escroquer les finances publiques. On peut considérer que près
de 400.000 hommes, commandés par le général Barclay, peuvent faire face à la
Grande Armée. Mais devant la vitesse de progression et la puissance des Français,
Barclay ne réussit pas à regrouper ses forces et doit se résoudre à reculer, fuyant
une bataille rangée qu’il sait ne pas pouvoir gagner.
Le 28 juin, Napoléon entre alors à Vilna, puis les Français s’emparent de Minsk, le 8
juillet, afin de gêner le regroupement russe. Après de petites victoires à Ostrovno et
Jakoubovo, la Grande Armée prend la ville de Smolensk, qui n’a pour seul intérêt
que d’être sur la route de Moscou.
Car c’est là l’objectif de Napoléon. Bien que la capitale russe soit à St Petersbourg, il
reste persuadé que la prise de la cité forcera le tsar à signer une paix rapide.
Du côté français le moral chute, on déplore l’absence de grande bataille pouvant
mettre fin au conflit, ainsi que l’omniprésence du soleil écrasant et de la poussière
des routes. De plus, le ravitaillement se complique, les Russes détruisant
évidemment tout ce qu’ils ne peuvent emporter.
A Smolensk, Napoléon réfléchit même à établir ses quartiers d’hiver à Vilna afin de
poursuivre sa campagne l’année d’après. A ce moment, la Grande Armée compte
175.000 hommes, sans compter ceux des flancs nord et sud et ceux qui assurent les
lignes de communication.
Du coté russe, on a l’impression de laisser faire et de ne pas réellement s’opposer
aux français. Koutouzov reçoit ainsi le commandement de l’armée le 29 août, en

remplacement de Barclay, jugé trop lâche. Cependant il tire les mêmes conclusions
que son prédécesseur sur la situation et continue de se replier plus en arrière vers
Moscou.
Devant les hésitations des Russes, Napoléon décide finalement de chercher
l’affrontement décisif et poursuit les troupes de Koutousov. Le 5 septembre, il arrive
en vue de Borodino, et des soldats russes. L’attaque débute le 7 et dure toute la
journée (bataille de la Moskowa). Si les Français se rendent maîtres du champ de
bataille le soir, les Russes ne sont pas vaincus, et se replient vers Moscou.
Le 14 septembre, les troupes françaises entrent alors dans Moscou désertée par les
soldats russes. La victoire est fade, il n’y a pas de capitulation.
Au lieu de ça, dans la nuit du 15, le feu se déclare en ville et les Français
s’aperçoivent du sabotage des pompes à eau. Du fait du vent et de la présence de
nombreux bâtiments en bois, l’incendie ne sera finalement circonscrit que le 19
septembre, à la faveur d’une forte pluie, après avoir brûlé les trois quarts des
maisons moscovites.
A l’issue de l’incendie, Napoléon songe à hiverner dans la ville. Mais le pillage
omniprésent diminue sensiblement les ravitaillements, déjà en partie brûlés.
Finalement, face à l’hostilité des Moscovites, Napoléon pense plutôt rentrer à
Smolensk. Cependant, il y renonce, espérant signer la paix coûte que coûte avec le
Tsar. Face au silence d’Alexandre, qui doit se montrer ferme pour garder sa
couronne, Napoléon commence à perdre son sang froid et n’écoute plus les
récriminations de ses maréchaux qui le poussent à quitter Moscou. Il rechigne à cette
action qu’il voit comme une preuve de sa faiblesse.
Prenant alors pour excuse une escarmouche aux alentours de Moscou, il décide de
laver l’affront et quitte enfin Moscou le 19 octobre, pour marcher sur Kalouga.
A ce moment de la campagne, les troupes russes sont constamment renforcées
atteignant près de 900.000 hommes, dont 100.000 au voisinage immédiat de
Moscou. La Grande Armée conserve, elle, 100.000 hommes valides et traîne avec
elle le butin des pillages.
A Malo-Iaroslavets, ville située à quelques kilomètres de Kalouga, les Russes
parviennent à contraindre la Grande Armée à reprendre le chemin emprunté à l’aller,
malgré une courte victoire française.
On est alors le 26 octobre et c’est le début de la retraite de Russie.
Après les chaleurs de l'été, la Grande armée est maintenant confrontée aux rigueurs
de l'hiver russe. Le froid, la faim surtout, tenaillent les soldats. Les corps français se
désorganisent de plus en plus. Des milliers de traînards encombrent les routes.
Seuls les meilleurs généraux parviennent à maintenir la cohésion dans les rangs.
Les soldats westphaliens, bavarois ou encore italiens, peu motivés par la campagne,
désertent. Les soldats qui reviennent de Moscou, chargés de leurs pillages, sont
ralentis.
Arrivé à Smolensk le 9 novembre, Napoléon constate qu’il ne peut s’y établir comme
il le souhaitait. Il quitte alors la ville le 14, sous -25°C, devant l’avancée des corps
russes qui cherchent à l’encercler. Malgré un sursaut de courage, l’armée française
ne cesse de fuir. Après un affrontement à Krasnoïe du 16 au 19 novembre, le
fantôme de la Grande Armée arrive finalement sur les bords glacés de la Berezina le
24, pour s’apercevoir que les troupes russes gardent tous les passages. La chance
permettra heureusement à Napoléon de faire traverser l’essentiel de ses grognards
du 27 au 29, les retardataires se faisant massacrer par les troupes de Koutousov.

Suite à l’annonce d’un coup d’état à Paris fondé sur la rumeur de sa disparition en
Russie,
Napoléon doit quitter l’armée française pour la capitale le 5 décembre.
De leur côté, chassés de Vilna puis de Kovno, les survivants de la Grande Armée
arrivent enfin à repasser le Niémen le 13 décembre 1812. C’est la fin de la
désastreuse Campagne de Russie.
Analyse cindynique
La Grande Armée a toujours été victorieuse sur terre. Sûres de leur suprématie, ce
sont toutes les troupes napoléoniennes qui croient que le nom même de « Grande
Armée » et le renom de Napoléon suffisent à assurer la victoire. Il est évident pour
eux que si l’Empereur se déplace, c’est pour vaincre, comme d’habitude. De plus
l’armée russe est dispersée dans tout le pays et Alexandre 1er a peu d’expérience.
Bien que cette façon de penser remonte le moral des troupes, elle devient
dangereuse quand même Napoléon semble s’y accrocher (vouloir prendre St
Petersbourg après Moscou). En pleine retraite le 24 octobre 1812, Napoléon
déclare : « je bats toujours les russes, mais cela ne termine rien. »
L’objectif est simple voire simpliste.
Jusqu’à son départ de l’ancienne capitale, Napoléon croira que la prise de Moscou
lui assurera le symbole politique nécessaire à la signature de la paix. Ce sera la plus
grande erreur de la campagne, qui l’incitera à écarter toutes les solutions pour s’en
sortir.
Il croira également (tout comme les soldats de son armée) qu’un seul affrontement
scellera, comme d’habitude à l’époque, le sort des Russes.
Les Russes vont systématiquement détruire ce qu’ils ne peuvent emporter lorsqu’ils
se replient.
Ils pratiqueront même la politique de la terre brûlée (voire celle de la ville brûlée…).
Bien que cette méthode remonte aux Huns, voire aux Scythes, Napoléon ne semble
pas avoir une seule fois considéré cette éventualité.
Plusieurs manques d’informations seront fatals à la Grande Armée. Par exemple, lors
de la journée du 14 septembre, des fumées pouvaient se voir depuis les fenêtres du
Kremlin. Cependant Napoléon ne sera informé de l’incendie de Moscou qu’au milieu
de la nuit.
Plus tard on ne lui signale pas présence des troupes russes qui empêchent la
traversée de la Bérézina
Durant la première phase de la campagne, Napoléon va chercher l’affrontement à
tout prix, en écartant toutes les autres alternatives (même si il a le mérite d’y songer -
cf. réflexion à Smolensk fin août 1812 - ).
Le principal responsable est bien sûr Napoléon lui-même.
Il semble qu’au-delà d’une mauvaise communication, l’incendie de Moscou se soit
propagé du fait de la désorganisation de l’armée livrée au pillage dans la ville. La
retraite est d’autant plus dure que les soldats sont chargés de leur butin.
Les généraux ne tiennent plus leur troupe.

L’empereur français n’a pas utilisé les connaissances qu’il avait des grands faits
guerriers historiques.
Bien que la politique de la terre brûlée ait existé au cours de l’Histoire, Napoléon ne
semble pas avoir considéré cette tactique, malgré sa grande préparation avant la
campagne. De même, il a été surpris par les rigueurs de l’hiver russe que les russes
appelaient eux même, le général Hiver.
Lors de la prise de Moscou, les troupes s’installent dans les palais impériaux sans
prendre le temps de « sécuriser » la ville.
Le fait de ne pas penser à la politique de la terre brûlée est illustré par le manque de
procédures de surveillance et de vérification des pompes lors de la prise de Moscou.
Cette inspection aurait pu prévenir Napoléon de l’incendie à venir. De même il aurait
pu s’assurer des passages sur la Bérézina.
Les soldats, formés pour l’affrontement en bataille rangée, ne sont manifestement
pas formés à la vérification de la sûreté d’une ville mais plus enclins à son pillage.
Bien qu’ayant triomphé de multiples périodes de crise, Napoléon semble perdre son
sang-froid à Moscou, en alternant lucidité et aveuglement. Il ne s’est pas retrouvé en
campagne depuis 1809, et, contrairement à ses maréchaux, semble avoir en partie
perdu sa faculté de réflexion en temps de crise, faute d’être resté trop longtemps à
l’écart des champs de bataille. Il est aussi perturbé par les nouvelles de Paris où, le
croyant mort, certains de ses adversaires fomentent un coup d’état.
Déficits Systémiques Cindynogènes
Le 11 septembre nous a appris tragiquement qu’il est toujours difficile d’imaginer que
l’adversaire puisse se comporter de manière suicidaire et sans aucun sentiment
humain.
Moscou brûlera avec ses trésors culturels tandis que les soldats de l’Empire se livre
au pillage des maisons.
Napoléon lui-même est stupéfait : « cela dépasse tout : c’est une guerre
d’extermination, c’est une tactique horrible, sans précédent dans l’histoire des
civilisations …Brûler ses propres villes !
Le démon inspire ses gens… des barbares ». Il mesure combien est profonde la
haine que lui portent les russes.
Lors de la retraite, les retardataires pour traverser la Bérézina seront tous massacrés
par les russes, pas de prisonniers.
La retraite se fait en aveugle dans chaque camp. Koutousov prévient Tchitchakov qui
ne l’écoute pas : « Napoléon fera croire qu’il passera la Bérézina à un endroit, et il
passera en un point opposé » C’est ce qui se passa et Napoléon s’écria : »j’ai trompé
l’amiral ! ».
Beaucoup d’erreurs furent commises de part et d’autres soit par ignorance de la
psychologie de l’adversaire soit par absences d’informations sur les nombres de
soldats et leur positionnement précis.
Napoléon a oublié que les Russes préfèreraient brûler une ville comme Moscou
plutôt que lui permettre de s’installer sur leurs terres. Le peuple russe n’avait en effet
pas connu d’envahisseurs pendant deux siècles. L’arrivée de la Grande Armée
sonnait donc le glas de leur tranquillité qu’ils étaient prêts à tout pour défendre leur
pays. Lors de l’incendie de Moscou, par humanité, les prisons sont ouvertes, les

prisonniers libérés se livrent aux pires sévices et les hordes de pillards sont partout à
l’ouvrage.
Napoléon fait passer un message au tsar, mais il croit que Koutousov, homme
d’honneur, lui transmettra ses offres de paix ce qu’il ne fait pas.
La politique de la terre brûlée n’a jamais été considérée comme un modèle plausible
lors de la préparation de la campagne. Cet oubli a entraîné la perte d’une ville
comme Moscou (qui aurait pu servir de camp retranché) et l’aggravation du problème
de ravitaillement.
Par ailleurs Napoléon a misé sur l’inexpérience du jeune tsar et plutôt compté sa
peur que sur son orgueil. Il ne connaissait pas les réactions dont pouvaient être
capable ce monarque.
Il y a un énorme manque d’informations durant cette campagne. Napoléon ne
disposait manifestement pas d’un réseau d’espions efficace, ce qui lui a fermé des
opportunités de victoire. Il ne savait pas combien de temps il faudrait à l’armée russe
pour se réunir.
Ainsi, en octobre, quelques semaines après la prise de Moscou, la connaissance de
la localisation et surtout des effectifs des troupes de Koutousov lui aurait permis
d’écraser l’armée russe avant qu’elle n’obtienne des renforts.
(il est à noter que Koutousov manquera de la même façon une occasion d’écraser
Napoléon lors de la retraite, du fait d’une méconnaissance des positions françaises)
Le maréchal Oudinot n’informe l’empereur que le 24 novembre que l’amiral
Tchitchakov est parvenu à la Bérézina et en garde tous les passages.
Pour parler cindynique, l’axe statistique de l’hyper espace du danger est évidemment
extrêmement important dans un contexte de crise militaire (pas seulement dans ce
cas bien sûr), et sa maîtrise entraîne souvent la victoire.
Napoléon sous-estima avec sans doute un certain mépris la capacité d’un
comportement nationaliste chez les russes. Hitler fera la même erreur !
La première manifestation de cette disjonction se produit quand Napoléon se trouve
encore à Moscou.
Bien que sachant qu’il lui faut partir de la ville qui manque de vivres, il ne peut s’y
résigner de peur de paraître faible face aux Russes. Il perd ainsi de précieuses
semaines d’automne.
Fierté corse ou tout simplement manoeuvre stratégique, il devra pourtant se résoudre
à débuter la retraite le 26 novembre à moins d’un mois de l’hiver.
Par la suite, la nécessité de se déplacer le plus rapidement possible va poser
problèmes aux blessés et aux malades qu’il faudra alors abandonner, allant ainsi à
l’encontre des valeurs militaires usuelles de solidarité, et donnant encore plus l’image
d’une fuite désespérée.
De leur côté, devant un tel spectacle, certains soldats (principalement français)
préfèreront déserter pour (tenter de) survivre plutôt que de remplir leur serment de
fidélité à leur Empereur.
Ces disjonctions objectifs/règles et objectifs/valeurs sont extrêmement importantes
lors de l’analyse cindynique d’une crise militaire. Il est alors nécessaire de prévenir
les désertions qu’elles ne manquent pas d’entraîner.
Dans un contexte militaire, il y a bien souvent divergence entre les modèles et les
données. Ici, il est évident que si Napoléon s’attendait à une certaine résistance du
peuple russe, il ne s’attendait sûrement pas à l’incendie de leur propre ancienne
capitale. Le rassemblement de l’armée russe éparpillée sur des milliers de kilomètres
fut aussi d’une rapidité étonnante.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%