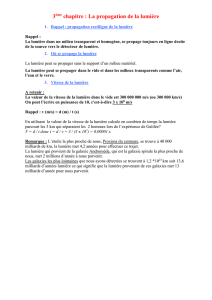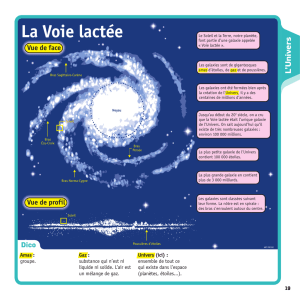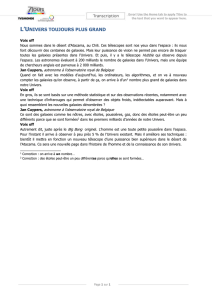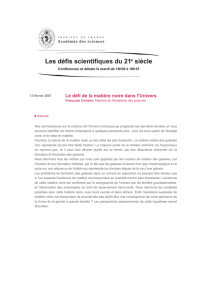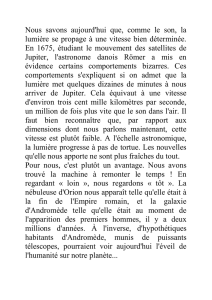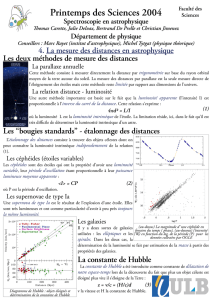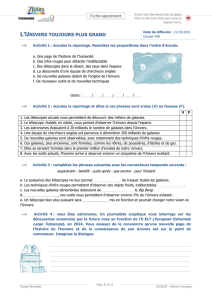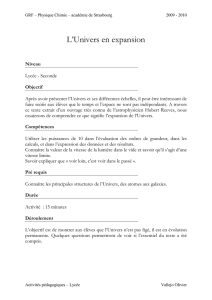LA LUMINOSITE DU CIEL NOCTURNE

LA LUMINOSITÉ DU CIEL NOCTURNE
D’après un texte de Christian Magnan (Collège de France, Univ. de Montpellier II),
remanié dans le cadre de la mécanique classique.
L'astronome Olbers a jadis soutenu que la noirceur du ciel était
paradoxale car dans un univers illimité ce ciel devrait être
uniformément tapissé d'étoiles et donc se montrer très lumineux.
Comment calculer la luminosité du ciel nocturne et résoudre du
même coup ce paradoxe ? Voici un texte, illustré de quelques
formules, qui apporte la réponse.
Nous nous plaçons dans un univers en expansion puisque nous savons que notre Univers est de ce
type. Il serait difficile autrement de s'appuyer sur un calcul statique (donc erroné) pour tirer, de la
luminosité observée, des conclusions sur la structure de notre Univers. (Cependant le résultat
s'appliquera aussi au cas statique.)
Il s'agit bien toutefois d'un calcul d'ordre de grandeur. Nous nous permettons de ce fait d'adopter
certaines hypothèse simplificatrices. Nous supposons en particulier que l'univers est peuplé
uniformément de galaxies toutes identiques, chaque galaxie émettant une énergie (ou luminosité)
totale L , constante au cours du temps. Nous ignorons aussi la répartition spectrale de cette énergie,
c'est-à-dire la proportion allouée aux différents domaines de longueur d'onde.
Une galaxie sera repérée par sa distance à la Terre, notée r.
La galaxie de coordonnée r que nous observons sur Terre au temps T a émis son rayonnement
isotropiquement, dans toutes les directions. Par conséquent tous les points situés à la même distance
que la Terre recoivent à l'instant T le même rayonnement. Donc cette lumière est répartie
uniformément sur une sphère centrée sur la galaxie et de rayon r .
Pour bien signifier que le rayon de l'univers dépend du temps T, nous le noterons plus
précisément a(T). La surface de cette sphère vaut
2
S 4 .a (T)
Un télescope de surface collectrice unité ne captera que la fraction (1 / S ) de la luminosité totale L
(L étant la puissance émise), c'est-à-dire la quantité (L / S ).
Ce facteur de dilution géométrique n'est pas le seul à entrer en ligne de jeu. Dans un univers en
expansion deux autres facteurs sont à considérer pour passer de la luminosité intrinsèque L de la
galaxie à la luminosité observée sur Terre. L'un prend en compte le fait que la longueur d'onde
augmente avec l'expansion (et donc leur énergie décroît en proportion), l'autre le fait que l'intervalle
de temps séparant deux photons successifs à la réception est plus grand que celui qui les séparait à

l'émission (par conséquent, pendant le temps de la mesure on recevra en proportion moins de
photons, d'où moins d'énergie). Il suffit de penser à des fourmis cheminant sur un élastique qu'on
étire pour comprendre que ces facteurs sont tous les deux égaux au rapport des rayons de l'univers
entre l'instant de l'émission et l'instant de l'observation.
Au final le résultat est que pour trouver la luminosité reçue il faut multiplier la quantité (L / S )
précédente par le facteur [ a (tem) / a (T) ] 2 , tem désignant l'époque d'émission et a (tem) le rayon de
l'univers lors de l'émission ( T , rappelons-le, est la date de la réception).
Pour l'instant nous nous sommes limités à la luminosité d'une seule galaxie. Il faut maintenant
additionner les luminosités de toutes les galaxies accessibles. Commençons par considérer les
sources de lumière situées à la même distance r. Plus exactement, car il faut nous donner un
volume, nous considérons les galaxies dont la distance relative est comprise entre r et (r + dr). Cet
ensemble de galaxies est donc situé dans une couche sphérique d'épaisseur dr limitée par deux
surfaces sphériques dont l'aire vaut
2
4 .r
, donc dans un volume
2
dV 4 .r .dr
.
Le nombre de galaxies contenues dans cette couche est donc
2
dN n.4 .r .dr
en notant n le nombre
de galaxies par unité de volume. Attention, ce volume se calcule avec des valeurs de r considérées à
l’instant d’émission…
Attention ! Dans notre univers en expansion, le nombre de galaxies par unité de volume (appelé
improprement en astrophysique, mais très couramment au point que je reprendrai le terme,
« densité » de galaxies) n'est pas constant, puisque le volume augmente alors que le nombre de
galaxies, nous le supposons, reste le même. En revanche, le produit n a 3 reste constant : on a
3total
4n.a (T) N
3
.
Revenons à la luminosité. Nous devons additionner les quantités (L / S ) des dN galaxies contenues
dans notre volume élémentaire, soit (L / S ) × dN .
On trouve alors facilement que les galaxies situées dans la couche élémentaire contribuent à la
luminosité totale à raison de
2
total total
émi tot émi tot émi
NN
L. .4 .r .dr L. dr
S V (t ) V (t )
, et en tenant compte du
facteur de dilution dû à la dilatation de l’Univers
22
2
total emi total emi
émi tot émi tot émi
N a(t ) N a(t )
L. .4 .r .dr. L. .dr.
S V (t ) a(T) V (t ) a(T)
(1).
Il faut maintenant faire la somme des contributions de toutes les couches de galaxies dont nous
recevons la lumière à l'instant T considéré. Tous les termes sont constants (c'est-à-dire ne dépendent
pas de la couche choisie, donc de la variable r) et la sommation des dr successifs donnera tout
simplement
emi
a(t )
, la distance des galaxies les plus lointaines que nous puissions détecter, c'est-à-
dire des galaxies situées à l’horizon. Autrement dit l'énergie totale reçue sur
Terre au temps T , par unité de surface de détecteur, est
total
tot
N
E L. .a(T)
V (T)
. (2)

Cette puissance est proportionnelle à la distance maximale sondée de l’Univers. C’est la distance à
laquelle se trouverait cet horizon si on stoppait brutalement l'expansion de l'univers. En appelant D
cette distance aux dernières galaxies visibles, nous arrivons à la formule simplissime
E n.L.D
(3)
Rappelons : E est la luminosité totale de toutes les galaxies visibles ; L est la luminosité d'une
galaxie ; n est la densité actuelle des galaxies ; D est la distance de l'horizon universel.
Le trait principal de cette formule est le terme en D, qui montre que la luminosité augmente
linéairement avec la distance sondée, ce qui a priori n'était pas évident. En fait la quantité de
galaxies visibles augmente comme le cube du rayon de la sphère les contenant (autrement dit
comme le cube de leur distance) mais comme nous ne recevons d'une galaxie qu'une énergie
inversement proportionnelle à leur distance il reste bien une somme d'énergies variant comme la
distance (des galaxies émettrices). Autre façon de dire les choses : nous avons vu plus haut qu'il y
avait dans ce calcul compensation entre la surface de chaque couche proportionnelle à r 2 et ce que
l'on appelle le « facteur de dilution », en 1 / r 2 (dû au fait que toute la lumière d'une galaxie donnée
est répartie dans tout l'espace et que par conséquent nous n'en récupérons qu'une fraction).
La présence de ce terme linéaire en distance est à l'origine de ce que l'on appelle couramment le
paradoxe d’Olbers. En effet si nous supposons que l'univers a toujours existé et qu'il s'étend aussi
loin que l'on puisse imaginer, nous sommes conduits à adopter une distance D infinie. Dans ces
conditions l'expression de la luminosité diverge et il est impossible d'expliquer pourquoi le ciel est
noir la nuit.
En fait renversons le raisonnement. Nous observons une certaine luminosité E du ciel nocturne.
Nous avons à notre disposition la formule (3) dans laquelle nous pouvons introduire une valeur n
de la densité des galaxies et une valeur L de la luminosité. Voyons alors ce que nous pouvons en
déduire comme valeur D de la distance à l'horizon.
L'application numérique est instructive.
Consultons les « bons ouvrages », c'est-à-dire les recueils de données astronomiques (par exemple
la fameuse compilation Astrophysical Quantities, de C.W. Allen). On estime la luminosité des
étoiles contenues dans les galaxies à environ 5×108 luminosités solaires par mégaparsec cube (1
luminosité solaire équivaut à 4×1033 ergs par seconde). Comme un mégaparsec fait 3×1024
centimètres, le produit n L de la formule (3) vaut 6,5×10-32 ergs par seconde et par centimètre cube
(luminosité totale des galaxies émise par unité de volume ; je sais, le choix du centimètre cube pour
mesurer des volumes contenant des galaxies est particulièrement malvenu). Que donne l'observation
pour la luminosité du fond de ciel ? La question est difficile. D'abord la quantité recherchée est
délicate à isoler du reste des sources lumineuses qui parsèment le ciel : il faut notamment éliminer
toutes les étoiles pour accéder à la lumière des galaxies lointaines. Ensuite il faudrait préciser le
domaine de longueur d'onde dans lequel se fait la détection, mais cela nous emmènerait trop loin.
Cependant une indication précieuse est que l'unité usuellement utilisée par les astronomes pour
mesurer la luminosité du fond du ciel est une étoile de dixième magnitude par degré carré. À quoi
correspond cette quantité ? Une magnitude de 5 équivaut à un soleil placé à 10 parsecs. Une étoile
de dixième magnitude correspond à un astre cent fois moins brillant, c'est-à-dire à un soleil situé à
100 parsecs. Sur Terre on détectera sa lumière à raison d'un flux d'énergie
de 3×10-9 erg cm-3 s-1. Il nous faut ajouter maintenant la contribution de tous les degrés carrés du

ciel. Comme un degré carré vaut ( / 180)2 stéradian, le nombre de degrés carrés sur tout le ciel est
de 4 ×( / 180)-2, soit 41 253 et la luminosité de tout le ciel supposé occupé par une étoile de
dixième magnitude par degré carré est de 10-4 erg cm-3 s-1.
En comparant la source ultime de lumière n L = 6,5×10-32 et la luminosité unité observée E = 10-4,
nous arrivons grâce à la formule (3) à une échelle caractéristique de distance D, ou mieux D / c, en
unités de temps, d'environ 2 milliards d'années de lumière.
Ce résultat est étonnamment satisfaisant. Rappelons en effet que notre calcul est très grossier (il se
base sur des hypothèses fort simplificatrices sur la physique des galaxies, leur formation, leur
évolution, leur répartition dans l'espace ; il ne tient aucun compte de la répartition de la lumière
selon sa longueur d'onde) et n'est destiné qu'à illustrer les ordres de grandeur en cause. À cet égard
ce calcul atteint pleinement son but car il fournit un temps caractéristique, de l'ordre de quelques
milliards d'années de lumière, qui concorde entièrement avec des temps calculés par ailleurs. On
sait par exemple que l'âge de l'Univers est estimé à la douzaine ou quinzaine de milliards d'années.
Par conséquent, la présence d'un horizon cosmologique à une distance se comptant en milliards
d'années de lumière explique pourquoi le ciel est noir.
À l'heure actuelle, il n'y a plus de paradoxe. La luminosité observée du ciel est explicable dans ses
grandes lignes. Elle est compatible avec l'idée d'un univers en expansion depuis une durée se
chiffrant en milliards d'années. La luminosité du ciel est due à celles des galaxies dont la lumière a
eu le temps de parvenir jusqu'à nous, les galaxies plus lointaines demeurant encore invisibles. Leur
nombre s'élève peut-être à quelques milliards (selon la taille moyenne choisie), quantité tout à fait
limitée, qui rend compte du fait que le ciel nocturne ne soit pas plus brillant que ce qu'il est.
Paradoxe ou non, l'étude de la luminosité du ciel est riche de leçons. Cette noirceur à laquelle nous
sommes tellement habitués n'est pas si « naturelle » qu'il y paraît. Il y a matière à rêver à contempler
les étoiles se détachant la nuit sur un fond (heureusement) sombre puisque nous découvrons en
même temps la structure de tout notre univers. Cette nuit témoigne, nous venons de le calculer, de
l'histoire de notre monde, de sa naissance, de l'apparition des galaxies et de l'expansion de l'espace.
ANNEXES : unités employés
Erg : unité d’énergie dans le système cgs 1erg=10-7J
Parsec : unité de mesure de longueur, fondée sur une parallaxe
( par-sec = parallaxe-seconde ) . C’est la distance à laquelle on voit
le demi-grand axe de l’orbite terrestre autour du soleil (à peu de chose près
le rayon de la trajectoire quasi-circulaire) sous un angle de 1 seconde d’arc.
On obtient , avec un demi-grand axe de l’ordre de 150.106 Km,
13
1pc 3,1.10 Km 3,3al
soit 3,3 années-lumière.
1
/
4
100%