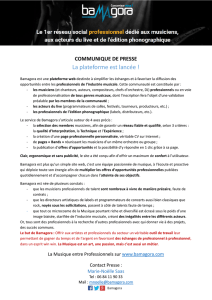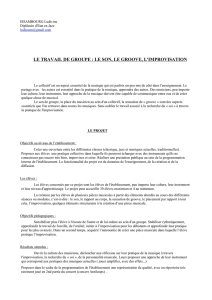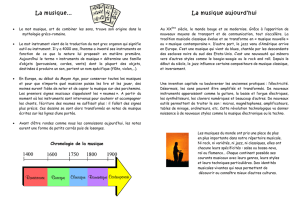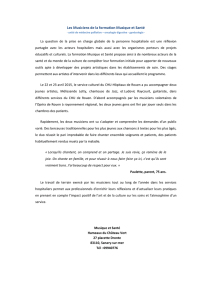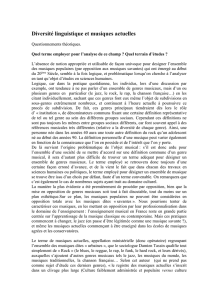I - Free

I. Avant la problématique :
1. Premières Approches
a. Les Cultural Studies : de la sociologie de la culture de masse aux sous-cultures.
Courant de recherche britannique engagé voyant le jour à la fin des années 1950 à Birmingham,
les Cultural Studies ont entrepris de façon précoce des recherches pertinentes et novatrices
traitant des rapports entre culture et société.Très attentifs, tels R.Williams, E.P.Thompson,
R.Hoggart et S.Hall, aux rapports entre les classes ouvrières, les cultures populaires et la
société, notamment leur réception des médias, ils théoriseront au cours des années 1960-70 les
capacités de résistance aux message des médias, selon Hoggart « la simple force d’inertie que
représente un style populaire de ‘consommation nonchalante’ qu’il symbolise par la formule
‘cause toujours’ ». Pour Jean Claude Passeron, les Cultural Studies relèvent d’une analyse
« idéologique » ou externe de la culture : « les activités culturelles des classes populaires sont
analysées pour interroger les fonctions quelles assument par rapport à la domination sociale.»
On peut constater que l’objet culture est ici pensé dans une problématique du pouvoir, qui
amène à un ensemble d’interrogations, selon Mattelart et Neveu, quatre y prennent une place
structurante :
- La notion d’idéologie (influences Marxiennes)
- la thématique de l’hégémonie (Formulée par le théoricien marxiste italien Antonio Gramsci).
« L’hégémonie est fondamentalement une construction du pouvoir par l’acquiescement des
dominés aux valeurs de l’ordre social, la production d’une ‘volonté générale’ consensuelle »p
38
- La question de la résistance, et sous-jacente, celle des armes des faibles.
- La problématique de l’identité (se profilant « en filigrane »), qui amène à ajouter lors des
travaux de recherches des variables comme la génération, le genre, l’ethnicité la sexualité, et à
des questionnement sur le mode de constitution des collectifs et de structuration des identités.
C’est à la seconde moitié des années 1970 et au début des années 1980 que les problématiques
qui découlent de ces interrogations aborderont des sujets de plus en plus variés, étudiant les
rapports à la culture et à ses produits dans le quotidien des groupes sociaux, par le biais des
auteurs de la dite « seconde génération » de ce courant de recherche. Ces études vont alors
porter sur les pratiques culturelles « définies sans soucis de leur prestige social » p35, telles que
la publicité ou les musiques populaires, et vont s’étendre plus amplement sur l’audiovisuel et
ses émissions de distractions. C’est dans ce cadre que Simon Frith entreprend ses recherches
sur les musiques pop et rock. Dans son premier ouvrage, « The sociology of rock », il analyse

les rapports que ces musiques entretiennent avec la jeunesse, les loisirs, l’industrie du disque et
les médias (à l’époque, seulement la radio et la presse spécialisée), afin d’en dénoter les
éléments caractérisant « l’idéologie du rock » et de questionner les théorisations antérieures
s’articulant selon une dichotomie culture de masse/ culture d’élites.
Ses travaux s’intéressent premièrement à la réception de la musique chez les adolescents, le
rock étant perçu à cette période (les années 1960/70) comme un phénomène lié à la jeunesse. Il
en dégage certains principes sociologiques concernant la double importance de la musique pour
les jeunes groupes d’amis (peer-groups) : elle est un moyen par lequel le groupe se définit,
mais elle est également la source même de son statut interne SFp46, aidant ainsi à définir leur
identités personnelles par le biais du collectif. Un autre usage y est ajouté, d’avantage relatif à
un processus de distinction : « The second use of music-as-identity is to distinguish the young
from the old, to identify a place or occasion or time as youth’s property.» p 48 . Lors d’une
étude de terrain sur les relations entre la musique et les jeunes adolescents, Frith en ressort de
précieux éléments indiquant un certain réalisme vis-à-vis d’eux-mêmes et du monde qui les
entoure, « they know how commercial rock works, even as they enjoy it » SFp49. Il tente la
liaison de ces éléments avec l’approche sociologique s’intéressant aux sous cultures, mais
garde un point de vue critique vis-à-vis de celle-ci. « the thrust of sub-cultural approach is that
youth music is a symbol which expresses the underlying leisure values of the group which uses
it.”p 50 Cependant, si la musique peut être envisagée en tant que symbole de valeurs
récréatives, l’auteur indique l’étroitesse de cette approche, qui écarte les sub-culturalists de
penser la musique en tant qu’ « activité », ce qui est le cas de la majorité des jeunes
« non déviants». Cette approche a donc tendance à « geler » trompeusement le monde de la
jeunesse entre les déviants et les « autres ». Il faudrait donc selon lui penser d’avantage les sous
cultures et leurs liens avec la musique en termes d’usage et d’expérience que de symboles à
proprement parler.
Elargissant son analyse des sous culture à celle des « jeunes » classes de l’époque (les ouvriers,
les jeunes femmes, les étudiants), et la reliant à la réception de la musique en tant que loisir,
Frith nous incite à concevoir les loisirs comme une relation entre choix et contrainte, et indique
que les usages que ces classes en font sont différenciés. Puis, rendant compte des rapports entre
les musiciens avec la production industrialisée de la musique par l’intermédiaire du disque, de
la radio et de la presse musicale, il détermine un des principes de base qui caractérise
« l’idéologie du rock » : « The belief in a continuing struggle between music and commerce is
the core of rock ideology : at certain moments artists and audience break through the system,

but most of the time business interests are in control. »p191. Cette vision des dynamiques
articulant musique et commerce au sein de l’idéologie des musiques populaires et du rock se
retrouve également chez son homologue américain James Lull, utilisant pour les caractériser
l’opposition entre deux « modèles » au sein des l’industrie musicale : le « modèle de contrôle »
(« patterns of control ») indiqué par un certain conservatisme et une conventionalité dans toutes
les phases de production de la musique populaire, dont la majeure partie des contenus textuels
semblent aussi témoigner d’une certaine consensualité ; et le « modèle de résistance »
(« patterns of résistance ») illustré par un mouvement de protestation vis-à-vis du
gouvernement ou du système politique américain, ou plus généralement de la société
capitaliste.
Le « modèle de contrôle » est explicité par une forte concentration au sein du marché de la
musique, contrôlée par un nombre restreint de « majors », influant sur les contrats avec les
artistes, la production des albums et leur distribution. Ces majors, selon Lull, sont également
« intimement impliquées dans l’arrangement des performances live de ses artistes sous
contrats, (…) supervisent leurs interviews radiophoniques et orchestrent leur apparitions en
public ».pm&cp 14. Les techniques de programmation des grandes stations de radios
américaines, basées sur la répétition à outrance (« rotation system ») d’un nombre réduit de
titres (réunis sous le terme « top 40 »), sont également des caractéristiques de ce modèle.
Le « modèle de résistance », quant à lui, s’est formé dans les années 1960 en opposition au
« modèle de contrôle », et est caractérisé historiquement par la formation de sous-cultures dont
les artistes écoutés étaient majoritairement issus de groupes « opprimés » (initialement issus de
la classe noire et ouvrière). La diffusion de leur messages protestataires était néanmoins assez
large, passant par l’intermédiaire de nombreux labels indépendants et de stations de radios
« underground », n’ayant ni de technique de programmation spécifique ni de formats musicaux
imposés, et témoigna d’un immense succès auprès des sous cultures en formation (le
mouvement hippie), déstabilisant quelque peu les « majors » dans leur position dominante. Lull
remarque par la suite, à la fin des années 1970, un retour progressif à la domination de ces
derniers sur le marché de la musique, du à la déstabilisation du modèle de résistance (marquée
par la fin de la période punk), et à récupération par les majors des techniques effectives
utilisées par les radios et les labels indépendants. Le « modèle de résistance » se serait donc fait
peu à peu englober dans le « modèle de contrôle. » Cette position dominante sera accentuée par
la suite du fait de l’apparition de la musique à la télévision (les vidéoclips) et donc à sa mise en
scène de façon formatée, passage obligé et caractéristique de la production télévisuelle.

Ce retour en force vers le courant dominant de la musique (mainstream music) nous ramène
aux questionnements relatifs à la culture de masse et des idéologies qu’elle sous tend. Simon
Frith explore à ce propos le point de vue des théories marxistes, dont celui d’Adorno, analysant
à l’époque la musique « jazz » (terme désignant pour lui la « musique de masse » dans son
ensemble). Selon ce dernier le procès de culture de masse, par le biais de l’industrialisation de
l’art alors transformé en bien de consommation, a transformé simultanément la consommation
culturelle en un procès individualisant et aliénant. « Art has become entertainment, cultural
choice has become selection in the market place, popular creation has become the commercial
attempt to attract the largest possible number of consumers. Mass culture provides both a
pseudo-individualism and a pseudo-collectivism.» Ad cit/Frith p 194. La culture de masse, par
son réalisme, aurait donc selon lui « corrompu la base imaginative de l’art » comme source de
l’espoir humain, sa protestation utopique contre la réalité. Frith voyant dans cette analyse un
systématisme désarmant et difficilement récusable, constate cependant les faiblesses de celle-
ci : « The weakest point of his argumentation seems to be his account of cultural consumption
–the actual use of pop is scarcely examined, their passivity is assumed rather than investigated-
and it was the point that was developed by American media sociologists in the 1940’s. »SRp
195 Le point de vue acide d’Adorno sur la culture de masse de l’époque, et son manque
d’intérêt à l’égard des capacités de résistance de la réception s’explique selon l’auteur par le
manque d’opposition envers l’ordre social capitaliste jusque dans les années 1960, mais il
repère qu’à la même période Walter Benjamin inscrivait déjà des constatations similaires dans
une perspective plus positive. Dans « l’œuvre d’art à l’age de sa reproductibilité technique »,
s’il conçoit tel Adorno une modification de la relation des masses à l’œuvre d’art, vu sous
l’angle de la perte de l’autorité et de « l’aura » de l’art provoqué par la technologisation des
media de masse, celle-ci a ouvert des nouvelles possibilités pour le développement de moyens
d’expressions socialisants, le procès de création devenant collectif plus qu’individuel. Ces
conceptions redécouvertes dans les années 1960 éclairèrent certains chercheurs, tel Dave Laing,
soutenant que le rock comme les autres medias de masse est un lieu non pas de pluralisme
culturel mais de lutte culturelle (cultural struggle), « if the capitalist organisation of cultural
production is not entirely determined, then both artists and audiences can fight for the control
of the meanings of cultural symbols. Benjamin’s original point is remade : it is precisely the
technological and sociological basis of mass production that makes cultural struggle possible. »
srp 196. Selon Frith, il y a derrière ces arguments la suggestion explicite que certaines
musiques populaires expriment plus que la « culture du profit » ou l’idéologie d’une
consommation passive, le problème est de savoir comment les reconnaître.

Dans le but d’explorer l’idéologie du rock, l’auteur s’était résigné à la tentation d’analyser les
paroles, les textes des chansons à l’instar de la musique. « Most rock records make their impact
musically rather than musically –the words, if they are noticed at all, are absorbed, are
observed after the music has made his mark ; the crucial variables are sound and rythm. » Il
reviendra pourtant sur ce parti pris quelques années plus tard, dans son ouvrage “music for
pleasure”. Dans le chapitre “Why Do Songs Have Words”, Simon Frith analyse à travers les
écrits d’autres chercheurs ( Richard Hoggart, David Lodge, Dave Laing, Donald Horton...), et
des acteurs du “monde” de la musique ( producteurs, auteurs-compositeurs, critiques), les
différents thèmes abordés dans les paroles des chanteurs de musiques blues, soul, folk, country
et rock anglo-saxon, les “fonctions” occupées par ces thèmes ainsi que les “effets” possibles ou
impliqués par ces thèmes vis-à-vis de leurs auditeurs. Il met en opposition deux genres
principaux, dont nous pouvons constater les rapports directs avec les modèles « de contrôle » et
« de résistance » proposées par Lull. La « pop », qui représente selon l’auteur “l’idéologie
sentimentale” de la société capitaliste.mflp 109, la fonction de ses textes étant de transmettre
des sentiments et des émotions d’une certaine consensualité (lyrical banalities) et une forme
d’escapisme, abordant les thèmes de l’amour (thème très dominant) ou l’amitié, la joie de
vivre, et utilisant généralement le style direct (‘I’, ‘you’), impliquant selon Richard Hoggart
une « intimité forcée » (forced intimacy). Et le « folk » (à concevoir comme musique issue du
peuple, parlant du peuple) dont la fonction de ses textes est de traduire un certain réalisme
(lyrical realism) une « authenticité » vis-à-vis du monde qui l’entoure, abordant des thèmes tels
que la lutte de l’opprimé, le rejet de la société, et usant du conte (storytelling) ou du simple
témoignage pour transmettre leur pensées. Cependant l’auteur tient à rappeler le statut plausible
de « nonchalance active » du récepteur, les recherches empiriques effectuées par Robinson et
Hirsch dans un lycée américain suggèrent que “l’efficience” des messages chantés est limitée,
la majorité des jeunes personnes sondées ne portant pas d’attention particulière au sens de
paroles même protestataires, la minorité les ayant écouté plus attentivement ayant un point de
vue critique à leur égard.
Néanmoins, la prise en compte du point de vue du récepteur n’implique pas que les mots “ne
comptent pas”. S’il émet une distinction qualitative entre les genres folk et pop, il admet que
« le contenu textuel est une raison pour laquelle les gens achètent des disques ; les “hits”
instrumentaux restant inhabituels » p 120 L’auteur tente pour expliciter ce fait de rendre
compte de l’importance de la dimension “poétique” dans les chansons “pop”. Ces chansons
doivent selon lui se concevoir plus sous la forme de pièces que de poêmes, dans le sens ou les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%