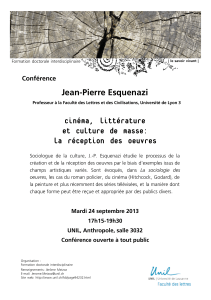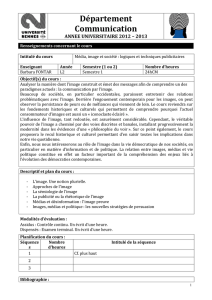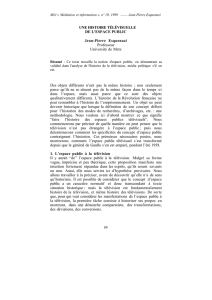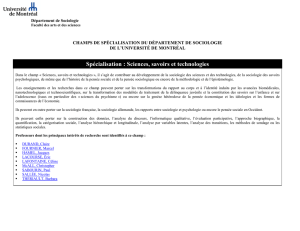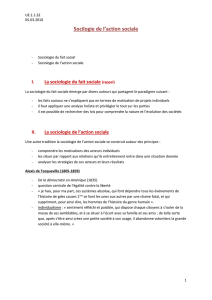Compte rendu d`Esquenazi (Jean-Pierre), Sociologie des œuvres

1
Notes de lecture
Compte rendu d’Esquenazi (Jean-Pierre),
Sociologie des œuvres. De la production à
l’interprétation, Paris, Armand Colin, 2007,
227 p.
Clément Dessy
Index | Plan | Texte | Notes | Citation | Auteur
Entrées d'index
Mots-clés :
Sociologie des arts
Haut de page
Plan
Qu’est-ce qu’une œuvre ?
Pour une sociologie des oeuvres
Haut de page
Texte intégral
Signaler ce document
1Depuis Marcel Duchamp et l’élaboration du concept de ready-made, l’art contemporain a
donné de nombreux coups de canif dans une conception de l’objet artistique qui le percevait
comme « unique », d’un point de vue matériel. Pourtant, l’interprétation d’une œuvre d’art –
sa « signification » ou son « sens » – demeure encore subordonnée à cette pensée de la
« singularité ». L’esthétique recherche dans l’œuvre même des propriétés originales qui lui
sont intrinsèques. Et si, comme le suggère Esquenazi, ce qui définissait en fait un objet
comme œuvre d’art provenait de la « relation que [celle-ci] entretient avec un collectif humain
donné » (p. 5) ?
2Comme prémices à son analyse, l’auteur reprend la conception esthétique de l’œuvre pour
s’y opposer d’emblée. Prenant pour exemple la Joconde, il remarque que ce n’est pas l’objet
que nous considérons comme « La Joconde » mais un signe, association d’éléments
signifiants non matériels (p. 5). De ce point de vue, il apparaît évident que ce signe ne fut pas
le même pour François Ier ou un touriste russe en visite au Louvre, pour reprendre l’exemple
de l’auteur. Néanmoins, un constat s’impose : la question de l’œuvre peine à trouver sa place
dans les sciences sociales. Dans cet ouvrage, Esquenazi entreprend une « réconciliation »
entre l’étude de l’œuvre et les méthodes sociologiques.

2
3Le travail est divisé en deux parties. La première interroge le concept d’œuvre afin d’en
proposer une définition originale qui se démarque de l’approche esthétique. La seconde
propose un parcours bibliographique qui classe la diversité des études sur les arts et la culture
selon le modèle formulé dans la première partie.
4Précisons d’emblée qu’Esquenazi entend le terme d’œuvre dans un sens vaste, désignant tout
projet de sémiotisation par l’artiste et ne dépendant pas du support (soient tableau, livre,
sculpture, pellicule, etc.) En outre, en bon sociologue, il ne s’attache pas seulement à analyser
le canon de l’art mais se préoccupe de tout objet culturel, la légitimité culturelle étant
comprise comme une construction sociale et non comme une caractéristique définitoire d’une
œuvre.
Qu’est-ce qu’une œuvre ?
5Le premier chapitre récapitule les différentes positions à l’égard de l’œuvre, émises par
Roland Barthes, Théodor Adorno et Ernst Gombrich. Loin de dénier toute avancée à leurs
approches, Esquenazi montre que ces auteurs n’ont pas toujours exclu une approche sociale
des œuvres. Cependant, leurs conceptions n’ont pu s’affranchir des postulats esthétiques :
Barthes clôture l’œuvre comme isolat formel dont l’analyse de la structure interne révèle la
seule signification valable ; Adorno réduit le corpus des œuvres à celles qui nient l’ordre
social et limite leur critique à une élite d’« experts » ; Gombrich considère que la production
et la réception d’une œuvre obéissent à des schémas en vigueur dans une société mais qu’un
chef-d’œuvre échappe à toute considération sociale en devenant « classique » et en suscitant
une admiration « unanime » d’experts.
6Pour Esquenazi, Barthes commet une erreur en attribuant une seule signification valable à
l’œuvre (celle qui émane de sa « structure »). Il y perçoit un nouveau mythe de perfection qui,
s’il ne s’attribue plus à un auteur « génial », est à présent déplacé vers une œuvre « géniale ».
Quant à Adorno, sa vision élitiste de l’art, bien qu’argumentée, est peu compatible avec la
large définition sociologique d’Esquenazi, englobant l’art « légitime » comme le populaire.
Enfin, l’auteur souligne que Gombrich ne parvient pas à décrire l’accession d’un produit
culturel au titre de « chef d’œuvre » : combien d’experts faut-il pour atteindre un jugement
unanime ? ce jugement sera-t-il uniforme suivant les experts ? la reconnaissance d’une œuvre
n’a-t-elle pas varié en fonction des époques ?
7Dans le second chapitre, l’auteur explore les propositions majeures de Pierre Bourdieu, Jean-
Claude Passeron, Nathalie Heinich et Antoine Hennion.
8La notion bourdieusienne d’« économie symbolique des œuvres » qui montre qu’une œuvre
ne peut être considérée comme autonome semble incomplète puisqu’elle s’intéresse
exclusivement aux objets légitimes. L’économie du désintéressement (le « désintéressement
intéressé ») ne peut s’appliquer à toutes les œuvres. Toutes ne furent pas produites dans un
champ (ex. la musique baroque) et certaines, même légitimées, ont largement participé à une
logique intéressée (ex. Alexandre Dumas). D’autre part, l’œuvre n’est-elle qu’une
« différence symbolique introduite pas son auteur pour s’opposer aux œuvres de ses
concurrents » (p. 36) ?
9Passeron s’est interrogé sur la notion de « valeur » attribuée à l’œuvre. Selon lui, la
recherche sociologique aurait pour objectif d’analyser les différences de valeurs. Toutefois, il

3
semble en effet que se confondent fréquemment une valeur de singularité (originalité de
l’œuvre) et une valeur de légitimité (reconnaissance de l’œuvre). Pour éviter toute confusion,
Esquenazi estime qu’il faut admettre l’existence de ce double calcul dans l’économie
symbolique des œuvres.
10Esquenazi s’inspire de Nathalie Heinich pour proposer d’analyser non seulement les
valeurs de l’œuvre mais aussi l’ « œuvre en acte », c’est-à-dire ce que l’œuvre fait. L’attention
consacrée aux actes et à leur « réfraction » dans l’œuvre permet à l’auteur de penser
l’articulation entre les deux valeurs énoncées : « la place légitime que les acteurs [sociaux]
accordent à l’œuvre repose sur une argumentation concernant sa singularité ».
11L’intervention des idées d’Antoine Hennion vient mettre une touche finale à la première
exploration sociologique : « l’œuvre ne cesse pas de se transformer » en fonction des
collectifs auxquels elle est présentée ; son support voit sa perception évoluer.
12Dans le troisième chapitre, l’auteur formule sa propre définition de l’œuvre comme
processus établi sur trois temps :
- le temps de la production ;
- l’événement de la déclaration, où l’objet encore seulement candidat devient effectivement
« œuvre » ;
- la temporalité dispersée de l’interprétation où l’œuvre appartient à ces publics. (p. 49)
1 Baxandall (Michael), Formes de l’intention, Nîmes, Édition Jacqueline Chambon,
1991, p. 89-91.
13Au stade de la production, Esquenazi définit le fonctionnement de l’institution culturelle ou
artistique. S’inspirant de Michael Baxandall1, l’auteur reprend l’idée de penser celle-ci
comme un marché « où les profits et les pertes sont financiers ou symboliques et parfois
financiers et symboliques » (p. 54). L’institution réalise des projet qui interviennent dans la
fabrication de l’œuvre et qui sont dénommés directives. Les œuvres décrites comme des
processus symboliques intentionnels peuvent dès lors être pensées en dehors de toute
psychologisation : on ne cherche plus le désir mystérieux de l’auteur mais comment ce dernier
inscrit son œuvre dans l’institution ou comment il cherche à s’en différencier.
14Les fins de l’auteur sont donc délimitées par les directives. Pour les poursuivre, l’artiste
doit par principe disposer de moyens. Esquenazi rassemble ces moyens sous l’appellation de
modèles. Selon Baxandall, tout modèle doit être compris comme double car il désigne autant
un modèle de l’activité qui conduit à la réalisation de l’œuvre – sa réalisation pratique – qu’un
modèle de l’œuvre à accomplir. Les modèles sont régis par des règles qui expliquent les
ressemblances entre les œuvres.
2 Goldmann (Lucien), Pour une sociologie du roman, Paris, Gallimard, 1964 et Sartre
(Jean-Paul), L’Id(...)
15L’énonciation, concept repris à la linguistique, correspond à l’acte de production. Cet acte
s’accomplit au sein d’une institution selon une des directives qui la définissent. L’agent

4
emploie les modèles qui sont attachés à cette directive afin de façonner son œuvre. Une
œuvre peut donc être comparée à celles qui s’inscrivent dans le même modèle énonciatif, ce
qui ne l’empêche pas d’avoir un pouvoir expressif, c’est-à-dire d’exprimer la situation de
l’institution qui l’a produite. Il faut cependant se limiter à ce cadre. L’auteur s’oppose ici
aux ambitions « démesurées » de Lucien Goldmann et de Jean-Paul Sartre2 : l’œuvre ne peut
être le condensé de toute une époque.
16D’autre part, on peut considérer l’œuvre comme une reformulation de la situation de son
institution productrice, comme paraphrase. Il s’agit alors de mesurer l’écart entre
l’énonciation et ses modèles et en quoi celui-ci est également signifiant.
17Esquenazi définit ensuite l’étape de l’interprétation, qui débute dès la déclaration d’une
œuvre à un premier public. C’est à partir de ce point qu’une « œuvre » accède au statut qui
est le sien, qu’elle est déclarée prête à être le support de descriptions. L’essentiel de la
déclaration consiste, d’après Esquenazi, en une identification du genre d’œuvre (« c’est un
tableau romantique », etc.) et de la directive que les « fabricants » ont suivie. La déclaration
prépare donc à la présentation et à l’interprétation proprement dite de l’œuvre qui peut elle-
même connaître diverses déclarations. Un public qui acquiesce à une déclaration particulière
forme dès lors une communauté d’interprétation. Esquenazi perçoit une symétrie globale
entre le fonctionnement de cette dernière et celui de l’institution de production. L’institution
produit l’œuvre matériellement et la communauté d’interprétation l’accomplit en la dotant
d’une signification. En étudiant cette communauté comme lieu d’interprétation de l’œuvre, il
ne s’agit pas de déterminer comment une différence sociale peut créer des divergences
d’appréciation mais d’analyser la composition d’une communauté qui attribue des propriétés
identiques à une œuvre.
18Se référant de nouveau à Baxandall, Esquenazi énonce l’idée que toute interprétation est à
la fois description et jugement d’une œuvre. L’interprétation se déroule en plusieurs phases :
- une phase d’attribution : la directive qui aurait conduit les producteurs est identifiée ;
- une phase d’orientation : la figure de l’énonciateur et le modèle de l’œuvre qui serviront
d’unité de mesure à l’expertise sont définis ;
- une phase d’expertise : l’œuvre est examinée à l’aune des modèles retenus. (p. 80)
19L’attribution, c’est-à-dire la reconnaissance par les interprètes de la directive employée par
les producteurs, définit un cadre qui oriente la description. Esquenazi remarque que l’on
risque d’admirer La Composition avec rouge, jaune et bleu (1921) de Mondrian comme un
quadrillage si l’on n’a pas reconnu la directive « œuvre abstraite ». Enfin, dans les limites
fixées par le cadre, chaque public construit sa « version » de l’œuvre.
20Prolongeant l’idée d’une symétrie entre production et interprétation, Esquenazi montre la
possibilité d’une seconde paraphrase au niveau interprétatif. Étant donné l’attachement d’un
sens à une communauté interprétative, si l’œuvre achevée est une paraphrase de la situation de
ses énonciateurs, l’œuvre interprétée peut aussi reformuler la situation d’une communauté
d’interprètes.

5
21La description des processus de production et d’interprétation permet à l’auteur de finaliser
sa définition de l’œuvre : « un processus symbolique produit au sein d’une institution
culturelle selon les règles d’un modèle énonciatif spécifique puis interprété ou réinterprété au
sein de communautés interprétatives à travers des reconstitutions de son énonciation » (p. 87).
Pour une sociologie des oeuvres
22Sur base de cette définition, l’auteur propose de décrire les études consacrées aux aspects
sociaux des œuvres et de les situer dans le processus qu’il a détaillé. Loin de faire table rase, il
entend montrer que l’apparente diversité de la littérature scientifique consacrée à l’art –
entendu dans son acception la plus vaste – est un leurre et que ce « chaos » se résout de lui-
même pour qui comprendra l’œuvre comme un processus.
23Chacun des six chapitres de la deuxième partie est donc dédié à une étape particulière du
processus où sont résumés et présentés une série de travaux majeurs selon leur localisation
dans ce processus. Successivement, l’auteur examine :
- des ouvrages qui s’intéressent aux institutions de l’art et de la culture et aux directives qui en
émanent ;
- des travaux qui analysent le processus de fabrication des œuvres que nous avons nommé
énonciation ;
- des recherches sur le pouvoir figuratif ou paraphrastique des œuvres : celles-ci y sont
considérées comme une image indirecte de l’institution et de ses méthodes ;
- des entreprises de description des déclarations des œuvres, qui introduisent leur vie
publique ;
- des écrits à propos de l’interprétation, de leurs ressorts et enjeux ;
- des études autour du lien créé par l’interprétation entre œuvres et publics, qui illustrent le
pouvoir – des œuvres à figurer la demande identitaire de leurs publics. (p. 94)
24La sélection d’Esquenazi comprend des ouvrages d’Erwin Panofsky sur l’architecture
gothique et la pensée scolastique et d’Anne Boschetti sur Jean-Paul Sartre aux études sur le
cinéma français de la Nouvelle Vague et le soap opéra américain. Il ne sera guère profitable
d’énumérer ici les arrêts effectués par Esquenazi sur le parcours scientifique des œuvres d’art,
mais nous ne soulignerons certainement pas assez l’agréable et profitable variété de cet
inventaire didactique.
25La Sociologie des œuvres d’Esquenazi concrétise l’entreprise d’une vaste réconciliation.
Tenant de la synthèse et du manuel, Sociologie des œuvres s’adresse tant à l’expert qu’au
néophyte.
Haut de page
Notes
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%