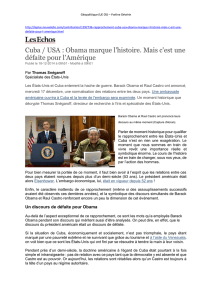Point de vue

Point de vue
Cuba entre parti et "débrouille", par
Vincent Bloch
LE MONDE | 28.02.08 | 13h59 • Mis à jour le 28.02.08 | 13h59
De nombreux observateurs s'étaient empressés d'annoncer une ère
nouvelle, voire l'éventualité d'un soulèvement populaire, sitôt les
fonctions du dirigeant historique de la révolution déléguées
"temporairement" aux mains d'une direction collégiale, le 31 juillet 2006.
Contraints par la suite d'expliquer l'immobilisme du régime, ils avaient
eu recours à des arguments tout aussi spéculatifs : Fidel Castro n'était
que malade, il continuait à "tirer les ficelles", et la menace de son
"retour" avait dissuadé les "réformistes" de monter au créneau. En
renonçant à ses fonctions de commandant en chef et de président du
Conseil d'Etat, Fidel Castro lèverait donc aujourd'hui le principal obstacle
au "changement".
De telles analyses suggèrent que le régime cubain tient à l'autorité et au
pouvoir d'un seul homme, et qu'une lecture de la réalité cubaine
cantonnée aux hautes sphères de l'Etat suffit à elle seule à éclairer le
cours des choses. Certes, il est possible que la cristallisation du pouvoir à
l'intérieur d'institutions et aux mains de groupes stables permette une
meilleure lecture du jeu pour tous. Et favorise donc, au sein des élites,
l'émergence d'initiatives stratégiques libérées de la mise en mouvement
permanente qui caractérisait l'administration du pouvoir propre à Fidel
Castro. Mais le problème est d'autant plus complexe qu'il impliquerait un
point de rencontre entre l'élan réformiste d'une partie des élites et le ras-
le-bol de la société. Or la référence imposée à la "révolution" autant que
le cadre d'un régime autoritaire ne s'y prêtent pas.
Depuis le mois de septembre 2007, Raul Castro a impulsé un processus
critique qui fait suite à ceux de 1962, 1965, 1968, 1970, 1986 ou 1991.
Depuis cinquante ans, ce recours récurrent à "l'autocritique
révolutionnaire" permet en effet au pouvoir de mettre en scène les
inflexions politiques décidées depuis le sommet. Ainsi les revendications
matérielles des Cubains et la demande d'accès à l'initiative économique
privée font-elles cette fois écho aux "changements structurels et de

concepts qui s'avéreront nécessaires", évoqués par Raul Castro dans son
discours du 26 juillet 2007.
Mais, quoi qu'il en soit, aucune "voix critique" ne déroge à l'impératif
d'unanimité : toute opinion s'exprime en vue de pérenniser "la
Révolution", de bâtir le socialisme et de maintenir l'ordre face aux
menaces de déstabilisation ourdies depuis l'étranger. Le ras-le-bol de la
population ne doit, quant à lui, pas être trop rapidement apparenté à une
forme d'opposition ou à une volonté de rupture.
Les niveaux records atteints en 2007 par l'émigration légale et illégale
montrent que la "libération de la parole", dans une société à ce point
atomisée, ne débouche guère sur des formes de mobilisation collective.
Outre la dépolitisation de la société, c'est surtout la façon même dont les
uns et les autres s'affairent à résoudre leurs problèmes quotidiens qui
contribue par ses effets pervers à perpétuer les modes de domination du
régime.
L'explosion des petits trafics, du marché noir, des vols au sein des
entreprises, des activités privées sans licence ou de la prostitution ne
peut pas être ramenée à une forme de résistance ou de contestation
rampante qui sape l'autorité du régime. Cette lucha - la débrouille - à
laquelle toute la population est réduite à une échelle ou à une autre,
participe autant d'un contournement des normes présent dès les années
1960 qu'elle s'insère dans une administration du pouvoir dont les
dirigeants ont conservé le contrôle.
Dès l'introduction du système de rationnement, l'irrationalité de
l'allocation des ressources, conjuguée aux pénuries, avait induit des
domaines de coopération entre voisins. Les uns et les autres accordaient
leurs préférences en pratiquant échanges et arrangements financiers. En
outre, le dérèglement des systèmes de comptabilité à tous les échelons du
système économique avait favorisé les détournements au sein des
entreprises, tout en alimentant les circuits du marché noir. Se trouvant
en situation de risque, puisqu'ils enfreignaient la loi et s'exposaient à des
sanctions, les uns et les autres avaient pris l'habitude de manier les faux

semblants et les doubles registres en cherchant à satisfaire d'une manière
ou d'une autre les normes d'adhésion publique au régime.
Depuis la crise économique consécutive au tarissement de l'aide
soviétique, cette dimension de l'expérience sociale est devenue
prépondérante. D'une part, l'impossibilité de respecter les lois
(restrictions sur l'activité économique privée, insuffisance des salaires,
réglementations drastiques concernant le logement, les transports, etc.)
oblige à un viol systématique de la légalité socialiste, et la marge est
devenue la norme.
D'autre part, les autorités ont dû se résoudre tacitement à accorder
davantage de marge de manoeuvre aux jeux stratégiques des individus, et
le laisser-faire est beaucoup plus important depuis le début des années
1990. De cette manière, la lucha a aussi fini par perpétuer une mobilité
sociale, en permettant tantôt de "joindre les deux bouts", tantôt de "faire
un coup", voire de gravir l'échelle sociale et de trouver une "niche" ou la
possibilité de quitter le territoire.
Mais en étant contraintes au laisser-faire, les autorités ont pu intensifier
la tactique des vagues répressives ciblées, déjà familières aux Cubains
depuis le début des années 1960. Comme tous se savent "marqués" d'une
façon ou d'une autre du fait des innombrables entorses à la légalité qu'ils
ne peuvent s'empêcher de commettre, une véritable concurrence à la
conformité, censée contrebalancer les activités relevant de la lucha, vient
donner consistance à la fiction officielle. On vote, on manifeste, on paie
sa cotisation au comité de défense de la révolution ou au syndicat.
Prise dans la perversité de la débrouille, la population perçoit
confusément les enjeux d'une alternative et s'accroche par défaut au
fantasme de l'ordre, dont le régime se veut le garant. Au-delà du retrait
de Fidel Castro, le fonctionnement social au quotidien ne peut se départir
d'un ensemble de règles et de normes qui donnent à la société
révolutionnaire les signes de son existence. Ce "bouclage du social sur
lui-même", pour reprendre l'expression de Claude Lefort, est assuré par
le Parti communiste, qui chapeaute toutes les autres institutions. Le parti

est donc l'institution la plus importante du régime, celle qui fait prévaloir
l'impératif d'unanimité et assure l'efficacité symbolique du régime.
Fidel Castro n'aura peut-être plus de rôle formel au sein du Conseil d'Etat,
mais il n'est pas anodin qu'il n'ait pas renoncé à ses fonctions de premier
secrétaire du Parti. L'"un" révolutionnaire est indivisible, et le désormais
"camarade Fidel" ne peut pas plus s'en exclure que la société cubaine ne
peut s'y soustraire. Aussi longtemps, en tout cas, que les principes de la
division et du conflit ne seront pas reconnus.
Vincent Bloch, sociologue
1
/
4
100%
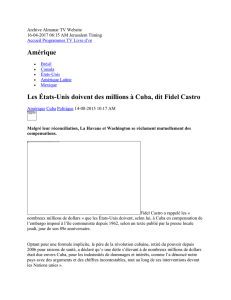
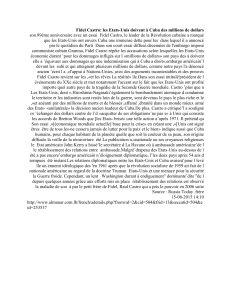


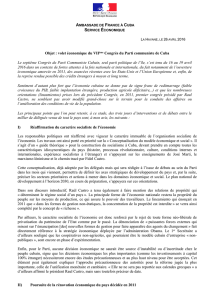
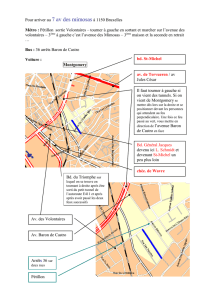

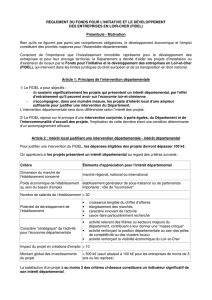
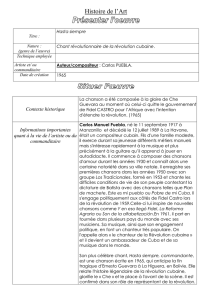
![[Cuba] La fin annoncée du socialisme d`État](http://s1.studylibfr.com/store/data/002893975_1-1b127c01e8a10bee783c0137cbfe0004-300x300.png)