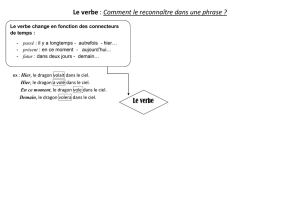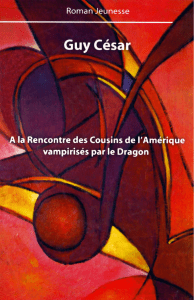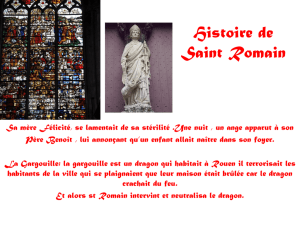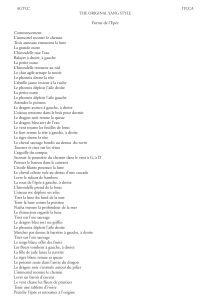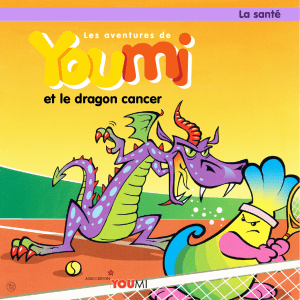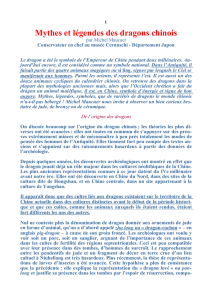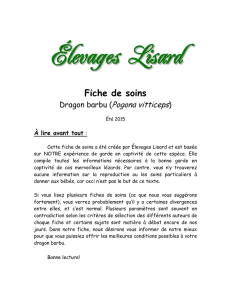suellement décrits, dans la civilisation occidentale, comme

suellement décrits, dans la civilisation occidentale, comme des reptiles au museau de
crocodile et aux ailes de chauve-souris, les dragons, selon les civilisations et les époques, ont
épousé de nombreuses autres formes. Les dragons, dans l'antiquité grecque, ont la forme de
serpents monstrueux.
Homère, dans l'Iliade, présente par deux fois le dragon comme vecteur de messages divins. La
première apparition du monstre est l'occasion d'un présage envoyé par Zeus à propos de la
durée de la guerre de Troie. Ce dragon a un « dos ensanglanté », il apparaît proche d'un point
d'eau et d'un lieu sacré (Il., II, 308-310 ) et attaque de modestes oiseaux. Parmi les Grecs, le
devin Calchas interprétera ce présage divin. Une autre apparition de la créature a lieu, cette
fois, parmi les Troyens : un dragon « aux couleurs variées » tombe des cieux, lâché par un
aigle. Il est interprété comme le « signe de Zeus tempétueux » par le devin et stratège
Polydamas qui prédit ainsi l'issue d'une des batailles de la guerre de Troie (Il., XII, 209 ).
Dans ces deux évocations, le dragon est similaire à un serpent ordinaire. Seul sa couleur
permet de le regarder comme un signe des dieux.
Plus impressionnante que ces précédentes apparitions de dragons est la Chimère présentée
comme une créature hybride. Son corps est en partie celui d'un dragon (Il., VI, 181 ). Dans
cette même fonction horrifique, on retrouve des dragons sur la cuirasse d'Agamemnon et sur
la courroie d'argent de son bouclier (Il., XI, 26 et 39 ). Vers la fin de l'œuvre d'Homère,
comme une apothéose à ces précédentes allusions à des dragons, on découvre le riche portrait
d'un dragon « montagnard nourri d'herbes vénéneuses, et plein de rage » qui « se tord devant
son repaire avec des yeux horribles, en attendant un homme qui approche » (Il., XXII, 93-95
).
L'Odyssée ne fait référence qu'une fois à un dragon. C'est un des aspects qu'adopte Protée, le
dieu marin aux milles formes (Od., IV, 457 ). Mais le texte ne donne aucune indication sur
l'apparence de ce dragon.
Dans la Théogonie, Hésiode n'évoque pas de dragon. Néanmoins, à l'occasion de la
description des monstres hybrides, des parties de ceux-ci sont présentées comme relevant du
dragon. Il en est ainsi de Typhée dont les épaules sont pourvues de cent têtes de dragons (Th,
825 ) aux langues noires et crachant du feu. La Chimère relève du même type : elle a trois
têtes - dont l'une de dragon (Th, 322 ) - et un corps en trois partie - dont une queue de dragon
(Th, 324 ).
Dans le Bouclier, œuvre attribuée à Hésiode, un dragon est décrit. Il figure au centre du
bouclier d'Héraclès . Il a « des yeux flamboyants » et une gueule « pleine de dents blanches,
féroces et implacables » (Bc, 144-146 ).
Euripide évoque à plusieurs reprises, dans son œuvre, des dragons.
Dans la tragédie Les Phéniciennes, le poète conte la légende de la création de Thèbes : Le site,
indiqué à Cadmos pour qu'il y fonde sa ville, était gardé par « le Dragon sanglant d'Arès »
(Phén. 662 ), « Dragon à l'éclatante crête rouge et nourri de bêtes fauves » (Phén. 820 ).
Cadmos le tua d'un coup de pierre. Sur les conseils d'Athéna, il en sema les dents « sous les
profonds sillons, et la terre en fit jaillir une moisson d'hommes armés » (Phén. 662 ).
Le poète fait également référence au sanctuaire de Delphes , sur les flancs du Parnasse, qui
fut conquit par Apollon après avoir tué son gardien, Phyton, un dragon. Aussi, Euripide
désigne-t-il le Parnasse par l'expression : « Antres divins du Dragon » (Phén. 231 ).
Théocrite, dans ses Idylles, à l'occasion de la description de la naissance d'Héraclès , conte
comment le fils adultérin de Zeus terrassa les deux dragons qu'Héra avait envoyés pour
l'occire (Idylle 24 - Héraclès enfant ). Bien des traducteurs contemporains préfèrent le mot

« serpent » à « dragon », l'image du médiévale du gigantesque dragon ne coïncidant pas avec
la notion de serpent monstrueux de la Grèce antique, surtout face au petit bébé qu'est Héraclès
dans cette idylle. Cependant, les mythes évoluent et les animaux mythiques aussi ; changer de
mot, c'est nier cette évolution.
1
/
2
100%