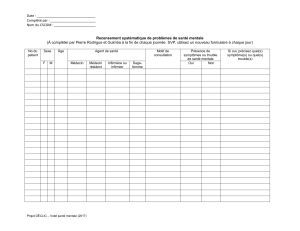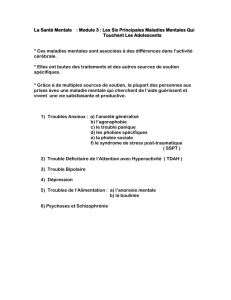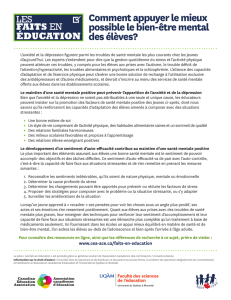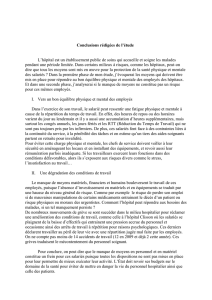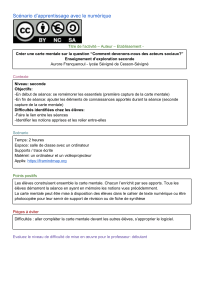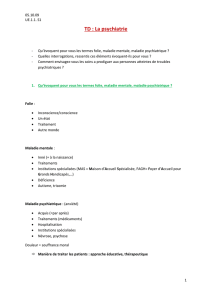précédente rencontre - Atelier Santé Ville Paris 19e

Culture en partage
La santé mentale, c’est fou ?
Le 10 juin 2015
Taos AIT SI SLIMANE : Bonjour et bienvenue. Merci d’être venus aussi nombreux à ce
premier rendez-vous Culture en partage, « La santé mentale, c’est fou ? », en lien avec une
de nos futures expositions « goes crazy », que Virginie LACOMBE va nous présenter, puis
nous donnerons la parle à nos trois invités : Xavier BRIFFAULT, chercheur en sciences
sociales et philosophe de la santé mentale ; Luc MALLET, chercheur à lSM et professeur de
psychiatrie et Margot MORGIEVE, psychologue
Virginie LACOMBE : Bonjour à tous. Merci d’être là. Je vais vous présenter l’exposition
« goes crazy ». Ce titre est un titre de travail provisoire. Cette exposition sera accueillie à la
Cité du 3 novembre 2015 au 28 août 2016.
Elle fait partie de ce que nous appelons « le grand consortium ». Il s’agit de la réunion de 3
musées :
- Heureka (science center) en Finlande,
- Le Pavillon des connaissances au Portugal,
- La Cité des sciences et de l’industrie en France.
Ces musées se sont associés pour réaliser 3 expositions destinées à itinérer dans chacun
des musées. La première exposition initiée par le grand consortium est « Sciences center
goes crazy », traduit par « La Cité des sciences goes crazy ». La Cité des sciences a
travaillé sur Risque, encore présenté aujourd’hui sur le plateau Marie Curie et nos amis
portugais du Pavillon des connaissances travaillent actuellement sur la production d’une
exposition sur la contagion, qui va s’appeler Viral. Eux ont déjà un titre définitif.
Cette exposition a déjà été présentée en Finlande en 2013/2014. Elle a remporté le Prix de
l’expérience visiteur, qui récompense la manière dont le sujet de la santé mentale est traité à
travers cette exposition.
Pourquoi une exposition sur le thème de la santé mentale ? C’est parce qu’aujourd’hui,
environ une personne sur 4 est confrontée à un problème de santé mentale au cours de sa
vie. Nous connaissons donc tous quelqu’un, plus ou moins proche, qui a ou a eu un souci de
santé mentale ou trouble psychique. Cette exposition concerne donc tout le monde. Elle
constitue une grande première. C’est la première exposition sur ce thème dans des centres
de sciences.
Pourquoi parlons-nous aujourd’hui de santé mentale et non de folie comme par le passé ?
Qu’est-ce qu’un trouble psychique, une maladie psychiatrique ? Est-ce que nous pouvons
tracer une frontière entre la mauvaise santé mentale et la bonne santé mentale ? Toutes ces
questions ont abouti à cette exposition.
Les objectifs de cette exposition visent avant tout la sensibilisation en direction du grand
public pour dissiper les préjugés que nous avons tous sur les troubles psychiques, apporter
quelques connaissances (à destination d’un large public familial notamment, à partir de 10
ans) et encourager les visiteurs à prendre soin de leur propre santé mentale.

Culture en partage : La santé mentale, c’est fou ?
Le 10 juin 2015 à la Cité des sciences et de l’industrie
Document relu par : VL
Universcience / DSP / Taos AIT SI SLIMANE
2
D’un point de vue muséographique, les éléments d’exposition sont placés dans de grandes
boîtes en bois, évoquant la boîte à bijoux. C’est-à-dire que, de l’extérieur, ces boîtes en bois
sont à peu près similaires, mais à l’intérieur elles renferment toutes quelque chose de
différent qui a trait à l’intime. Le mobilier n’a pas été fabriqué pour les besoins de l’exposition,
mais chiné par nos amis finlandais dans des vide-greniers et des brocantes. Il s’agit d’un
mobilier familier, qui apporte une ambiance chaleureuse à une exposition, qui traite d’un
sujet tout de même assez délicat. Enfin, le graphisme de l’exposition est assez fort, puisqu’il
a été réalisé en collaboration avec une artiste finlandaise, Vappu Rossi. Cette dernière a
peint des décors à l’intérieur de chaque élément d’exposition. Elle a réalisé des œuvres à
l’intérieur même de l’exposition.

Culture en partage : La santé mentale, c’est fou ?
Le 10 juin 2015 à la Cité des sciences et de l’industrie
Document relu par : VL
Universcience / DSP / Taos AIT SI SLIMANE
3
L’exposition ne suit pas de sens de visite particulier. Elle est centrée autour de trois grandes
familles d’éléments :
- autour de ce que nous savons ou croyons savoir sur les troubles mentaux
aujourd’hui ;
- comment peut-on vivre quand on est atteint d’un trouble psychique ?
- La prévention de ces troubles : prenez soin de vous.
Dans la 1re famille d’éléments sur ce que nous savons ou croyons savoir, il y a deux
éléments d’exposition qui traitent de l’histoire de la folie, de la manière dont elle a été traitée
à travers les âges. La présentation a lieu autour d’un livre numérique intitulé Ainsi soignait-on
la folie ou à travers la reproduction de saynètes de différents lieux clés dans l’histoire de la
psychiatrie et de la psychologie. De petites maquettes reproduisent ainsi différents lieux à
travers l’histoire. En outre, un quiz permet de donner du contenu aux visiteurs et les invite à
interagir sur l’élément. Il porte sur différents symptômes des troubles mentaux, les
personnages célèbres qui ont souffert ou pas de troubles mentaux et sur certains chiffres,
sur certaines statistiques. Enfin, un élément reprend la classification des troubles mentaux.
Les visiteurs pourront donc de cette manière en apprendre davantage sur les troubles
bipolaires. Leurs causes possibles, leurs symptômes et les différents traitements possibles
de cette affection sont expliqués ici. La grande majorité des troubles psychiques sont
présents dans l’élément « Les troubles mentaux ».
Le cerveau et la santé mentale est un multimédia à travers lequel les visiteurs vont pouvoir
constater ce qui dysfonctionne dans le cerveau en cas de schizophrénie ou de dépression.
L’élément Trouver de l’aide permettra aux visiteurs de consulter de la documentation sur
différents organismes de soutien, des structures auxquelles on peut faire appel en cas de
souffrance mentale. De plus, une borne renverra vers différents sites internet pour trouver de
l’aide en cas de souffrance psychique. Cet élément d’exposition est réalisé en étroite
collaboration avec la Cité de la santé, puisque nous avons la chance, à la Cité des sciences
et de l’industrie de disposer de cet endroit, qui permet d’informer gratuitement le visiteur.

Culture en partage : La santé mentale, c’est fou ?
Le 10 juin 2015 à la Cité des sciences et de l’industrie
Document relu par : VL
Universcience / DSP / Taos AIT SI SLIMANE
4
Dans la partie Comment se sent-on ?, les visiteurs vont pouvoir constater comment on peut
vivre lorsqu’on est atteint d’un trouble mental. Par exemple, avec la réalité se déforme des
formes, les visiteurs vont entrer à l’intérieur d’un salon de coiffure, où une voix off leur
demandera de s’installer, puis de patienter en leur proposant un café. Ensuite, une autre voix
off va apparaître pour illustrer ce que pourrait se dire quelqu’un souffrant de psychose dans
une situation telle que celle-là. « Pourquoi le coiffeur me fait-il attendre ? Pourquoi me
propose-t-il un café ? On n’est pas dans un café ici… » Cela permet d’entrer dans la tête
d’une personne qui souffre de psychose. Quel est l’objectif de cet élément ? Il montre au
visiteur que pour tout un chacun cela peut être très ordinaire d’aller chez le coiffeur, mais
pour quelqu’un de « psychotique », cela peut s’avérer très compliqué.
Vivre avec la dépression permet aux visiteurs d’entrer dans un salon, où sont installés 3
personnages : un papa qui souffre de dépression sévère, un enfant et la maman. Ils vont
pouvoir entendre comment chacun des membres de cette famille vit la dépression sévère du
père. Cela permet d’expliquer à l’auditeur que la dépression engendre évidemment de la
souffrance chez la personne, qui en est atteinte, mais également dans son entourage.
La chambre des phobies amène les visiteurs à expérimenter différentes sources de phobies :
- la peur du noir,
- la peur du vide,
- la peur des lieux confinés.
Parcours de vie permet aux visiteurs d’écouter les témoignages de patients atteints d’un
trouble psychique. Ces témoignages seront réalisés à la Cité des sciences. Nos amis
finlandais ont réalisé 5 témoignages de personnes malades. Nos amis portugais, qui
reçoivent actuellement l’exposition, ont réalisé également leurs témoignages. C’est pourquoi
nous avons décidé de réaliser les nôtres, car nous nous sommes rendu compte que la
manière d’exprimer son trouble présentait des aspects culturels. On n’en parle pas de la
même manière dans les différents types de cultures.
Le miroir de l’image de soi présente un élément sur les troubles du comportement
alimentaire, où les visiteurs vont pouvoir ajuster le miroir à la façon, dont ils se perçoivent.
Testez-vous propose 4 postes multimédias, à travers lesquels les visiteurs vont pouvoir
tester certaines de leurs compétences cognitives et réaliser un test sur leur propension à
l’addiction. Nous avons repris ce multimédia d’une ancienne exposition sur le cerveau.
Le schizophone est une sculpture acoustique, qui spatialise les sons. Elle a été réalisée par
un artiste français, Pierre-Laurent CASSIERE, qui évoque les troubles de la perception.
Cette dernière partie de l’exposition a une expression plus légère, qui encourage les visiteurs
à prendre soin de leur propre santé mentale.
Avec Danser comme un fou, les visiteurs vont pouvoir écouter des playlists de musiques
françaises et anglo-saxonnes autour de la folie. Il s’agit de danser sous des casques
contenant des capteurs de présence. Ainsi quand les visiteurs bougent, la musique est
diffusée. Quand ils s’immobilisent, la musique s’arrête. Ce concept vise à les inciter à
bouger.
Reconnaître une émotion souligne grâce à un jeu très simple l’importance des émotions, qui

Culture en partage : La santé mentale, c’est fou ?
Le 10 juin 2015 à la Cité des sciences et de l’industrie
Document relu par : VL
Universcience / DSP / Taos AIT SI SLIMANE
5
constituent le 1er contact pour entrer en interaction avec l’autre. Cela renvoie à un souci d’un
trouble psychique, ce souci de reconnaissance et d’expression des émotions.
Le broyeur de soucis encourage les visiteurs à verbaliser ce qui peut les tracasser pour
souligner l’importance de reconnaître ce qui peut nous poser problème et de pouvoir le
verbaliser.
Avez-vous peur ? s’adresse aux plus jeunes. Dans cet élément, grâce à un système kinect,
les visiteurs vont pouvoir chasser des yeux apparaissant sur les murs. Ces yeux peuvent
sembler inquiétants. Or une fois chassé, on se rend compte qu’il s’agissait d’une couverture
de livre ou d’une peluche. Cela permet de souligner l’importance d’être capable d’affronter
ses peurs, une compétence qui se travaille et permet de prendre soin de soi-même.
Est-ce moi ? évoque la représentation des fous ou de la folie à travers l’art. Le tableau choisi
est Le cri de MUNCH. Grâce à un logiciel de morphing, les visiteurs vont voir leur visage
s’incruster et se transformer dans le visage du tableau.
Enfin, le dernier élément, Laissez parler votre corps, propose aux visiteurs d’enfiler des
masques représentant les émotions de base pour les mimer avec leur corps. Cet élément
évoque l’importance des expressions des émotions. Quand on ne peut pas les exprimer
avec des mots, on peut aussi les exprimer différemment, notamment grâce à l’art thérapie.
Cela peut être la danse, le théâtre, etc.
Voilà un petit tour rapide des différents éléments de l’exposition.
Nous aurons notre affiche définitive en juillet. Nos amis finlandais ont travaillé sur leur
communication avec un comité d’experts finlandais. Pour notre part, nous avons travaillé
depuis le début de cette coproduction avec nos experts présents ici, à qui je vais laisser la
parole.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%