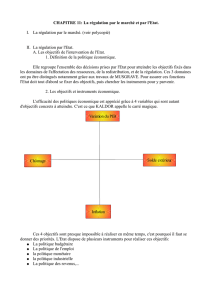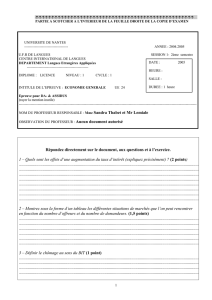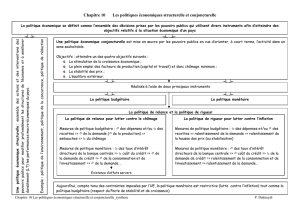Introduction générale La politique économique représente l`action

Introduction générale
La politique économique représente l'action du pouvoir politique dans le domaine
économique. Une politique économique est une manière orientée et cohérente de conduire les
affaires et une politique économique est donc une certaine orientation de toutes les actions
publiques ayant un impact sur la vie économique : dépenses de l'Etat, régime monétaire,
relations extérieures. La politique économique est aussi l'ensemble des actions concrètes
poursuivies dans un domaine particulier. Ces actions doivent être suffisamment nombreuses
pour donner un corps à la notion de politique économique. L'idée d'une intervention
permanente et multiple des pouvoirs publics dans la vie économique paraît naturelle, sauf si
l'on adopte un point de vue historique. Quels sont les objectifs fondamentaux des politiques
économiques ? Ils tendent tous vers une finalité unique : la prospérité générale, soit pour
l'atteindre, soit pour en limiter les perturbations. L'objectif général est la croissance, c'est-à-dire
un accroissement durable de la production, du revenu, de la richesse de la nation. On en rend
compte le plus fréquemment en désignant la progression du PIB. Le plein emploi et le progrès
social constitue un second objectif. Il s'agit du plein emploi de tous les facteurs de production,
c'est-à-dire des moyens mêmes de la croissance (en premier lieu, il s'agira du plein emploi des
hommes qu'une croissance élevée ne garantit pas ; ainsi une croissance intensive exploitant les
progrès de la productivité pourra détruire plus d'emplois qu'elle ne pourra en créer. Les deux
exigences de croissance et de plein emploi entretiennent en fait des rapports ambiguës (l'une
n'est pas possible sans l'autre mais elles peuvent être aussi en conflit). Le troisième objectif
est dédoublé ; il implique la maîtrise des équilibres parce que la croissance ne peut être
durable si elle est menacée par des déséquilibres graves : l'inflation ou/et le déficit extérieur
(maîtrise de l'inflation et équilibre extérieur sont respectivement les troisième et quatrième
objectif. L'inflation est une hausse générale des prix, cumulative et inégale qui peut conduire à
des attitudes de précaution ou de spéculation dont les effets perturbateurs peuvent être le refus
de l'épargne ou la hausse des taux d'intérêt. Un déficit extérieur durable conduit à
l'appauvrissement de l'Etat déficitaire. Le carré magique est la conjugaison des quatre objectifs
qui peuvent être contradictoires mais sont interdépendants s'ils sont maîtrisés : croissance,
plein emploi, stabilité des prix et équilibre extérieur.

- 2 -
Encart 1 - le carré magique de N. Kaldor
Tout repose en fait sur la maîtrise de la croissance. Le carré magique exprime
l'interdépendance dans la durée de ces quatre objectifs. Dans la période contemporaine, la
coopération économique internationale s’est accrue et les politiques économiques ont dû
intégrer de nouvelles contraintes. Caractérisons de façon plus précise le développement
contemporain des relations économiques internationales.
En 2005, le commerce mondial de marchandises s’est établi à 10159 milliards de
dollars. Ce chiffre concerne les échanges entre tous les pays, que ceux-ci soient membres ou

- 3 -
pas d’une zone d’intégration régionale. Les flux commerciaux intra-européens ont représenté
le tiers de ce trafic et dominent le commerce mondial (3201 milliards de dollars). Les flux de
commerce intra-américains se sont élevés à 1115 milliards de dollars et les flux intra-
asiatiques ont atteint 1424 milliards de dollars. Quelle était l’importance des échanges entre
ces trois ensembles, encore appelés la Triade ? L’Europe exportait 332 milliards de dollars
vers l’Asie et 456 milliards vers l’Amérique. Elle importait 498 milliards de dollars et 306
milliards de dollars respectivement de l’Asie et de l’Amérique. La zone américaine, quant à
elle, exportait 318 milliards de dollars vers l’Asie et importait de cette zone 659 milliards de
dollars. On peut donc constater que le commerce à l’intérieur des blocs régionaux (Europe,
Amérique, Asie) représente presque 60% du commerce mondial. Voir annexe 1 pour
l’analyse des évolutions des poids économiques internationaux respectifs des grandes
ensembles mondiaux (évolutions induites par la mondialisation).
On peut ajouter que le trafic de marchandises reste prépondérant dans le commerce
international par rapport à celui des services dont la croissance se poursuit néanmoins (leur
part est passée de 16% à 17,5% de 1984 à 2004). La nature des échanges de services s’est
aussi modifiée puisque la part représentée par le transport international et les voyages
(respectivement 24% et 26%) dans le commerce mondial de services a régressé au profit des
autres services (50%) au sein desquels les services informatiques et financiers enregistrent les
taux de croissance les plus élevés.
Le développement du commerce international dans la période contemporaine a été
favorisé, d’une part, par le développement des accords commerciaux depuis 1947 sous l’égide
du GATT puis de l’OMC à partir de 1994 et, d’autre part, par la constitution de zones
d’intégration régionale (principalement des zones de libre-échange et plus rarement, des
unions douanière). Depuis 1945, le processus de libéralisation du commerce mondial repose
en grande partie sur des systèmes fondés sur la coordination des politiques commerciales au
sein du GATT puis de l’OMC. Ils s’appuient sur le principe du multilatéralisme, c’est-à-dire
que les concessions et les règles sont négociées non plus entre deux pays mais dans le cadre
de cycles rassemblant un grand nombre de pays (23 à la naissance du GATT, 149 en 2005
dans le cadre de l’OMC). Simultanément, et parfois en raison des difficultés de la négociation
multilatérale, se sont développées les zones d’intégration régionale (CEE en 1957, AELE en
1960, par exemple).
A - Les négociations commerciales multilatérales

- 4 -
Pour tenir compte des enseignements tirés du repli des économies sur elles-mêmes
dans l’Entre-deux-Guerres, un certain nombre de pays occidentaux développés se sont
concertés pour mettre en place un système de coordination des politiques commerciales visant
à ouvrir progressivement leurs frontières aux marchandises étrangères. En 1947, le GATT
naît pour impulser une dynamique de participation accrue des nations à l’échange
international. Pourquoi un tel choix d’ouverture internationale des économies ? On doit noter
que les organisations internationales et les accords internationaux commerciaux se réfèrent
souvent (plus ou moins explicitement) aux théories classiques et néo-classiques de l’échange
international. Celles-ci ont établi la supériorité du libre-échange sur toute autre forme
d’organisation internationale des échanges (le libre-échange maximisant le gain en termes de
bien-être des agents économiques). Ces théories analysent les fondements de la spécialisation
internationale et démontrent que tous les pays obtiennent des gains de l’échange international
(par rapport à toute situation d’autarcie ou de protectionnisme) sous les hypothèses
restrictives de stabilité dans le temps des structures de coût et de concurrence pure et parfaite.
Cela dit, des économistes, tels P. Samuelson, qui ont contribué à l’établissement du corps
théorique traditionnel de l’échange international ont fait évoluer leurs analyses initiales.
Ainsi, P. Samuelson, co-auteur avec Heckscher et Ohlin du modèle HOS conçu sous
l’hypothèse restrictive d’absence de mobilité internationale des facteurs de production, a-t-il
reconsidéré un certain nombre de résultats qu’il avait établis antérieurement sur les
déterminants de l’échange international en posant une nouvelle hypothèse : celle de la
mobilité internationale des facteurs de production (voir plus loin la partie du cours traitant
cette question).
L’Accord général repose sur quatre principes fondamentaux :
- l’égalité de traitement entre partenaires commerciaux en généralisant uniformément
à tous les partenaires les avantages consentis à un seul : c’est la clause de la nation la plus
favorisée. Ce principe qui fonde le multilatéralisme (principe différent du bilatéralisme) est le
plus important de l’Accord.
- les concessions octroyées doivent l’être sur une base de réciprocité et d’avantages
mutuels de façon à éviter les comportements de passagers clandestins dans le système
commercial multilatéral.
- le traitement national qui impose que les produits étrangers soient soumis au même
traitement que les produits similaires d’origine nationale dès qu’ils se sont acquittés des droits

- 5 -
de douane pour entrer sur le territoire national.
- l’Accord favorise les pratiques commerciales transparentes. L’usage du droit de
douane est préféré à toute autre forme de protection (restrictions quantitatives aux échanges
ou quotas, par exemple). C’est la raison pour laquelle les prélèvements agricoles de la PAC
originelle ont été transformés en équivalents tarifaires par l’accord de l’Uruguay round (à
l’initiative des Etats-Unis). Voir en annexe 2 les mécanismes du cycle agricole et de la
politique de soutien des prix agricole avant l’accord de Marrakech.
Cela étant, il existe quelques exceptions à l’application des principes précédents
(exceptions aux principes généraux du libre-échange). Le GATT et l’OMC encadrent et
contrôlent de tels dispositifs dérogatoires dont le nombre est d’ailleurs en régression
aujourd’hui :
- une exception à la clause de la nation la plus favorisée en autorisant la
constitution de zones de libre-échange ou d’union douanière (article XXIV du GATT) ;
- les échanges entre pays développés et pays en développement peuvent être
exonérés de la clause de réciprocité. Citons l’exemple des accords de l’Union européenne
avec certains pays tiers, par exemple les pays ACP dans le cadre des conventions de Lomé
ou encore, l’exemple du système des préférences généralisées.
- la principale exception au principe du traitement national concerne
l’imposition de quotas à l’écran pour les films d’origine nationale.
- les exceptions à l’usage exclusif de droits de douane comme moyens de
protection sont nombreuses : cas de l’agriculture, de la pêche ou encore de pays qui
connaissent de graves difficultés de balances de transactions courantes.
Néanmoins, l’Accord général autorise la mise en place de mesures protectionnistes en
situation de crise ou de pratiques déloyales (des clauses de sauvegarde ou des mesures anti-
dumping peuvent être utilisées). Les clauses de sauvegarde doivent obéir au principe de non-
sélectivité.
Dans un tel contexte, le GATT a ouvert plusieurs rounds de négociation pour abaisser
le niveau de protectionnisme tarifaire et non tarifaire international. C’est notamment le cas de
l’accord de l’Uruguay round qui s’est conclu par l’accord de Marrakech, le 15 avril 1994.
Quels en sont les résultats principaux ? On peut citer :
- la poursuite du démantèlement des droits de douane avec notamment la réduction des
pics tarifaires (droits de douane supérieurs à 15%).
- l’extension des règles du GATT à des secteurs jusqu’alors exclus (services, le
secteur textile régenté par l’accord multifibres -AMF-, l’agriculture qui dérogeait aux règles
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%